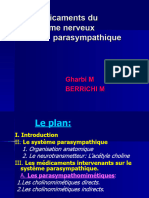Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
临床医学的诞生法文版
Cargado por
Li DanDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
临床医学的诞生法文版
Cargado por
Li DanCopyright:
Formatos disponibles
(1963) Naissance de la Clinique
|PAGE V prface Il est question dans ce livre de l'espace, du langage et de la mort ; il est question du regard. Vers le milieu du XVIIIe sicle, Pomme soigna et gurit une hystrique en lui faisant prendre des bains de 10 12 heures par jour, pendant dix mois entiers . Au terme de cette cure contre le desschement du systme nerveux et la chaleur qui l'entretenait, Pomme vit des portions membraneuses semblables des morceaux de parchemin tremp... se dtacher par de lgres douleurs et sortir journellement avec les urines, l'uretre du ct droit se dpouiller son tour et sortir tout entier par la mme voie . Il en fut de mme pour les intestins qui, dans un autre temps, se dpouillrent de leur tunique interne que nous vmes sortir par le rectum. L'oesophage, la trache artre, et la langue s'taient dpouilles leur tour ; et la malade nous avait rejet diffrentes pices soit par le vomissement soit par l'expectoration (1). Et voici comment, moins de cent ans plus tard, un mdecin peroit une lsion anatomique de l'encphale et de ses enveloppes ; il s'agit des fausses membranes qu'on trouve frquemment chez les sujets atteints de mningite chronique : Leur surface externe applique sur le feuillet arachnodien de la dure-mre est adhrente ce feuillet, tantt d'une manire trs lche, et alors on les spare facilement, tantt d'une manire ferme et intime et dans ce cas il est quelquefois trs difficile de les dtacher. Leur surface interne est seulement contigu l'arachnode, avec laquelle elle ne contracte aucune union... Les fausses membranes sont souvent transparentes surtout lorsqu'elles sont trs minces ; mais ordinairement elles ont une couleur blanchtre, (1) P. POMME, Trait des affections vaporeuses des deux sexes (4e d., Lyon, 1769), t. I, pp. 60-65. |PAGE VI gristre, rougetre et plus rarement. jauntre, bruntre et noirtre. Cette matire offre frquemment des nuances diffrentes suivant les parties de la mme membrane. L'paisseur de ces productions accidentelles varie beaucoup ; elles sont parfois d'une tnuit telle qu'on pourrait les comparer une toile d'araigne... L'organisation
des fausses membranes prsente galement beaucoup de diffrences : celles qui sont minces sont couenneuses, semblables aux pellicules albumineuses des oeufs et sans structure propre distincte. Les autres offrent souvent sur une de leurs faces des traces de vaisseaux sanguins entrecroiss en divers sens et injects. Elles sont souvent rductibles en lames superposes entre lesquelles sont assez frquemment interposs des caillots d'un sang plus ou moins dcolor (1). Entre le texte de Pomme qui portait leur forme dernire les vieux mythes de la pathologie nerveuse et celui de Bayle qui dcrivait, pour un temps dont nous ne sommes pas encore sortis, les lsions encphaliques de la paralysie gnrale, la diffrence est infime et totale. Totale pour nous, puisque chaque mot de Bayle, en sa prcision qualitative, guide notre regard dans un monde de constante visibilit, alors que le texte prcdent nous parle le langage, sans support perceptif, des fantasmes. Mais cet vident partage, quelle exprience fondamentale peut l'instaurer en de de nos certitudes, l o elles naissent et se justifient ? Qui peut nous assurer qu'un mdecin du XVIIIe sicle ne voyait pas ce qu'il voyait, mais qu'il a suffi de quelques dizaines d'annes pour que les figures fantastiques se dissipent et que l'espace libr laisse venir jusqu'aux yeux la franche dcoupe des choses? Il n'y a pas eu de psychanalyse de la connaissance mdicale, ni de rupture plus ou moins spontane des investissements imaginaires ; la mdecine positive n'est pas celle qui a fait un choix objectal port enfin sur l'objectivit elle-mme, Toutes les puissances d'un espace visionnaire par o communiquaient mdecins et malades, physiologistes et praticiens (nerfs tendus et tordus, scheresse ardente, organes durcis ou brls, nouvelle naissance du corps dans l'lment bnfique de la fracheur et des eaux) n'ont pas disparu ; elles ont t dplaces plutt et comme encloses dans la singularit du malade, du ct de cette rgion des symptmes subjectifs qui dfinit pour le mdecin non plus le mode de la connaissance mais le monde (1) A. L. J. BAYLE, Nouvelle doctrine des maladies mentales (Paris, 1825), pp. 23-24. |PAGE VII des objets connatre. Le lien fantastique du savoir et de la souffrance, loin d'tre rompu, est assur par une voie plus complexe que la simple permabilit des imaginations ; la prsence de la maladie dans le corps, ses tensions, ses brlures, le monde sourd des
entrailles, tout l'envers noir du corps que tapissent de longs rves sans yeux sont la fois contests dans leur objectivit par le discours rducteur du mdecin et fonds comme autant d'objets pour son regard positif. Les figures de la douleur ne sont pas conjures au bnfice d'une connaissance neutralise ; elles ont t redistribues dans l'espace o se croisent les corps et les regards. Ce qui a chang, c'est la configuration sourde o le langage prend appui, le rapport de situation et de posture entre ce qui parle et ce dont on parle. Quant au langage lui-mme, partir de quel moment, de quelle modification smantique ou syntactique, peut-on reconnatre qu'il s'est rou en discours rationnel ? Quelle ligne dcisive est donc trace entre une description qui peint des membranes comme des parchemins tremps et cette autre, non moins qualitative, non moins mtaphorique qui voit, tales sur les enveloppes du cerveau, comme des pellicules de blanc d'oeuf ? Les feuillets blanchtres et rougetres de Bayle sont-ils, pour un discours scientifique, de valeur diffrente, de solidit et d'objectivit plus denses que les lamelles racornies dcrites par les mdecins du XVIIIe sicle ? Un regard un peu plus mticuleux, un parcours verbal plus lent et mieux appuy sur les choses, des valeurs pithtiques fines, parfois un peu brouilles, n'est-ce pas simplement, dans le langage mdical, la prolifration d'un style qui depuis la mdecine galnique a tendu, devant le gris des choses et de leurs formes, des plages de qualits ? Pour saisir la mutation du discours quand elle s'est produite, il faut sans doute interroger autre chose que les contenus thmatiques ou les modalits logiques, et s'adresser cette rgion o les choses et les mots ne sont pas encore spars, l o s'appartiennent encore, au ras du langage, manire de voir et manire de dire. Il faudra questionner la distribution originaire du visible et de l'invisible dans la mesure o elle est lie au partage de ce qui s'nonce et de ce qui est tu : alors apparatra, en une figure unique, l'articulation du langage mdical et de son objet. Mais de prsance, il n'y en a point pour qui ne se pose pas de question rtrospective ; seule mrite d'tre porte dans un jour dessein indiffrent la structure parl du peru, cet espace plein au creux duquel le langage prend son volume et |PAGE VIII sa mesure. Il faut se placer, et, une fois pour toutes, se maintenir au niveau de la spatialisation et de la verbalisation fondamentales` du
pathologique, l o prend naissance et se recueille le regard loquace que le mdecin pose sur le coeur vnneux des choses. La mdecine moderne a fix d'elle-mme sa date de naissance vers les dernires annes du XVIIIe sicle. Quand elle se prend rflchir sur elle-mme, elle identifie l'origine de sa positivit un retour, pardel toute thorie, la modestie efficace du peru. En fait, cet empirisme prsum repose non sur une redcouverte des valeurs absolues du visible, non sur l'abandon rsolu des systmes et de leurs chimres, mais sur une rorganisation de cet espace manifeste et secret qui fut ouvert lorsqu'un regard millnaire s'est arrt sur la souffrance des hommes. Le rajeunissement de la perception mdicale, l'illumination vive des couleurs et des choses sous le regard des premiers cliniciens n'est pourtant pas un mythe ; au dbut du XIXe sicle, les mdecins ont dcrit ce qui, pendant des sicles, tait rest au-dessous du seuil du visible et de l'nonable ; mais ce n'est pas qu'ils se soient remis percevoir aprs avoir trop longtemps spcul, ou couter la raison mieux que l'imagination ; c'est que le rapport du visible l'invisible, ncessaire tout savoir concret, a chang de structure et fait apparatre sous le regard et dans le langage ce qui tait en de et au-del de leur domaine. Entre les mots et les choses, une alliance nouvelle s'est noue, faisant voir et dire, et parfois dans un discours si rellement naf qu'il parait se situer un niveau plus archaque de rationalit, comme s'il s'agissait d'un retour un regard enfin matinal. En 1764, J. F. Meckel avait voulu tudier les altrations de l'encphale dans un certain nombre d'affections (apoplexie, manie, phtisie) ; il avait utilis la mthode rationnelle de la pese des volumes gaux et de leur comparaison pour dterminer quels secteurs du cerveau taient desschs, quels autres engorgs et dans quelles maladies. La mdecine moderne n'a peu prs rien retenu de ces recherches. La pathologie de l'encphale a inaugur pour nous sa forme positive lorsque Bichat et surtout Rcamier et Lallemand utilisrent le fameux marteau termin par une surface large et mince. En procdant petits coups, le crne tant plein, il ne peut en rsulter d'branlement susceptible de produire des dsordres. Il vaut mieux commencer par sa partie |PAGE IX postrieure, parce que, quand l'occipital reste seul casser, il est souvent si mobile que les coups portent faux... Chez les enfants trs jeunes, les os sont trop souples pour tre casss, trop minces pour
tre scis ; il faut les couper avec des ciseaux forts (1). Alors le fruit s'ouvre : sous la coque mticuleusement clate, quelque chose apparat, masse molle et gristre, enveloppe de peaux visqueuses nervure de sang, triste pulpe fragile en quoi rayonne, enfin libr, enfin donn au jour, l'objet du savoir. L'agilit artisanale du cassecrne a remplac la prcision scientifique de la balance, et pourtant c'est en celle-l que notre science depuis Bichat se reconnat ; le geste prcis, mais sans mesure qui ouvre pour le regard la plnitude des choses concrtes, avec le quadrillage menu de leurs qualits, fonde une objectivit plus scientifique pour nous que les mdiations instrumentales de la quantit. Les formes de la rationalit mdicale s'enfoncent dans l'paisseur merveilleuse de la perception, en offrant comme visage premier de la vrit le grain des choses, leur couleur, leurs taches, leur duret, leur adhrence. L'espace de l'exprience semble s'identifier au domaine du regard attentif, de cette vigilance empirique ouverte l'vidence des seuls contenus visibles. L'oeil devient le dpositaire et la source de la clart ; il a pouvoir de faire venir au jour une vrit qu'il ne reoit que dans la mesure o il lui a donn le jour ; en s'ouvrant, il ouvre le vrai d'une ouverture premire : flexion qui marque, partir du monde de la clart classique, le passage des a Lumires au XIXe sicle. Pour Descartes et Malebranche, voir, c'tait percevoir (et jusque sous les espces les plus concrtes de l'exprience : pratique de l'anatomie chez Descartes, observations microscopiques chez Malebranche) ; mais il s'agissait, sans dpouiller la perception de son corps sensible, de la rendre transparente pour l'exercice de l'esprit : la lumire, antrieure tout regard, tait l'lment de l'idalit, l'inassignable lieu d'origine o les choses taient adquates leur essence et la forme selon laquelle elles la rejoignaient travers la gomtrie des corps ; parvenu sa perfection, l'acte de voir se rsorbait dans la figure sans courbe ni dure de la lumire. A la fin du XVIIIe sicle, voir consiste laisser l'exprience sa plus grande opacit corporelle ; le solide, l'obscur, la densit des choses closes sur elles-mmes ont des pouvoirs de vrit qu'ils n'empruntent pas la lumire, mais (1) F. LALLEMAND, Recherches anatomo-pathologiques sur l'encphale (Paris, 1820), Introd., p. VII note. |PAGE X la lenteur du regard qui les parcourt, les contourne et peu peu les pntre en ne leur apportant, jamais que ~a propre clart. Le sjour
de la vrit dans le noyau sombre des choses est paradoxalement li ce pouvoir souverain du regard empirique qui met, leur nuit, jour. Toute la lumire est passe du ct du mince flambeau de l'oeil qui tourne maintenant autour des volumes et dit, dans ce chemin, leur lieu et, leur forme. Le discours rationnel s'appui moins sur la gomtrie de la lumire que sur l'paisseur insistante, indpassable de l'objet : en sa prsence obscure mais pralable tout savoir, se donnent la source, le domaine et la limite de l'exprience. Le regard est passivement li cette passivit premire qui le voue la tche infinie de la parcourir en son entier et de la matriser. Il appartenait ce langage des choses et. lui seul sans doute d'autoriser propos de l'individu un savoir qui ne ft pas simplement d'ordre historique ou esthtique. Que la dfinition de l'individu soit un labeur infini n'tait plus un obstacle pour une exprience qui, en acceptant ses propres limites, prolongeait sa tche dans l'illimit. La qualit singulire, l'impalpable couleur, la forme unique et transitoire, en acqurant le statut de l'objet, ont pris son poids et, sa solidit. Aucune lumire ne pourra plus les dissoudre dans les vrits idales ; mais l'application du regard, tour tour, les veillera et les fera valoir sur fond d'objectivit. Le regard n'est plus rducteur, mais fondateur de l'individu dans sa qualit irrductible. Et par l il devient possible d'organiser autour de lui un langage rationnel. L'objet du discours peut aussi bien tre un sujet, sans que les figures de l'objectivit soient pour autant altres. C'est cette rorganisation formelle et, en profondeur, plus que l'abandon des thories et des vieux systmes, qui a ouvert la possibilit d'une exprience clinique ; elle a lev le vieil interdit aristotlicien on pourra enfin tenir sur l'individu un discours structure scientifique. Cet accs l'individu, nos contemporains y voient l'instauration d'un colloque singulier et la formulation la plus serre d'un vieil humanisme mdical, aussi vieux que la piti des hommes. Les phnomnologies acphales de la comprhension mlent cette ide mal jointe le sable de leur dsert conceptuel; le vocabulaire faiblement rotis de la rencontre et du couple mdecin-malade s'extnue vouloir communiquer tant |PAGE XI de non-pense les ples pouvoirs d'une rverie matrimoniale. L'exprience clinique - cette ouverture, premire dans l'histoire occidentale, de l'individu concret au langage de la rationalit, cet vnement majeur dans le rapport de l'homme lui-' mme et du langage aux choses - a vite t prise pour un affrontement simple,
sans concept, d'un regard et d'un visage, d'un coup d'oeil et d'un corps muet, sorte de contact pralable tout discours et libre des embarras du langage, par quoi deux individus vivants sont c encags dans une situation commune mais non rciproque. Dans ses dernires secousses, la mdecine dite librale invoque son tour en faveur d'un march ouvert les vieux droits d'une clinique comprise comme contrat singulier et pacte tacite pass d'homme homme. On prte mme ce regard patient le pouvoir de rejoindre, par addition mesure de raisonnement - ni trop, ni trop peu -, la forme gnrale de tout constat scientifique : Pour pouvoir proposer chacun de nos malades un traitement parfaitement adapt sa maladie et luimme, nous cherchons avoir de son cas une ide objective et complte, nous rassemblons dans un dossier qui lui est personnel (son observation ) la totalit des renseignements dont nous disposons sur lui. Nous l'observons de la mme manire que nous observons les astres ou une exprience de laboratoire (1). Les miracles ne sont point si faciles : la mutation qui a permis et qui, tous les jours, permet encore que le lit du malade devienne champ d'investigation et de discours scientifiques n'est pas le mlange, tout coup dflagrant, d'une vieille habitude avec une logique plus ancienne encore, ou celle d'un savoir avec le bizarre compos sensoriel d'un tact , d'un coup d'oeil et d'un flair . La mdecine comme science clinique est apparue sous des conditions qui dfinissent, avec sa possibilit historique, le domaine de son exprience et la structure de sa rationalit. Elles en forment l'a priori concret qu'il est possible maintenant de faire venir au jour, peut-tre parce qu'une nouvelle exprience de la maladie est en train de natre, offrant sur celle qu'elle repousse dans le temps la possibilit d'une prise historique et critique. Mais un dtour ici est ncessaire pour fonder ce discours sur la naissance de la clinique. Discours trange, je le veux bien, puisqu'il ne veut s'appuyer ni sur la conscience actuelle des cliniciens, ni mme sur la rptition de ce qu'autrefois ils ont pu dire. Il est bien probable que nous appartenons un ge de critique dont l'absence d'une philosophie premire nous rappelle (1) J.-Ch. SOURNIA, Logique et morale du diagnostic (Paris, 1962), p. 19. |PAGE XII
chaque instant le rgne et la fatalit : ge d'intelligence qui nous tient irrmdiablement distance d'un langage originaire. Pour Kart, la possibilit d'une critique et sa ncessit taient lies, 'a travers certains contenus scientifiques, au fait qu'il y a de la connaissance. Elles sont lies de nos jours - et Nietzsche le philologue en tmoigne au fait qu'il y a du langage et que, dans les paroles sans nombre prononces par les hommes - qu'elles soient raisonnables ou insenses, dmonstratives ou potiques - un sens a pris corps qui nous surplombe, conduit notre aveuglement, mais attend dans l'obscurit notre prise de conscience pour venir jour et se mettre parler. Nous sommes vous historiquement l'histoire, la patiente construction de discours sur les discours, la tche d'entendre ce qui a t dj dit. Est-il fatal pour autant que nous ne connaissions d'autre usage de la parole que celui du commentaire ? Ce dernier, vrai dire, interroge le discours sur ce qu'il dit et a voulu dire ; il cherche faire surgir ce double fond de la parole, o elle se retrouve en une identit ellemme qu'on suppose plus proche de sa vrit ; il s'agit, en nonant ce qui a t dit, de redire ce qui n'a jamais t prononc. Dans cette activit de commentaire qui cherche faire passer un discours resserr, ancien et comme silencieux lui-mme dans un autre plus bavard, la fois plus archaque et plus contemporain, se cache une trange attitude l'gard du langage : commenter, c'est admettre par' dfinition un excs du signifi sur le signifiant, un reste ncessairement non formul de la pense que le langage a laiss dans l'ombre, rsidu qui en est l'essence elle-mme, pousse hors de son secret ; mais commenter suppose aussi que ce non-parl dort dans la parole, et que, par une surabondance propre au signifiant, on peut en l'interrogeant faire parler un contenu qui n'tait pas explicitement signifi. Cette double plthore, en ouvrant la possibilit du commentaire, nous voue une tche infinie que rien ne peut limiter : il y a toujours du signifi qui demeure et auquel il faut encore donner la parole ; quant au signifiant, il est toujours offert en une richesse qui nous interroge malgr nous sur ce qu'elle veut dire . Signifiant et signifi prennent ainsi une autonomie substantielle qui assure chacun d'eux isolment le trsor d'une signification virtuelle ; la limite, l'un pourrait exister sans l'autre et se mettre parler de lui-mme : le commentaire se loge dans cet espace suppos. Mais en mme temps, il invente entre eux un lien complexe, toute une trame indcise qui met en jeu les valeurs potiques de l'expression : le signifiant n'est pas cens traduire H sans cacher, |PAGE XIII
et sans laisser le signifi dans une inpuisable rserve ; le signifi ne se dvoile que dans le monde visible et lourd d'un signifiant charg lui-mme d'un sens qu'il ne matrise pas. Le commentaire repose sur ce postulat que la parole est acte de traduction , qu'elle a le privilge dangereux des images de montrer en cachant, et qu'elle peut indfiniment tre substitue elle-mme dans la srie ouverte des reprises discursives ; bref, il repose sur une interprtation du langage qui porte assez clairement la marque de son origine historique : l'Exgse, qui coute, travers les interdits, les symboles, les images sensibles, travers tout l'appareil de la Rvlation, le Verbe de Dieu, toujours secret, toujours au-del de luimme. Nous commentons depuis des annes le langage, de notre culture de ce point prcisment o nous avions attendu en vain, pendant des sicles, la dcision de la Parole. Traditionnellement, parler sur la pense des autres, chercher dire ce qu'ils ont dit, c'est faire une analyse du signifi. Mais est-il ncessaire que les choses dites, ailleurs et par d'autres, soient exclusivement traites selon le jeu du signifiant et du signifi ? N'est-il pas possible de faire une analyse des discours qui chapperait la fatalit du commentaire en ne supposant nul reste, nul excs en ce qui a t dit, mais le seul fait de sont apparition historique ? Il faudrait alors traiter les faits de discours, non pas comme des noyaux autonomes de significations multiples, mais comme des vnements et des segments fonctionnels, formant systme de proche en proche. Le sens d'un nonc ne serait pas dfini par le trsor d'intentions qu'il contiendrait, le rvlant et le rservant la fois, mais par la diffrence qui l'articule sur les autres noncs rels et possibles, qui lui sont contemporains ou auxquels il s'oppose dans la srie linaire du temps. Alors apparatrait l'histoire systmatique des discours. Jusqu' prsent, l'histoire des ides ne connaissait gure que deux mthodes. L'une, esthtique, tait celle de l'analogie - d'une analogie dont on suivait les voies de diffusion dans le temps (genses, filiations, parents, influences) ou la surface d'une plage historique dtermine (l'esprit d'une poque, sa Weltanschauung, ses catgories fondamentales, l'organisation de son monde socioculturel). L'autre, psychologique, tait celle de la dngation des contenus (tel sicle ne fut pas aussi rationaliste, ou irrationaliste qu'il le disait et qu'on l'a cru), par quoi s'inaugure et se dveloppe une sorte de psychanalyse des penses dont le terme est de plein droit rversible - le noyau du noyau tant toujours son contraire. On voudrait essayer ici l'analyse d'un type de discours |PAGE XIV
- celui de l'exprience mdicale - une poque o, avant les grandes dcouvertes du XIXe sicle, il a modifi moins ses matriaux que sa forme systmatique. La clinique, c'est la fois une nouvelle dcoupe des choses, et le principe de leur articulation dans un langage o nous avons coutume de reconnatre le langage d'une science positive . A qui voudrait en faire l'inventaire thmatique, l'ide de clinique apparatrait sans doute charge de valeurs assez floues ; on y dchiffrerait probablement des figures incolores comme l'effet singulier de la maladie sur le malade, la diversit des tempraments individuels, la probabilit de l'volution pathologique, la ncessit d'une perception aux aguets, inquite des moindres modalits visibles, la forme empirique, cumulative et indfiniment ouverte du savoir mdical : autant de vieilles notions depuis longtemps usages, et qui formaient dj, n'en pas douter, l'quipement de la mdecine grecque. Rien, dans ce vieil arsenal ne peut dsigner clairement ce qui s'est pass au dtour du XVIIIe sicle quand la remise en jeu de l'ancien thme clinique a produit , s'il faut en croire des apparences htives, une mutation essentielle dans le savoir mdical. Mais, considre dans sa disposition d'ensemble, la clinique apparat comme un nouveau profil, pour l'exprience du mdecin, du perceptible et de l'nonable : nouvelle distribution des lments discrets de l'espace corporel (isolement, par exemple, du tissu plage fonctionnelle deux dimensions, qui s'oppose la masse fonctionnante de l'organe et constitue le paradoxe d'une surface intrieure ), rorganisation des lments constituant le phnomne pathologique (une grammaire des signes s'est substitue une botanique des symptmes), dfinition des sries linaires d'vnements morbides (par opposition au buissonnement des espces nosologiques), articulation de la maladie sur l'organisme (disparition des entits morbides gnrales qui groupaient des symptmes en une figure logique, au profit d'un statut local qui situe l'tre de la maladie avec ses causes et ses effets dans un espace trois dimensions). L'apparition de la clinique, comme fait historique, doit tre identifie au systme de ces rorganisations. Cette nouvelle structure est signale, mais n'est pas puise bien sr, par le changement infime et dcisif qui a substitu la question : Qu'avez-vous ? par quoi s'inaugurait au XVIIIe sicle le dialogue du mdecin et du malade avec sa grammaire et son style propres, cette autre o nous reconnaissons le jeu de la clinique et le principe de tout son discours : O avez-vous mal ? . A partir de l, tout le rapport du signifiant
|PAGE XV au signifi se redistribue, et, ceci tous les niveaux de l'exprience mdicale : entre les symptmes qui signifient, et, la maladie qui est signifie, entre la description et ce qu'elle dcrit, entre l'vnement et ce qu'il pronostique, entre la lsion et le mal qu'elle signale, etc. La clinique, invoque sans cesse pour son empirisme, la modestie de son attention et le soin avec lequel elle laisse venir silencieusement les choses sous le regard, sans les troubler d'aucun discours, doit sa relle importance au fait qu'elle est une rorganisation en profondeur non seulement des connaissances mdicales, mais de la possibilit mme d'un discours sur la maladie. La retenue du discours clinique (proclame par les mdecins : refus de la thorie, abandon des systmes, non-philosophie) renvoie aux conditions non verbales partir de quoi il peut parler : la structure commune qui dcoupe et articule ce qui se voit et ce qui se dit. La recherche ici entreprise implique donc le projet dlibr d'tre la fois historique et critique, dans la mesure o il s'agit, hors de toute intention prescriptive, de dterminer les conditions de possibilit de l'exprience mdicale telle que l'poque moderne l'a connue. Une fois pour toutes, ce livre n'est pas crit pour une mdecine contre une autre, ou contre la mdecine pour une absence de mdecine. Ici, comme ailleurs, il s'agit d'une tude qui essaie de dgager dans l'paisseur du discours les conditions de son histoire. Ce qui compte dans les choses dites par les hommes, ce n'est pas tellement ce qu'ils auraient pens en de ou au-del d'elles, mais ce qui d'entre de jeu les systmatise, les rendant pour le reste du temps, indfiniment accessibles de nouveaux discours et ouvertes la tche de les transformer. |PAGE 1 CHAPITRE PREMIER espaces et classes Pour nos yeux dj uss, le corps humain constitue, par droit de nature, l'espace d'origine et de rpartition de la maladie espace dont les lignes, les volumes, les surfaces et les chemins sont fixs, selon une gographie maintenant familire, par l'atlas anatomique. Cet ordre du corps solide et visible n'est cependant qu'une des manires pour la mdecine de spatialiser la maladie. Ni la
premire sans doute, ni la plus fondamentale. Il y a eu et il y aura des distributions du mal qui sont autres. Quand pourra-t-on dfinir les structures que suivent, dans le volume secret du corps, les ractions allergiques ? A-t-on mme jamais fait la gomtrie spcifique d'une diffusion de virus dans la mince lame d'un segment tissulaire ? Est-ce dans une anatomie euclidienne que ces phnomnes peuvent trouver la loi de leur spatialisation ? Et il suffirait de rappeler, aprs tout, que la vieille thorie des sympathies parlait un vocabulaire de correspondances, de voisinages, d'homologies : termes pour lesquels l'espace peru de l'anatomie n'offre gure de lexique cohrent. Chaque grande pense dans le domaine de la pathologie prescrit la maladie une configuration dont les requisits spatiaux ne sont pas forcment ceux de la gomtrie classique. La concidence exacte du corps de la maladie et du corps de l'homme malade n'est sans doute qu'une donne historique et transitoire. Leur vidente rencontre ne l'est que pour nous, ou plutt nous commenons peine nous en dtacher. L'espace de configuration de la maladie et l'espace de localisation du mal dans le corps n'ont t superposs, dans l'exprience mdicale, que pendant une courte priode : celle qui concide avec la mdecine du XIXe sicle et les privilges accords l'anatomie pathologique. |PAGE 2 Epoque qui marque la suzerainet du regard, puisque dans le mme champ perceptif, en suivant les mmes continuits ou les mmes failles, l'exprience lit d'un coup les lsions visibles de l'organisme et la cohrence des formes pathologiques ; le mal s'articule exactement sur le corps, et sa distribution logique se fait d'entre de jeu par masses anatomiques. Le coup d'oeil n'a plus qu' exercer sur la vrit qu'il dcouvre l o elle est un pouvoir qu'il dtient de plein droit. Mais comment s'est form ce droit qui se donne pour immmorial et naturel ? Comment ce lieu o se signale la maladie a-t-il pu souverainement dterminer la figure qui en groupe les lments ? Paradoxalement, jamais l'espace de configuration de la maladie ne fut plus libre, plus indpendant de son espace de localisation que dans la mdecine classificatrice, c'est--dire dans cette forme de pense mdicale qui, dans la chronologie, a prcd de peu la mthode anatomo-clinique, et l'a rendue, historiquement, possible.
Ne traitez jamais une maladie sans vous tre assur de l'espce, disait Gilibert (1). De la Nosologie de Sauvages (1761) la Nosographie de Pinel (1798), la rgle classificatrice domine la thorie mdicale et jusqu' la pratique : elle apparat comme la logique immanente des formes morbides, le principe de leur dchiffrement et la rgle smantique de leur dfinition : N'coutez donc point ces envieux qui ont voulu jeter l'ombre du mpris sur les crits du clbre Sauvages... Souvenez-vous qu'il est peut-tre de tous les mdecins qui ont vcu celui qui a soumis tous nos dogmes aux rgles infaillibles de la saine logique. Voyez avec quelle attention il dfinit les mots, avec quel scrupule il circonscrit les dfinitions de chaque maladie. Avant d'tre prise dans l'paisseur du corps, la maladie reoit une organisation hirarchise en familles, genres et espces. Apparemment, il ne s'agit que d'un tableau permettant de rendre sensible l'apprentissage et la mmoire le domaine foisonnant des maladies. Mais plus profondment que cette mtaphore spatiale et pour la rendre possible, la mdecine classificatrice suppose une certaine configuration de la maladie : elle n'a jamais t formule pour elle-mme, mais on peut en dfinir aprs coup les requisits essentiels. De mme que l'arbre gnalogique, en de de la comparaison qu'il comporte et de tous ses thmes imaginaires, suppose un espace o la parent est formalisable, le tableau nosologique implique une figure des (1) GILIBERT, L'anarchie mdicinale (Neuchtel, 1772), t. I, p. 198. |PAGE 3 maladies qui n'est ni l'enchanement des effets et des causes, ni la srie chronologique des vnements ni son trajet visible dans le corps humain. Cette organisation dcale vers les problmes subalternes la localisation dans l'organisme, mais dfinit un systme fondamental de relations qui mettent en jeu des enveloppements, des subordinations, des partages, des ressemblances. Cet espace comporte : une verticale o buissonnent les implications - la fivre concours de froid et de chaleur successive peut se drouler en un seul pisode, ou en plusieurs ; ceux-ci peuvent se suivre sans interruption ou aprs un intervalle ; ce rpit peut ne pas excder 12 heures, atteindre une journe, durer deux jours entiers, ou encore avoir un rythme mal dfinissable (1) ; et une horizontale o se transfrent les homologies - dans les deux grands embranchements de spasmes, on trouve, selon une symtrie parfaite, les toniques
partiels , les toniques gnraux , les cloniques partiels et les cloniques gnraux (2) ; ou encore dans l'ordre des panchements, ce que le catarrhe est la gorge, la dysenterie l'est l'intestin (3). Espace profond, antrieur toutes perceptions, et qui de loin les commande ; c'est partir de lui, des lignes qu'il croise, des masses qu'il distribue ou hirarchise, que la maladie, mergeant sous le regard, insre ses caractres propres dans un organisme vivant. Quels sont les principes de cette configuration primaire de la maladie ? 1. Selon les mdecins du XVIIIe sicle elle se donne dans une i exprience historique , par opposition au savoir philosophique . Est historique la connaissance qui circonscrit la pleursie par ses quatre phnomnes : fivre, difficult de respirer, toux et douleur de ct. Sera philosophique la connaissance qui met en question l'origine, le principe, les causes : refroidissement, panchement sreux, inflammation de la plvre. La distinction de l'historique et du philosophique n'est pourtant pas celle de la cause et de l'effet : Cullen fonde son systme classificateur sur l'assignation des causes prochaines ; ni celle du principe et des consquences puisque Sydenham pense faire recherche historique en tudiant la manire dont la nature produit et entretient (1) F B0ISSIER DE SAUVAGES, Nosologie mthodique (Lyon, 1772, t. II. (2) Ibid., t. III. (3) W. CULLEN, Institutions de mdecine pratique (trad., Paris, 1785), t. II, pp. 39-60. |PAGE 4 les diffrentes formes de maladies (1) ; ni mme exactement la diffrence du visible et du cach ou du conjectural puisqu'il faut parfois traquer une histoire qui se replie et se drobe un premier examen, comme la fivre hectique chez certains phtisiques : cueils cachs sous l'eau (2). L'historique rassemble tout ce qui, en fait ou en droit, tt ou tard, de plein fouet ou indirectement peut tre donn au regard. Une cause qui se voit, un symptme qui peu peu se dcouvre, un principe lisible ds sa racine ne sont pas de l'ordre du savoir philosophique , mais d'un savoir trs simple , qui doit prcder tous les autres , et qui situe la forme originaire de l'exprience mdicale. Il s'agit de dfinir une sorte de plage fondamentale o les perspectives se nivellent et o les dcalages sont aligns : l'effet a le mme statut que sa cause, l'antcdent
concide avec ce qui le suit. Dans cet espace homogne les enchanements se dnouent et le temps s'crase : une inflammation locale n'est pas autre chose que la juxtaposition idale de ses lments historiques (rougeur, tumeur, chaleur, douleur) sans que vienne en question leur rseau de dterminations rciproques ou leur entrecroisement temporel. La maladie est perue fondamentalement dans un espace de projection sans profondeur, et de concidence sans droulement. Il n'y a qu'un plan et qu'un instant. La forme sous laquelle se montre originairement la vrit, c'est la surface o le relief la fois se manifeste et s'abolit - le portrait : Il faut que celui qui crit l'histoire des maladies... observe avec attention les phnomnes clairs et naturels des maladies quelque peu intressants qu'ils lui paraissent. Il doit en cela imiter les peintres qui lorsqu'ils font un portrait ont soin de marquer jusqu'aux signes et aux plus petites choses naturelles, qui se rencontrent sur le visage du personnage qu'ils peignent (3). La structure premire que se donne la mdecine classificatrice, c'est l'espace plat du perptuel simultan. Table et tableau. 2. C'est un espace o les analogies dfinissent les essences. Les tableaux sont ressemblants, mais ils se ressemblent aussi. D'une maladie l'autre, la distance qui les spare se mesure au seul dgrad de leur ressemblance sans mme qu'intervienne l'cart logico-temporel de la gnalogie. Disparition des mouvements volontaires, assoupissement de la sensibilit intrieure ou extrieure, (1) Th. SYDENHAM, Mdecine pratique (trad. JAULT, Paris, 1784), p. 390 (2) Ibid. (3) Th. SYDENHAM cit par SAUVAGES (loc. cit., t. I, p. 88). |PAGE 5 c'est le profil gnral qui se dcoupe sous des formes particulires comme l'apoplexie, la syncope, la paralysie. A l'intrieur de cette grande parent, des carts mineurs s'tablissent : l'apoplexie fait perdre l'usage de tous les sens, et de toute la motricit volontaire, mais elle pargne la respiration et les mouvements cardiaques ; la paralysie, elle, ne porte que sur un secteur localement assignable de la sensibilit et de la motricit ; la syncope est gnrale comme l'apoplexie, mais elle interrompt les mouvements respiratoires (1). La distribution perspective qui nous fait voir dans la paralysie un symptme, dans la syncope un pisode, dans l'apoplexie une atteinte
organique et fonctionnelle, n'existe pas pour le regard classificateur qui est sensible aux seules rpartitions de surface o le voisinage n'est pas dfini par des distances mesurables, mais par des analogies de formes. Quand elles deviennent assez denses, ces analogies franchissent le seuil de la simple parent et accdent l'unit d'essence. Entre une apoplexie qui suspend d'un coup la motricit, et les formes chroniques et volutives qui gagnent peu peu tout le systme moteur, pas de diffrence fondamentale : dans cet espace simultan o les formes distribues par le temps se rejoignent et se superposent, la parent se recroqueville en identit. Dans un monde plat, homogne, non mtrique, il y a maladie essentielle l o il y a plthore d'analogies. 3. La forme de l'analogie dcouvre l'ordre rationnel des maladies. Quand on peroit une ressemblance, on ne fixe pas simplement un systme de reprages commodes et relatifs ; on commence dchiffrer l'ordonnancement intelligible des maladies. Le voile se lve sur le principe de leur cration : c'est l'ordre gnral de la nature. Comme pour la plante ou l'animal, le jeu de la maladie est, fondamentalement, spcifique : L'Etre suprme ne s'est pas assujetti des lois moins certaines en produisant les maladies ou en mrissant les humeurs morbifiques qu'en croisant les plantes et les animaux... Celui qui observera attentivement l'ordre, le temps, l'heure o commence l'accs de fivre quarte, les phnomnes de frisson, de chaleur, en un mot tous les symptmes qui lui sont propres, aura autant de raisons de croire que cette maladie est une espce qu'il en a de croire qu'une plante constitue une espce parce qu'elle croit, fleurit et prit toujours de la mme manire a (2). Double importance, pour la pense mdicale, de ce modle (1) W. CULLEN, Mdecine pratique (tract. fr., Paris, 1785), t. II, p. 86. (2) SYDENHAM cit par SAUVAGES (loc. cit., t. I, pp. 124-125.) |PAGE 6 botanique. Il a permis d'abord le retournement du principe d'analogie des formes en loi de production des essences : aussi l'attention perceptive du mdecin qui, ici et l, retrouve et apparente, communique de plein droit avec l'ordre ontologique qui organise de l'intrieur, et avant toute manifestation, le monde de la maladie. L'ordre de la maladie n'est d'autre part qu'un dcalque du monde de la vie : les mmes structures rgnent ici et l, les mmes formes de rpartition, la mme ordonnance. La rationalit de la vie est identique
la rationalit de ce qui la menace. Elles ne sont pas, l'une par rapport l'autre, comme la nature et la contre-nature ; mais, dans un ordre naturel qui leur est commun, elles s'embotent et se superposent. Dans la maladie, on reconnat la vie puisque c'est la loi de la vie qui fonde, de surcrot, la connaissance de la maladie. 4. Il s'agit d'espces la fois naturelles et idales. Naturelles puisque les maladies y noncent leurs vrits essentielles ; idales dans la mesure o elles ne sont jamais donnes dans l'exprience sans altration ni trouble. La perturbation premire est apporte avec et par le malade luimme. A la pure essence nosologique, que fixe et puise sans rsidu sa place dans l'ordre des espces, le malade ajoute, comme autant de perturbations, ses dispositions, son ge, son mode de vie, et toute une srie d'vnements qui, par rapport au noyau essentiel, font figure d'accidents. Pour connatre la vrit du fait pathologique, le mdecin doit abstraire le malade : Il faut que celui qui dcrit une maladie ait soin de distinguer les symptmes qui l'accompagnent ncessairement et qui lui sont propres, de ceux qui ne sont qu'accidentels et fortuits, tels que ceux qui dpendent du temprament et de l'ge du malade (1). Paradoxalement, le patient n'est pas rapport ce dont il souffre qu'un fait extrieur ; la lecture mdicale ne doit le prendre en considration que pour le mettre entre parenthses. Certes, il faut connatre la structure interne de nos corps ; mais pour la soustraire plutt, et librer sous le regard du mdecin la nature et la combinaison des symptmes, des crises, et des autres circonstances qui accompagnent les maladies n (2). Ce n'est pas le pathologique qui fonctionne, par rapport la vie, comme une contre-nature, mais le malade par rapport la maladie ellemme. Le malade, mais aussi le mdecin. Son intervention est (1) SYDENHAM, cit ibid. (2) CLIFTON, Mal de la mdecine ancienne et moderne (trad. fr., Paris, 1742), p. 213. |PAGE 7 violence, si elle n'est pas strictement soumise l'ordonnance idale de la nosologie : La connaissance des maladies est la boussole du mdecin ; le succs de la gurison dpend d'une exacte connaissance de la maladie ; le regard du mdecin ne s'adresse pas initialement
ce corps concret, cet ensemble visible, cette plnitude positive qui est en face de lui, le malade ; ruais des intervalles de nature, des lacunes et des distances, o apparaissent comme en ngatif les signes qui diffrencient une maladie d'une autre, la vraie de la fausse, la lgitime de la btarde, la maligne de la bnigne (1). Grille qui cache le malade rel, et retient toute indiscrtion thrapeutique. Administr trop tt, dans une intention polmique, le remde contredit et brouille l'essence de la maladie ; il l'empche d'accder sa vraie nature, et en la rendant irrgulire, il la rend intraitable. Dans la priode d'invasion, le mdecin doit seulement retenir son souffle, car les commencements de la maladie sont faits pour faire connatre sa classe, son genre et son espce ; quand les symptmes s'accroissent et prennent de l'ampleur, il suffit de diminuer leur violence et celle des douleurs ; dans la priode d'tat, il faut suivre pas pas les routes que prend la nature , la renforcer si elle est trop faible, mais la diminuer si elle s'attache trop vigoureusement dtruire ce qui l'incommode (2). Dans l'espace rationnel de la maladie, mdecins et malades ne sont pas impliqus de plein droit ; ils sont tolrs comme autant de brouillages difficiles viter : le rle paradoxal de la mdecine consiste surtout les neutraliser, maintenir entre eux le maximum de distance pour que la configuration idale de la maladie, dans le vide qui se creuse de l'un l'autre, devienne forme concrte, libre, totalise enfin en un tableau immobile, simultan, sans paisseur ni secret o la reconnaissance s'ouvre d'elle-mme sur l'ordre des essences. La pense classificatrice se donne un espace essentiel. La maladie n'existe qu'en lui, puisqu'il la constitue comme nature ; et pourtant elle apparat toujours un peu dcale par rapport lui puisqu'elle s'offre chez un malade rel, aux yeux d'un mdecin pralablement arm. Le bel espace plan du portrait, c'est la fois l'origine et le rsultat dernier : ce qui rend possible, la racine, un savoir mdical rationnel et certain, et ce vers quoi (1) FRIER, Guide pour la conservation de l'homme (Grenoble, 1789), p. 113. (2) T. GUINDANT, La nature opprime par la mdecine moderne (Paris, 1768), pp. 10-11. |PAGE 8
sans cesse il doit s'acheminer travers ce qui le drobe la vue. Il y a donc tout un travail de la mdecine qui consiste rejoindre sa propre condition, mais par un chemin o elle doit effacer chacun de ses pas puisqu'elle atteint son but en neutralisant non seulement les cas sur lesquels elle s'appuie, mais sa propre intervention. D'o l'trange caractre du regard mdical ; il est pris dans une spirale indfinie : il s'adresse ce qu'il y a de visible en la maladie -mais partir du malade qui cache ce visible en le montrant ; par consquent il doit reconnatre pour connatre. Et ce regard, en progressant, recule puisqu'il ne va jusqu' la vrit de la maladie qu'en la laissant gagner sur lui, en s'esquivant lui-mme et en permettant au mal d'achever lui-mme, dans ses phnomnes, sa nature. La maladie, reprable sur le tableau, apparat travers le corps. L, elle rencontre un espace dont la configuration est foute diffrente : c'est celui des volumes et des masses. Ses contraintes dfinissent les formes visibles que prend le mal dans un organisme malade : la manire dont il s'y rpartit, s'y manifeste, progresse en altrant les solides, les mouvements ou les fonctions, provoque des lsions visibles l'autopsie, dclenche, en un point ou en un autre, le jeu des symptmes, provoque des ractions et par l s'oriente vers une issue fatale ou favorable. Il s'agit de ces figures complexes et drives par lesquelles l'essence de la maladie, avec sa structure en tableau, s'articule sur le volume pais et dense de l'organisme et prend corps en lui. Comment l'espace plat, homogne des classes peut-il devenir visible dans un systme gographique de masses diffrencies par leur volume et leur distance ? Comment une maladie, dfinie par sa place dans une famille, peut-elle se caractriser par son sige dans un organisme ? C'est le problme de ce qu'on pourrait appeler la spatialisation secondaire du pathologique. Pour la mdecine classificatrice, l'atteinte d'un organe n'est jamais absolument ncessaire pour dfinir une maladie : celle-ci peut aller d'un point de localisation l'autre, gagner d'autres surfaces corporelles, tout en restant identique de nature. L'espace du corps et l'espace de la maladie ont latitude de glisser l'un par rapport l'autre. Une seule et mme affection spasmodique peut se dplacer du bas-ventre o elle provoquera des dyspepsies, des engorgements viscraux, des interruptions du flux menstruel ou hmorrodal, vers la poitrine avec touffements, palpitations, |PAGE 9
sensation de boule dans la gorge, quintes de toux, et finalement gagner la tte en provoquant des convulsions pileptiques, des syncopes ou des sommeils comateux (1). Ces glissements, qu'accompagnent autant de modifications symptomatiques, peuvent se produire avec le temps chez un seul individu ; on peut les retrouver aussi en examinant une srie d'individus o les points d'accrochage sont diffrents : sous sa forme viscrale, le spasme se rencontre surtout chez les sujets lymphatiques, sous sa forme crbrale, chez les sanguins. Mais de toute faon, la configuration pathologique essentielle n'est pas altre. Les organes sont les supports solides de la maladie ; jamais ils n'en forment les conditions indispensables. Le systme de points qui dfinit le rapport de l'affection l'organisme n'est ni constant ni ncessaire. Ils n'ont pas d'espace commun pralablement dfini. Dans cet espace corporel o elle circule librement, la maladie subit mtastases et mtamorphoses. Le dplacement la remodle en partie. Un saignement de nez peut devenir hmoptysie ou hmorragie crbrale ; seule doit subsister la forme spcifique de l'panchement sanguin. C'est pourquoi la mdecine des espces a eu, tout au long de sa carrire, partie lie avec la doctrine des sympathies - les deux conceptions ne pouvant que se renforcer l'une l'autre pour le juste quilibre du systme. La communication sympathique travers l'organisme est parfois assure par un relais localement assignable (le diaphragme pour les spasmes, ou l'estomac pour les engorgements d'humeur) ; parfois par tout un systme de diffusion qui rayonne dans l'ensemble du corps (systme nerveux pour les douleurs et les convulsions, systme vasculaire pour les inflammations) ; dans d'autres cas par une simple correspondance fonctionnelle (une suppression des excrtions se communique des intestins aux reins, de ceux-ci la peau) ; enfin par un ajustement de la sensibilit d'une rgion l'autre (douleurs lombaires dans l'hydrocle). Mais qu'il y ait correspondance, diffusion ou relais, la redistribution anatomique de la maladie ne modifie pas sa structure essentielle ; la sympathie assure le jeu entre l'espace de localisation et l'espace de configuration : elle dfinit leur libert rciproque et les limites de cette libert. Plutt que limite, il faudrait dire seuil. Car au-del du transfert sympathique et de l'homologie qu'il autorise, un rapport peut s'tablir de maladie maladie qui est de causalit sans tre de parent. Une forme pathologique peut en engendrer (1) Encyclopdie, article Spasme |PAGE 10
une autre, trs loigne sur le tableau nosologique, par une force de cration qui lui est propre. Le corps est le lieu d'une juxtaposition, d'une succession, d'un mlange d'espces diffrentes. D'o les complications ; d'o les formes mixtes ; d'o certaines successions rgulires ou du moins frquentes, comme entre la manie et la paralysie. Haslam connaissait ces malades dlirants chez qui la parole est embarrasse, la bouche dvie, les bras ou les jambes privs de mouvements volontaires, la mmoire affaiblie et qui, le plus souvent, n'ont pas conscience de leur position (1). Imbrication des symptmes, simultanit de leurs formes extrmes : tout cela ne suffit pas former une seule maladie ; l'loignement entre l'excitation verbale et cette paralysie motrice dans le tableau des parents morbides empche que la proximit chronologique ne l'emporte et dcide de l'unit. D'o l'ide d'une causalit, qui se manifeste dans un lger dcalage temporel ; tantt le dclenchement maniaque apparat le premier ; tantt les signes moteurs introduisent l'ensemble symptomatique : Les affections paralytiques sont une cause de folie beaucoup plus frquente qu'on ne le croit ; et elles sont aussi un effet trs courant de la manie. Aucune translation sympathique ne peut ici franchir l'cart des espces ; et la solidarit des symptmes dans l'organisme ne subit pas constituer une unit qui rpugne aux essences. Il y a donc une causalit inter-nosologique, dont le rle est inverse de la sympathie : celle-ci conserve la forme fondamentale en parcourant le temps et l'espace ; la causalit assure les simultanits et les entrecroisements qui mlangent les purets essentielles. Le temps, dans cette pathologie, joue un rle limit. On admet qu'une maladie puisse durer, et que dans ce droulement des pisodes puissent, chacun leur tour, apparatre ; depuis Hippocrate on calcule les jours critiques ; on connat les valeurs significatives des pulsations artrielles : Lorsque le pouls rebondissant parat chaque trentime pulsation, ou environ, l'hmorragie survient quatre jours aprs, quelque peu plus tt ou plus tard ; lorsqu'il survient chaque seizime pulsation, l'hmorragie arrive dans trois jours... Enfin, quand il revient chaque quatrime, troisime, seconde pulsation ou lorsqu'il est continuel, on doit attendre l'hmorragie dans l'espace de vingt-quatre heures (2). Mais cette dure numriquement fixe fait partie (1) J. HASLAM, Observations on madness (Londres, 1798), p. 259. (2) Fr. SOLANO DE LUQUES, Observations nouvelles et extraordinaires sur la prdiction des crises, enrichies de plusieurs cas nouveaux par NIHELL (trad. fr., Paris, 1748) p. 2.
|PAGE 11 de la structure essentielle de la maladie, comme il appartient au catarrhe chronique de devenir au bout d'un certain temps fivre phtisique. Il n'y a pas un processus d'volution, o la dure apporterait d'elle-mme et par sa seule insistance des vnements nouveaux ; le temps est intgr comme constante nosologique, il ne l'est pas comme variable organique. Le temps du corps n'inflchit pas et dtermine moins encore le temps de la maladie. Ce qui fait communiquer le corps essentiel de la maladie avec le corps rel du malade, ce ne sont donc ni les points de localisation, ni les effets de la dure ; c'est plutt la qualit. Meckel, dans une des expriences relates l'Acadmie royale de Prusse en 1764, explique comment il observe l'altration de l'encphale dans diffrentes maladies. Quand il fait une autopsie, il prlve sur le cerveau de petits cubes de volume gal (6 lignes de ct) en diffrents endroits de la masse crbrale : il compare ces prlvements entre eux, et avec ceux oprs sur d'autres cadavres. L'instrument prcis de cette comparaison, c'est la balance ; dans la phtisie, maladie d'puisement, le poids spcifique du cerveau est relativement plus faible que dans les apoplexies, maladies d'engorgement (1 dr 3 gr 3/4 contre 1 dr 6 ou 7 gr) ; alors que chez un sujet normal, mort naturellement, le poids moyen est 1 dr 5 gr. Selon les rgions de l'encphale ces poids peuvent varier : dans la phtisie c'est surtout le cervelet qui est lger, dans l'apoplexie les rgions centrales qui sont lourdes (1). Il y a donc, entre la maladie et l'organisme, des points de raccord bien situs, et selon un principe rgional ; mais il s'agit seulement des secteurs o la maladie scrte ou transpose ses qualits spcifiques : le cerveau des maniaques est lger, sec et friable puisque la manie est une maladie vive, chaude, explosive ; celui des phtisiques sera puis et languissant, inerte, exsangue, puisque la phtisie se range dans la classe gnrale des hmorragies. L'ensemble qualificatif qui caractrise la maladie se dpose dans un organe qui sert alors de support aux symptmes. La maladie et le corps ne communiquent que par l'lment non spatial de la qualit. On comprend dans ces conditions que la mdecine se dtourne d'une certaine forme de connaissance que Sauvages dsignait comme mathmatique : Connatre les quantits et savoir les mesurer, par exemple dterminer la force et la vitesse du pouls, le degr de la chaleur, l'intensit de la douleur, la violence de (1) Compte rendu in Gazette salutaire, t. XXI, 2 aot 1764.
|PAGE 12 la toux et de tels autres symptmes (1). Si Meckel mesurait, ce n'tait pas pour accder une connaissance de forme mathmatique ; il s'agissait pour lui de jauger l'intensit d'une certaine qualit pathologique en quoi consistait la maladie. Aucune mcanique mesurable du corps ne peut, dans ses particularits physiques ou mathmatiques, rendre compte d'un phnomne pathologique ; les convulsions sont peut-tre dtermines par un asschement et un rtrcissement du systme nerveux - ce qui est bien de l'ordre de la mcanique, mais d'une mcanique des qualits qui s'enchanent, des mouvements qui s'articulent, des bouleversements qui se dclenchent en srie, non d'une mcanique de segments quantifiables. Il peut s'agir d'un mcanisme, mais qui ne relve pas de la Mcanique. . Les mdecins doivent se borner connatre les forces des mdicaments et des maladies au moyen de leurs oprations ; ils doivent les observer avec soin et s'tudier en connatre les lois, et ne point se fatiguer la recherche des causes physiques (2). La perception de la maladie dans le malade suppose donc un regard qualitatif ; pour saisir la maladie, il faut regarder l o il y a scheresse, ardeur, excitation, l o il y a humidit, engorgement, dbilit. Comment distinguer sous la mme fivre, sous la mme toux, sous le mme puisement, la pleursie de la phtisie, si on ne reconnat pas l une inflammation sche des poumons, et l un panchement sreux ? Comment distinguer, sinon par leur qualit, les convulsions d'un pileptique qui souffre d'une inflammation crbrale, et celles d'un hypocondriaque atteint d'un engorgement des viscres ? Perception dlie des qualits, perception des diffrences d'un cas l'autre, perception fine des variantes - il faut toute une hermneutique du fait pathologique partir d'une exprience module et colore ; on mesurera des variations, des quilibres, des excs ou des dfauts Le corps humain est compos de vaisseaux et de fluides ; ... lorsque les vaisseaux et les fibres n'ont ni trop, ni trop peu de ton, lorsque les fluides ont la consistance qui leur convient, lorsqu'ils ne sont ni trop, ni trop peu en mouvement, l'homme est dans un tat de sant ; si le mouvement... est trop fort, les solides s'endurcissent, les fluides deviennent pais ; s'il est trop faible, la fibre se relche, le sang s'attnue (3). Et le regard mdical, ouvert sur ces qualits tnues, devient
(1) SAUVAGES, loc., cit., 1, pp. 91-92. (2) TISSOT, Avis aux gens de lettres sur leur sant (Lausanne, 1767), p. 28. (3) Ibid., p. 28. |PAGE 13 attentif par ncessit toutes leurs modulations ; le dchiffrement de la maladie dans ses caractres spcifiques repose sur une forme nuance de la perception qui doit apprcier chaque quilibre singulier. Mais en quoi consiste cette singularit ? Ce n'est point celle d'un organisme dans lequel processus pathologique et ractions s'enchaneraient d'une manire unique pour former un cas . Il s'agit plutt de varits qualitatives de la maladie auxquelles viennent s'ajouter, pour les moduler au second degr, les varits que peuvent prsenter les tempraments: Ce que la mdecine classificatrice appelle les a histoires particulires , ce sont les effets de multiplication provoqus par les variations qualitatives (dues aux tempraments) des' qualits essentielles qui caractrisent les maladies. L'individu malade se rencontre au point o apparat le rsultat de cette multiplication. De l sa position paradoxale. Qui veut connatre la maladie dont il s'agit doit soustraire l'individu, avec ses qualits singulires : L'auteur de la nature, disait Zimmermann, a fix le cours de la plupart des maladies par des lois immuables qu'on dcouvre bientt si le cours de la maladie n'est pas interrompu ou troubl par le malade (1). A ce niveau l'individu n'est qu'un lment ngatif. Mais la maladie ne peut jamais se donner hors d'un temprament, de ses qualits, de leur vivacit ou de leur pesanteur ; et quand bien mme elle garderait sa physionomie d'ensemble, ses traits en leur dtail reoivent toujours des colorations singulires. Et le mme Zimmermann, qui ne reconnaissait dans le malade que le ngatif de la maladie, est tent parfois , contre les descriptions gnrales de Sydenham, de n'admettre que des histoires particulires. Quoique la nature soit simple dans le tout, elle est cependant varie dans les parties ; par consquent, il faut tcher de la connatre dans le tout et dans les parties (2). La mdecine des espces s'engage dans une attention renouvele l'individuel - une attention toujours plus impatiente et moins capable de supporter les formes gnrales de perception, les lectures htives d'essence. Certain Esculape a tous les matins cinquante soixante malades dans son antichambre ; il coute les plaintes de chacun, les
range en quatre files, ordonne la premire une saigne, la seconde une purgation, la troisime un clystre, la quatrime un changement d'air n (3). (1) ZIMMERMANN, Trait de l'Exprience (trad. fr., Paris, 1800), t. I, p. 122. (2) Ibid., p. 184. (3) Ibid., p. 187. |PAGE 14 Ceci n'est point de la mdecine ; il en est de mme de la pratique hospitalire qui tue les qualits de l'observation, et touffe les talents de l'observateur par le nombre des choses observer. La perception mdicale ne doit s'adresser ni aux sries ni aux groupes ; elle doit se structurer comme un regard travers une loupe qui, applique aux diffrentes parties d'un objet, y fait encore remarquer d'autres parties qu'on n'y apercevait pas sans cela (1), et entamer l'infini travail de la connaissance des dbiles singuliers. A ce point, on retrouve le thme du portrait voqu plus haut ; le malade c'est la maladie ayant acquis des traits singuliers ; la voici donne avec ombre et relief, modulations, nuances, profondeur ; et le labeur du mdecin quand il dcrira la maladie sera de restituer cette paisseur vivante Il faut rendre les mmes infirmits du malade, ses mmes souffrances, avec ses mmes gestes, sa mme attitude, ses mmes termes et ses mmes plaintes (2). Par le jeu de la spatialisation primaire, la mdecine des espces situait la maladie sur une plage d'homologies o l'individu ne pouvait recevoir de statut positif ; dans la spatialisation secondaire, elle exige en revanche une perception aigu du singulier, affranchie des structures mdicales collectives, libre de tout regard de groupe et de l'exprience hospitalire elle-mme. Mdecin et malade sont engags dans une proximit sans cesse plus grande, et lis, le mdecin par un regard qui guette, appuie toujours davantage et pntre, le malade par l'ensemble des qualits irremplaables et muettes qui, en lui, trahissent - c'est--dire montrent et varient les belles formes ordonnes de la maladie. Entre les caractres nosologiques et les traits terminaux qu'on lit sur le visage du malade, les qualits ont travers librement le corps. A ce corps, le regard mdical n'a gure de raison de s'attarder, au moins dans ses paisseurs et son fonctionnement.
On appellera spatialisation tertiaire l'ensemble des gestes par lesquels la maladie, dans une socit, est cerne, mdicalement investie, isole, rpartie dans des rgions privilgies et closes, ou distribue travers des milieux de gurison, amnags pour tre favorables. Tertiaire ne veut pas dire qu'il s'agit d'une (1) Ibid., p. 127. (2) Ibid., p. 178. |PAGE 15 structure drive et moins essentielle que les prcdentes ; elle engage un systme d'options o il y va de la manire dont un groupe, pour se maintenir et se protger, pratique les exclusions tablit les formes de l'assistance, ragit la peur de la mort refoule ou soulage la misre, intervient dans les maladies ou les laisse leurs cours naturel. Mais plus que les autres formes de spatialisation, elle est le lieu de dialectiques diverses : institutions htrognes, dcalages chronologiques, luttes politiques, revendications et utopies, contraintes conomiques, affrontements sociaux. En elle, tout un corps de pratiques et d'institutions mdicales font jouer les spatialisations primaire et secondaire avec les formes d'un espace social dont la gense, la structure et les lois sont de nature diffrente. Et pourtant, ou plutt pour cette raison mme, elle est le point d'origine des mises en question les plus radicales. Il est arriv qu' partir d'elle, toute l'exprience mdicale bascule et dfinisse pour ses perceptions les plus concrtes des dimensions et un sol nouveaux. Selon la mdecine des espces, la maladie a, par droit de naissance, des formes et des saisons trangres l'espace des socits. Il y a une nature sauvage de la maladie qui est la fois sa nature vraie et son plus sage parcours : seule, libre d'intervention, sans artifice mdical, elle laisse apparatre la nervure ordonne et presque vgtale de son essence. Mais plus l'espace social o elle est situe devient complexe, plus elle se dnature. Avant la civilisation, les peuples n'ont de maladies que les plus simples et les plus ncessaires. Paysans et gens du peuple restent proches encore du tableau nosologique fondamental ; la simplicit de leur vie le laisse transparatre dans son ordre raisonnable : chez eux, point de ces maux de nerfs variables, complexes, mls, mais de solides apoplexies, ou des crises franches de manie (1). A mesure qu'on s'lve dans l'ordre des conditions, et qu'autour des individus le rseau social se resserre, la sant semble diminuer par degrs ; les maladies se diversifient, et se combinent ; leur nombre est grand
dj dans l'ordre suprieur du bourgeois ; ... et il est le plus grand possible chez les gens du monde (2). L'hpital, comme la civilisation, est un lieu artificiel o la maladie transplante risque de perdre son visage essentiel. Elle y rencontre tout de suite une forme de complications que (1) TISSOT, Trait des nerfs et de leurs maladies (Paris, 1778-1780), t. II, pp. 432-444. (2) TISSOT, Essai sur la sant des gens du monde (Lausanne, 1770), pp. 8-12. |PAGE 16 les mdecins appellent fivre des prisons ou des hpitaux asthnie musculaire, langue sche, saburale, visage plomb, peau collante, dvoiement digestif, urine ple, oppression des voies respiratoires, mort du huitime ou onzime jour, au plus tard le treizime (1). D'une faon plus gnrale, le contact avec les autres malades, dans ce jardin dsordonn o les espces s'entrecroisent, altre la nature propre de la maladie et la rend plus difficilement lisible ; et comment, dans cette ncessaire proximit, corriger l'effluve malin qui part de tout le corps des malades, des membres gangrens, d'os caris, d'ulcres contagieux, de fivres putrides (2) ? Et puis, peut-on effacer les fcheuses impressions que fait sur un malade, arrach sa famille, le spectacle de ces maisons qui ne sont pour beaucoup que le temple de la mort ? Cette solitude peuple, ce dsespoir perturbent, avec les ractions saines de l'organisme, le cours naturel de la maladie ; il faudrait un mdecin d'hpital bien habile pour chapper au danger de la fausse exprience qui semble rsulter des maladies artificielles auxquelles il doit donner ses soins dans les hpitaux. En effet, aucune maladie d'hpital n'est pure (3). Le lieu naturel de la maladie, c'est le lieu naturel de la vie - la famille : douceur des soins spontans, tmoignage de l'attachement, dsir commun de la gurison, tout entre en complicit pour aider la nature qui lutte contre le mal, et laisser le mal lui-mme se dployer dans sa vrit ; le mdecin d'hpital ne voit que des maladies louches, altres, toute une tratologie du pathologique ; celui qui soigne domicile acquiert en peu de temps une vritable exprience fonde sur les phnomnes naturels de toutes les espces de maladies (4). La vocation de cette mdecine domicile est ncessairement d'tre respectueuse : Observer les malades, aider la nature sans lui faire violence et attendre en avouant modestement qu'il manque encore bien des connaissances (5). Ainsi se ranime propos de la
pathologie des espces le vieux dbat de la mdecine agissante et de la mdecine expectante (6). Les nosologistes sont favorables (1) TENON, Mmoires sur les hpitaux (Paris 1788), p. 451. (2) PERCIVAL, Lettre M. Aikin, in J. AIKIN, Observations sur les hpitaux (trad. fr., Paris, 1777), p. 113. (3) DUPONT DE NEMOURS, Ides sur les secours d donner (Paris, 1786), pp. 24-25. (4) Ibid. (5) MOSCATI, De l'emploi des systmes dans la mdecine pratique (trad. fr., Strasbourg, an VII), pp. 26-27. (6) Cf. VICQ D'AZYR, Remarques sur la mdecine agissante (Paris, 1786). |PAGE 17 celle-ci, et l'un des derniers, Vitet, dans une classification qui comporte plus de deux mille espces et qui porte le titre de Mdecine expectante, prescrit invariablement le quina pour aider la nature accomplir son mouvement naturel (1). La mdecine des espces implique donc pour la maladie und! spatialisation libre, sans rgion privilgie, sans contrainte hospitalire - une sorte de rpartition spontane en son emplacement de naissance et de dveloppement qui doit fonctionner comme le lieu o elle dveloppe et achve son essence, o elle parvient son terme naturel : la mort, invitable si telle est sa loi; la gurison, souvent possible si rien ne vient en troubler la nature. L o elle apparat, elle est cense, du mme mouvement, disparatre. Il ne faut pas la fixer dans un domaine mdicalement prpar, mais la laisser, au sens positif du terme, vgter dans son sol d'origine : le foyer, espace social conu sous sa forme la plus naturelle, la plus primitive, la plus moralement solide, la fois repli et entirement transparent, l o la maladie n'est livre qu' elle-mme. Or, ce thme concide exactement avec la manire dont est rflchi dans la pense politique le problme de l'assistance. La critique des fondations hospitalires est au XVIIIe sicle un lieu commun de l'analyse conomique. Les biens qui les constituent sont inalinables : c'est la part perptuelle des pauvres. Mais la pauvret, elle, n'est pas perptuelle ; les besoins peuvent changer, et l'assistance devrait porter tour de rle sur les provinces ou les villes qui en ont besoin. Ce ne serait pas transgresser, mais reprendre au contraire sous sa forme vritable la volont des donateurs ; leur but,
principal a t de servir le public, de soulager l'Etat ; - sans -'carter de l'intention des fondateurs, et en se conformant mme leurs vues, on doit regarder comme une masse commune le total de tous les biens affects aux hpitaux (2). La fondation, singulire et intangible, doit tre dissoute dans l'espace d'une assistance gnralise, dont la socit est la fois la seule grante et la bnficiaire indiffrencie. C'est, d'autre part, une erreur conomique que d'appuyer l'assistance sur une immobilisation du capital - c'est-dire sur un appauvrissement de la nation qui entrane son tour la ncessit de nouvelles fondations : d'o, la limite, un touffement de l'activit. Il ne faut brancher (1) VITET, La mdecine expectante Paris, 1806, 6 vol. (2) CHAMOUSSET (C.H.P.), Plan gnral pour l'administration des hpitaux, in Vues d'un citoyen (Paris, 1757), t. II.
|PAGE 18 l'assistance ni sur la richesse productrice (le capital) ni sur la richesse produite (la rente, qui est toujours capitalisable), mais sur le principe mme qui produit la richesse: le travail. C'est en faisant travailler les pauvres qu'on leur portera secours sans appauvrir la nation (1). Le malade, sans doute, n'est pas capable de travailler, mais s'il est plac l'hpital, il devient pour la socit une charge double: l'assistance dont il bnficie ne porte que sur lui, et sa famille, laisse l'abandon, se trouve expose son tour la misre et la maladie. L'hpital, crateur de la maladie par le domaine clos et pestilentiel qu'il dessine, l'est une seconde fois dans l'espace social o il est plac. Ce partage, destin protger, communique la maladie et la multiplie l'infini. Inversement, si elle est laisse dans le champ libre de sa naissance et de son dveloppement, elle ne sera jamais plus qu'elle-mme: elle s'teindra comme elle est apparue; et l'assistance qu'on lui prtera domicile compensera la pauvret qu'elle provoque: les soins assurs spontanment par l'entourage ne coteront rien personne; et la subvention accorde au malade profitera la famille: II faut bien que quelqu'un mange la viande dont on lui aura fait un bouillon; et en chauffant sa tisane, il n'en cote pas plus de chauffer aussi ses enfants (2). La chane de la maladie des maladies, et celle de l'appauvrissement perptuel de la pauvret sont ainsi rompues, lorsqu'on renonce crer pour le malade un espace diffrenci, distinct et destin, d'une manire ambigu mais maladroite, protger la maladie et prserver de la maladie. Indpendamment de leurs justifications, les thmes des conomistes
et ceux des mdecins classificateurs concident pour les lignes gnrales: l'espace dans lequel la maladie s'accomplit, s'isole et s'achve, est un espace absolument ouvert, sans partage ni figure privilgie ou fixe, rduit au seul plan des manifestations visibles; espace homogne o aucune intervention n'est autorise que celle d'un regard qui, en se posant, s'efface, et d'une assistance dont la valeur est dans le seul effet d'une compensation transitoire : espace sans morphologie propre que celle des ressemblances perues d'individu individu, et de soins apports par une mdecine prive un malade priv. Mais d'tre ainsi pousse son terme, la thmatique s'inverse. Une exprience mdicale dilue dans l'espace libre d'une socit (1) TURGOT, article Fondation de l'Encyclopdie. (2) DUPONT DE NEMOURS, Ides sur les secours donner (Paris, 1786), pp. 14-30. |PAGE 19 qu'organise la seule figure de la famille ne suppose-t-elle pas l'appui de la socit entire? N'implique-t-elle pas, par l'attention singulire qu'elle porte l'individu, une vigilance gnralise dont l'extension concide avec le groupe en son ensemble? Il faudrait concevoir une mdecine suffisamment lie l'Etat pour qu'elle puisse, de concert avec lui, pratiquer une politique constante, gnrale, mais diffrencie, de l'assistance; la mdecine devient tche nationale; et Menuret au dbut de la Rvolution rvait de soins gratuits assurs par des mdecins que le gouvernement dsintresserait en leur versant les revenus ecclsiastiques (1). Par le fait mme, il faudrait sur ces mdecins, eux-mmes, exercer un contrle; il faudrait empcher les abus, proscrire les charlatans, viter, par l'organisation d'une mdecine saine et rationnelle, que les soins domicile ne fassent du malade une victime et n'exposent son entourage la contagion. La bonne mdecine devra recevoir de l'Etat tmoignage de validit et protection lgale; lui d'tablir qu'il existe un vrai art de gurir (2). La mdecine de la perception individuelle, de l'assistance familiale, des soins domicile, ne peut trouver appui que sur une structure collectivement contrle, et qui recouvre l'espace social en son entier. On entre dans une forme toute nouvelle, et peu prs inconnue au XVIIIe sicle, de spatialisation institutionnelle de la maladie. La mdecine des espces s'y perdra. (1) J.-J. MENURET, Essai sur les moyens de former de bons mdecins (Paris, 1791). (2) JADELOT, Adresse Nos Seigneurs de l'Assemble Nationale sur la
ncessit et le moyen de perfectionner l'enseignement de la mdecine (Nancy, 1790), p. 7. |PAGE 21 CHAPITRE II Une Conscience Politique Par rapport la mdecine des espces, les notions de constitution, de maladie endmique, d'pidmie ont eu au XVIIIe sicle une destine singulire. Il faut revenir Sydenham et l'ambigut de sa leon: initiateur de la pense classificatrice, il a dfini en mme temps ce que pouvait tre une conscience historique et gographique de la maladie. La constitution de Sydenham n'est pas une nature autonome, mais le complexe -comme le noeud transitoire d'un ensemble d'vnements naturels: qualits du sol, climats, saisons, pluie, scheresse, foyers pestilentiels, disettes; et dans les cas o tout ceci ne rend pas compte des phnomnes constats, il faut invoquer les caractres non pas d'une espce claire au jardin des maladies, mais d'un noyau obscur et cel dans la terre. Variae sunt semper annorum constitutiones quae neque calori neque frigori non sicco humidove ortum suum debent, sed ab occulta potius inexplicabili quadam alteratione in ipsis terrae visceribus pendent (1). De symptmes, les constitutions n'en ont gure en propre: elles se dfinissent par des dplacements d'accent, des groupements inattendus de signes, des phnomnes plus intenses ou plus faibles: ici, les fivres seront violentes et sches, l, les catarrhes et les panchements sreux plus frquents; pendant un t chaud et long, les engorgements viscraux sont plus nombreux qu' l'ordinaire et plus obstins. Londres, de juillet septembre 1661 : Aegri paroxysmus atrocior, lingua magis nigra siccaque, extra paroxysmum aporexia obscurio, (1) Th. SYDENHAM, Observationes medicae, in Opera medica (Genve, 1736), I, p. 32. |PAGE 22 virium et appetitus prostratio major, major item ad paroxysmum proclinitas, omnia summatim accidentia immanioria, ipseque morbus quam pro more Febrium intermittentium funestior (1). La constitution n'est pas rapporte un absolu spcifique dont elle serait la manifestation plus ou moins modifie: elle est perue dans la seule relativit des diffrences -par un regard en quelque sorte diacritique.
Toute constitution n'est pas pidmie; mais l'pidmie est une constitution au grain plus serr, aux phnomnes plus constants et plus homognes. On a discut beaucoup et longuement, et maintenant encore, pour savoir si les mdecins du XVIIIe sicle en avaient saisi le caractre contagieux, et s'ils avaient pos le problme de l'agent de leur transmission. Oiseuse question, et qui demeure trangre, ou du moins drive par rapport la structure fondamentale: l'pidmie est plus qu'une forme particulire de maladie; elle est, au XVIIIe sicle, un mode autonome, cohrent et suffisant, de voir la maladie: On donne le nom de maladies pidmiques toutes celles qui attaquent en mme temps, et avec des caractres immuables, un grand nombre de personnes la fois (2). Il n'y a donc pas de diffrence de nature ou d'espce entre une maladie individuelle et un phnomne pidmique; il suffit qu'une affection sporadique se reproduise un certain nombre de fois et simultanment pour qu'il y ait pidmie. Problme purement arithmtique du seuil: le sporadique n'est qu'une pidmie infraliminaire. Il s'agit d'une perception non plus essentielle et ordinale, comme dans la mdecine des espces, mais quantitative et cardinale. Le support de cette perception n'est pas un type spcifique, mais un noyau de circonstances. Le fond de l'pidmie, ce n'est pas la peste, ou le catarrhe; c'est Marseille en 1721, c'est Bictre en 1780; c'est Rouen en 1769, o se produit, pendant l't, une pidmie sur les enfants de la nature des fivres bilieuses catarrhales, des fivres bilieuses putrides, compliques de la miliaire, des fivres bilieuses ardentes pendant l'automne. Cette constitution dgnre en bilieuse putride sur la fin de cette saison et pendant l'hiver de 1769 1770 (3). Les formes pathologiques familires sont convoques, mais pour un jeu complexe d'entrecroisements o elles occupent une place analogue celle (1) Ibid., p. 27. (2) LE BRUN, Trait historique sur les maladies pidmiques (Paris, 1776), p. 1. (3) LEPECQ DE LA CLOTURE, Collection d'observations sur les maladies et constitutions pidmiques (Rouen, 1778), p. XIV. |PAGE 23 du symptme par rapport la maladie. Le fond essentiel est dfini par le moment, par le lieu, par cet air vif, piquant, subtil, pntrant qui est celui de Nmes pendant l'hiver (1), par cet autre, poisseux, pais, putride que l'on connat Paris lorsque l't est long et lourd (2).
La rgularit des symptmes ne laisse pas transparatre en filigrane la sagesse d'un ordre naturel; elle ne parle que de la constance des causes, de l'obstination d'un facteur dont la pression globale et toujours rpte dtermine une forme privilgie d'affections. Tantt, il s'agit d'une cause qui se maintient travers le temps, et provoque par exemple la plica en Pologne, les crouelles en Espagne; on parlera alors plus volontiers de maladies endmiques; tantt, il s'agit de causes qui tout coup attaquent un grand nombre de personnes dans un mme lieu, sans distinction d'ge, de sexe, ni de tempraments. Elles prsentent l'action d'une cause gnrale, mais comme ces maladies ne rgnent que dans un certain temps, cette cause peut tre regarde comme purement accidentelle (3) : ainsi pour la variole, la fivre maligne ou la dysenterie; ce sont les pidmies proprement dites. Il n'y a pas s'tonner que malgr la grande diversit des sujets atteints, de leurs dispositions et de leur ge, la maladie se prsente chez tous selon les mmes symptmes: c'est que la scheresse ou l'humidit, la chaleur ou le froid, assurent ds que leur action se prolonge un peu, la domination d'un de nos principes constitutifs: alkalis, sels, phlogistique ; alors nous sommes exposs aux accidents qu'occasionne ce principe, et ces accidents doivent tre les mmes sur les diffrents sujets (4). L'analyse d'une pidmie ne se donne pas pour tche de reconnatre la forme gnrale de la maladie, en la situant dans l'espace abstrait de la nosologie, mais de retrouver, au-dessous des signes gnraux, le processus singulier, variable selon les circonstances, d'une pidmie l'autre, qui de la cause la forme morbide tisse une trame commune chez tous les malades, mais singulire en ce moment de temps, en ce lieu de l'espace; Paris, en 1785, a connu des fivres quartes et des synoques putrides, mais l'essentiel de l'pidmie, c'tait une bile dessche dans (1) RAZOUX, Tableau nosologique et mtorologique (Ble, 1787), p. 22. (2) MENURET, Essai sur l'histoire mdico-topographique de Paris (Paris, 1788), p. 139. (3) BANAN et TURBEN, Mmoires sur les pidmies de Languedoc (Paris, 1786), p. 3. (4) LE BRUN, loc. cit., p. 66, n. 1. |PAGE 24 ses couloirs, devenue mlancolie, le sang appauvri, paissi, et pour ainsi dire poisseux, les organes du bas-ventre engorgs et devenus les causes ou les foyers de l'obstruction (1) : bref, une sorte de singularit globale, un individu ttes multiples mais semblables
dont les traits ne se manifestent qu'une seule fois dans le temps et l'espace. La maladie spcifique se rpte toujours plus ou moins, l'pidmie jamais tout fait. Dans cette structure perceptive, le problme de la contagion est relativement de peu d'importance. La transmission d'un individu l'autre n'est en aucun cas l'essence de l'pidmie; elle peut, sous la forme du miasme ou du levain qui se communique par l'eau, les aliments, le contact, le vent, l'air confin, constituer une des causes de l'pidmie, soit directe ou premire (quand c'est la seule cause en action), soit seconde (lorsque le miasme est le produit, dans une ville ou un hpital, d'une maladie pidmique provoque par un autre facteur). Mais la contagion n'est qu'une modalit du fait massif de l'pidmie. On admettra volontiers que les maladies malignes, comme la peste, ont une cause transmissible; on le reconnatra plus difficilement pour les maladies pidmiques simples (coqueluche, rougeole, scarlatine, diarrhe bilieuse, fivre intermittente) (2). Contagieuse ou non, l'pidmie a une sorte d'individualit historique. De l, la ncessit d'user avec elle d'une mthode complexe d'observation. Phnomne collectif, elle exige un regard multiple; processus unique, il faut la dcrire sur ce qu'elle a de singulier, d'accidentel, d'inattendu. On doit transcrire l'vnement jusque dans le dtail, mais le transcrire aussi selon la cohrence qu'implique la perception plusieurs: connaissance imprcise, mal fonde tant qu'elle est partielle, incapable d'accder seule l'essentiel ou au fondamental, elle ne trouve son volume propre que dans le recoupement des perspectives, dans une information rpte et rectifie, qui finalement cerne, l o les regards se croisent, le noyau individuel et unique de ces phnomnes collectifs. A la fin du XVIIIe sicle, on est en train d'institutionaliser cette forme d'exprience: dans chaque subdlgation, un mdecin et plusieurs chirurgiens sont dsigns par l'Intendant pour suivre les pidmies qui peuvent se produire dans leur canton; ils se tiennent en correspondance avec le mdecin en chef de la gnralit propos tant de la maladie rgnante que de la topographie mdicinale de leur canton, (1) MENURET, loc. cit., p. 139. (2) LE BRUN, loc. cit., pp. 2-3. |PAGE 25 lorsque quatre ou cinq personnes sont attaques de la mme maladie, le syndic doit prvenir le subdlgu qui envoie le mdecin pour qu'il indique le traitement que les chirurgiens appliqueront tous les jours; dans les cas plus graves, c'est le mdecin de la gnralit qui doit se rendre sur les lieux (1).
Mais cette exprience ne peut prendre sa pleine signification que si elle est double d'une intervention constante et contraignante. Il ne saurait y avoir de mdecine des pidmies que double d'une police: veiller l'emplacement des mines et des cimetires, obtenir le plus souvent possible l'incinration des cadavres au lieu de leur inhumation, contrler le commerce du pain, du vin, de la viande (2), rglementer les abattoirs, les teintureries, interdire les logements insalubres; il faudrait qu'aprs une tude dtaille du territoire tout entier, on tablisse, pour chaque province, un rglement de sant lire au prne ou la messe, tous les dimanches et ftes, et qui concernerait la manire de se nourrir, de s'habiller, d'viter les maladies, de prvenir ou de gurir celles qui rgnent: II en serait de ces prceptes comme des prires que les plus ignorants mme et les enfants parviennent rciter (3). Il faudrait enfin crer un corps d'inspecteurs de sant qu'on pourraitdistribuer dans diffrentes provinces en confiant chacun un dpartement circonscrit ; l il prendrait des observations sur des domaines qui touchent la mdecine, mais aussi la physique, la chimie, l'histoire naturelle, la topographie, l'astronomie; il prescrirait les mesures prendre et contrlerait le travail du mdecin; Il serait souhaiter que l'Etat se charget de faire un sort ces Mdecins physiciens, et qu'il leur pargnt tous les frais qu'entrane le got de faire des dcouvertes utiles (4). La mdecine des pidmies s'oppose une mdecine des classes, comme la perception collective d'un phnomne global, mais unique et jamais rpt, peut s'opposer la perception individuelle de ce qu'une essence peut laisser apparatre constamment d'elle-mme et de son identit dans la multiplicit des phnomnes. Analyse d'une srie, dans un cas, dchiffrement d'un type dans l'autre; intgration du temps pour les pidmies, dfinition d'une place hirarchique pour les espces; assignation d'une causalit -recherche d'une cohrence essentielle; perception (1) ANONYME, Description des pidmies qui ont rgn depuis quelques annes sur la gnralit de Paris (Paris, 1783), pp. 35-37. (2) LE BRUN, loc. cit., pp. 127-132. (3) ANONYME, Description des pidmies, pp. 14-17. (4) LE BRUN, loc. cit., p. 124. |PAGE 26 dlie d'un espace historique et gographique complexe -dfinition d'une surface homogne o se lisent des analogies. Et pourtant, au bout du compte, lorsqu'il s'agit de ces figures tertiaires qui doivent distribuer la maladie, l'exprience mdicale et le contrle du mdecin
sur les structures sociales, la pathologie des pidmies et celle des espces se trouvent devant les mmes exigences: la dfinition d'un statut politique de la mdecine, et la constitution, l'chelle d'un tat, d'une conscience mdicale, charg d'une tche constante d'information, de contrle et de contrainte; toutes choses quicomprennent autant d'objets relatifs la police qu'il y en a qui sont proprement du ressort de la mdecine (1). L est l'origine de la Socit royale de Mdecine, et de son insurmontable conflit avec la Facult. En 1776, le gouvernement dcide de crer Versailles une commission charge d'tudier les phnomnes pidmiques et pizootiques qui se sont multiplis au cours des annes prcdentes; l'occasion prcise en est une maladie du cheptel, dans le sud-est de la France, qui avait forc le contrleur gnral des Finances donner ordre d'abattre tous les animaux douteux: d'o une perturbation conomique assez grave. Le dcret du 29 avril 1776 dclare en son prambule que les pidmies ne sont funestes et destructives dans leur commencement que parce que leur caractre, tant peu connu, laisse le mdecin dans l'incertitude sur le choix des traitements qu'il convient d'y appliquer; que cette incertitude nat du peu de soins qu'on a eu d'tudier ou de dcrire les symptmes des diffrentes pidmies et les mthodes curatives qui ont eu le plus de succs. La commission aura un triple rle: d'enqute, en se tenant au courant des divers mouvements pidmiques; d'laboration, en comparant les faits, en enregistrant les mdications employes, en organisant des expriences; de contrle et de prescription, en indiquant aux mdecins traitants les mthodes qui paraissent le mieux adaptes. Elle est compose de huit mdecins: un directeur, charg des travaux de la correspondance relative aux pidmies et aux pizooties (de Lasson), un commissaire gnral qui assure la liaison avec les mdecins de province (Vicq d'Azyr), et six docteurs de la Facult qui se consacrent des travaux concernant ces mmes sujets. Le contrleur des Finances pourra les envoyer faire des enqutes (1) LE BRUN, loc. cit., p. 126. |PAGE 27 en province et leur demander des rapports. Enfin, Vicq d'Azyr sera charg d'un cours d'anatomie humaine et compare devant les autres membres de la commission, les docteurs de la Facult etles tudiants qui s'en seront montrs dignes (1). Ainsi s'tablit un double contrle: des instances politiques sur l'exercice de la mdecine; et d'un corps mdical privilgi sur l'ensemble des
praticiens. Le conflit clate aussitt avec la Facult. Aux yeux des contemporains, c'est le choc de deux institutions, l'une moderne et politiquement sous-tendue, l'autre archaque et close sur elle-mme. Un partisan de la Facult dcrit ainsi leur opposition : L'une ancienne, respectable toutes sortes de titres et principalement aux yeux des membres de la socit qu'elle a forms pour la plupart; l'autre, institution moderne dont les membres ont prfr, l'association de leurs institutions, celle des ministres de la Couronne, qui ont dsert les Assembles de la Facult auxquelles le bien public et leurs serments devaient les tenir attachs pour courir la carrire de l'intrigue (2). Pendant trois mois, titre de protestation, la Facult fait grve : elle refuse d'exercer ses fonctions, et ses membres de consulter avec les socitaires. Mais l'issue est donne d'avance puisque le Conseil soutient le nouveau comit. Depuis 1778 dj, taient enregistres les lettres patentes qui consacraient sa transformation en Socit royale de Mdecine, et la Facult s'tait vu interdire d'employer en cette affaire aucune espce de dfense. La Socit reoit 40000 livres de rentes prleves sur les eaux minrales, alors que la Facult n'en reoit que 2000 peine (3). Mais surtout son rle s'largit sans cesse: organe de contrle des pidmies, elle devient peu peu un point de centralisation du savoir, une instance d'enregistrement et de jugement de toute l'activit mdicale. Au dbut de la Rvolution, le Comit des Finances de l'Assemble Nationale justifiera ainsi son statut: L'objet de cette socit est de lier la mdecine franaise et la mdecine trangre par une utile correspondance; de recueillir les observations parses, de les conserver et de les rapprocher; de rechercher surtout les causes des maladies populaires, d'en calculer les retours, d'en constater les remdes les plus efficaces (4). La Socit ne groupe (1) cf. Prcis historique de l'tablissement de la Socit royale de Mdecine (s.l.n.d. L'auteur anonyme est Boussu). (2) RETZ, Expos succinct l'Assemble Nationale (Paris, 1791), pp. 5-6. (3) cf. VACHER DE LA FEUTERIE, Motif de la rclamation de la Facult de Mdecine de Paris contre l'tablissement de la Socit royale de Mdecine (s.l.n.d.). (4) Cit in RETZ, loc. cit. |PAGE 28 plus seulement des mdecins qui se consacrent l'tude des phnomnes pathologiques collectifs; elle est devenue l'organe officiel d'une conscience collective des phnomnes pathologiques;
conscience qui se dploie au niveau de l'exprience comme au niveau du savoir, dans la forme cosmopolitique comme dans l'espace de la nation. L'vnement, ici, a valeur d'mergence dans les structures fondamentales. Figure nouvelle de l'exprience, dont les lignes gnrales, formes autour des annes 1775-1780, vont se prolonger assez loin dans le temps pour porter, pendant la Rvolution et jusque sous le Consulat, bien des projets de rforme. De tous ces plans peu de chose sans doute passera dans la ralit. Et pourtant la forme de perception mdicale qu'ils impliquent est un des lments constituants de l'exprience clinique. Style nouveau de la totalisation. Les traits du XVIIIe sicle, Institutions, Aphorismes, Nosologies, enfermaient le savoir mdical dans un espace clos: le tableau form pouvait bien n'tre pas achev dans le dtail, et en tel ou tel de ses points brouill par l'ignorance; dans sa forme gnrale, il tait exhaustif et ferm. On lui substitue maintenant les tables ouvertes et indfiniment prolongeables : Hautesierck dj en avait donn l'exemple, lorsque, la demande de Choiseul, il proposait pour les mdecins et chirurgiens militaires un plan de travail collectif, comprenant quatre sries parallles et sans limites: tude des topographies (la situation des lieux, le terrain, l'eau, l'air, la socit, les tempraments des habitants), observations mtorologiques (pression, temprature, rgime des vents), analyse des pidmies et des maladies rgnantes, description des cas extraordinaires (1). Le thme de l'encyclopdie fait place celui d'une information constante et constamment rvise, o il s'agit plutt de totaliser les vnements et leur dtermination que de clore le savoir en une forme systmatique: Tant il est vrai qu'il existe une chane qui lie dans l'univers, sur la terre et dans l'homme, tous les tres, tous les corps, toutes les affections ; chane dont la subtilit ludant les regards superficiels du minutieux faiseur d'expriences, et de froid dissertateur, se dcouvre au gnie vritablement observateur (2). Au dbut de la Rvolution, Cantin propose que ce travail d'information soit assur dans chaque dpartement par une commission lue (1) HAUTESIERCK, Recueil d'observations de mdecine des hpitaux militaires (Paris, 1766, t. l, pp. XXIV-XXVII). (2) MENURET, Essai sur l'histoire mdico-topographique de Paris, p. 139. |PAGE 29 parmi les mdecins (1) ; Mathieu Graud demande la cration en chaque chef-lieu d'une maison gouvernementale salubre, et celle,
Paris, d'une cour de salubrit, sigeant auprs de l'Assemble Nationale, centralisant les informations, les communiquant d'un point l'autre du territoire, posant les questions qui demeurent obscures, et indiquant les recherches faire (2). Ce qui constitue maintenant l'unit du regard mdical, ce n'est pas le cercle du savoir dans lequel il s'achve, mais cette totalisation ouverte, infinie, mouvante, sans cesse dplace et enrichie par le temps, dont il commence le parcours sans pouvoir l'arrter jamais: dj, une sorte d'enregistrement clinique de la srie infinie et variable des vnements. Mais son support n'est pas la perception du malade en sa singularit, c'est une conscience collective de toutes les informations qui se croisent, poussant en une ramure complexe et toujours foisonnante, agrandie enfin aux dimensions d'une histoire, d'une gographie, d'un Etat. Pour les classificateurs, l'acte fondamental de la connaissance mdicale tait d'tablir un reprage: situer un symptme dans une maladie, une maladie dans un ensemble spcifique, et orienter celuici l'intrieur du plan gnral du monde pathologique. Dans l'analyse des constitutions et des pidmies, il s'agit d'tablir un rseau par le jeu de sries qui, en se croisant, permettent de reconstituer cette chane dont parlait Menuret. Razoux tablissait chaque jour des observations mtorologiques et climatiques qu'il confrontait, d'une part, avec une analyse nosologique des malades observs, et d'autre part, avec l'volution, les crises, l'issue des maladies (3). Un systme de concidences apparaissait alors, indiquant une trame causale, et suggrant aussi entre les maladies des parents ou des enchanements nouveaux. Si quelque chose est capable de perfectionner notre art, crivait Sauvages lui-mme Razoux, c'est un pareil ouvrage excut pendant cinquante ans, par une trentaine de mdecins aussi exacts et aussi laborieux... Je ne ngligerai rien pour engager quelqu'un de nos docteurs faire les mmes observations dans notre Htel-Dieu (4). Ce qui dfinit l'acte de la (1) CANTIN, Projet de rforme adresse l'Assemble Nationale (Paris, 1790). (2) Mathieu GRAUD, Projet de dcret rendre sur l'organisation civile des mdecins (Paris, 1791), nos 78-79. (3) RAZOUX, Tableau nosologique et mtorologique adress l'Htel-Dieu de Nmes (Ble, 1761). (4) Cit ibid., p. 14. |PAGE 30 connaissance mdicale dans sa forme concrte, ce n'est donc pas la rencontre du mdecin et du malade, ni la confrontation d'un savoir
une perception; c'est le croisement systmatique de plusieurs sries d'informations homognes les unes et les autres, mais trangres les unes aux autres -plusieurs sries qui enveloppent un ensemble infini d'vnements spars, mais dont le recoupement fait surgir, dans sa dpendance isolable, le fait individuel. Dans ce mouvement, la conscience mdicale se ddouble: elle vit un niveau immdiat, dans l'ordre des constatations immdiates; mais elle se reprend un niveau suprieur, o elle constate les constitutions, les confronte, et se repliant sur les connaissances spontanes, prononce en toute souverainet son jugement et son savoir. Elle devient centralise. La Socit royale de Mdecine le montre au ras des institutions. Et au dbut de la Rvolution, les projets abondent, qui schmatisent cette double et ncessaire instance du savoir mdical, avec l'incessant va-et-vient qui de l'une l'autre maintient la distance en la parcourant. Mathieu Graud voudrait qu'on cre un Tribunal de Salubrit o un accusateur dnoncerait tout particulier qui, sans avoir fait la preuve de capacit, s'ingre sur autrui, ou sur l'animal qui ne lui appartient pas, de tout ce qui tient l'application directe ou indirecte de l'art salubre (1); les jugements de ce Tribunal concernant les abus, les incapacits, les fautes professionnelles devront faire jurisprudence dans l'tat mdical. Il s'agit l en quelque sorte de la police des connaissances immdiates: le contrle de leur validit. A ct du Judiciaire, il faudra un Excutif qui aura la haute et grande police sur toutes les branches de la salubrit. Il prescrira les livres lire et les ouvrages rdiger; il indiquera, d'aprs les informations reues, les soins donner dans les maladies qui rgnent; il publiera, des enqutes faites sous son contrle ou des travaux trangers, ce qui doit tre retenu pour une pratique claire. Le regard mdical circule, selon un mouvement autonome, l'intrieur d'un espace o il se ddouble et se contrle lui-mme; il distribue souverainement l'exprience quotidienne le savoir qu'il lui a, de trs loin emprunt, et dont il s'est fait la fois le point de rassemblement et le centre de diffusion. En elle, l'espace mdical peut concider avec l'espace social, ou plutt le traverser et le pntrer entirement. On commence concevoir une prsence gnralise des mdecins dont les (1) Mathieu GRAUD, loc. cit., p. 65. |PAGE 31 regards croiss forment rseau et exercent en tout point de l'espace, en tout moment du temps, une surveillance constante, mobile,
diffrencie. On pose le problme de l'implantation des mdecins dans les campagnes (1); on souhaite un contrle statistique de la sant grce au registre des naissances et des dcs (qui devrait porter mention des maladies, du genre de vie, et de la cause de la mort, devenant ainsi un tat civil de la pathologie); on demande que les raisons de rforme soient indiques en dtail par le conseil de rvision; enfin qu'on tablisse une topographie mdicale de chacun des dpartements avec des aperus soigns sur la rgion, les habitations, les gens, les passions dominantes, l'habillement, la constitution atmosphrique, les productions du sol, le temps de leur maturit parfaite et de leur rcolte, ainsi que l'ducation physique et morale des habitants de la contre (2). Et comme s'il ne suffisait pas de l'implantation des mdecins, on demande que la conscience de chaque individu soit mdicalement alerte; il faudra que chaque citoyen soit inform de ce qu'il est ncessaire et possible de savoir en mdecine. Et chaque praticien devra doubler son activit de surveillant d'un rle d'enseignement, car la meilleure manire d'viter que se propage la maladie, c'est encore de rpandre la mdecine (3). Le lieu o se forme le savoir, ce n'est plus ce jardin pathologique o Dieu avait distribu les espces, c'est une conscience mdicale gnralise, diffuse dans l'espace et dans le temps, ouverte et mobile, lie chaque existence individuelle, mais aussi bien la vie collective de la nation, toujours veille sur le domaine indfini o le mal trahit, sous ses aspects divers, sa grande forme massive. Les annes qui prcdent et suivent immdiatement la Rvolution ont vu natre deux grands mythes, dont les thmes et les polarits sont opposs; mythe d'une profession mdicale nationalise, organise sur le mode du clerg, et investie, au niveau de la sant et du corps, de pouvoirs semblables ceux (1) Cf. N.-L. LESPAGNOL, Projet d'tablir trois mdecins par district pour le soulagement des gens de la campagne (Charleville, 1790) ; ROYER, Bienfaisance mdicale et projet financier (Provins, an IX). (2) J.-B. DEMANGEON, Des moyens de perfectionner la mdecine (Paris, an VII), pp. 5-9; cf. Audin ROUVIRE, Essai sur la topographie physique et mdicale de Paris (Paris, an II). (3) BACHER, De la mdecine considre politiquement (Paris, an XI), p. 38. |PAGE 32 que celui-ci exerait sur les mes ; mythe d'une disparition totale de la maladie dans une socit sans troubles et sans passions, restitues sa sant d'origine. La contradiction manifeste des deux
thmatismes ne doit pas faire illusion: l'une et l'autre de ces figures oniriques expriment comme en noir et en blanc le mme dessin de l'exprience mdicale. Les deux rves sont isomorphes -l'un racontant d'une faon positive la mdicalisation rigoureuse, militante et dogmatique de la socit, par une conversion quasi religieuse, et l'implantation d'un clerg de la thrapeutique; l'autre racontant cette mme mdicalisation, mais sur un mode triomphant et ngatif, c'est dire la volatilisation de la maladie dans un milieu corrig, organis et sans cesse surveill, o finalement la mdecine disparatrait ellemme avec son objet et sa raison d'tre. Un faiseur de projets du dbut de la Rvolution, Sabarot de L'Avernire, voit dans les prtres et les mdecins les hritiers naturels des deux plus visibles missions de l'Eglise -la consolation des mes et l'allgement des souffrances. Il faut donc que les biens ecclsiastiques soient confisqus au haut clerg, qui les a dtourns de leur usage d'origine, et rendus la nation qui seule connat se propres besoins spirituels et matriels. Les revenus en seront partags entre les curs des paroisses et les mdecins, les uns et les autres recevant une part gale. Les mdecins ne sont-ils pas les prtres du corps? L'me ne saurait tre considre sparment des corps anims, et si les ministres des Autels sont vnrs et qu'ils peroivent de l'Etat une congrue honnte, il faut que ceux de votre sant reoivent aussi un fixe suffisant pour tre aliments et vous secourir. Ils sont les gnies tutlaires de l'intgrit de vos facults et de vos sensations (1). Le mdecin n'aura plus demander d'honoraires ceux qu'il soigne; l'assistance aux malades sera gratuite et obligatoire -service que la nation assure comme l'une de ses tches sacres; le mdecin n'en est que l'instrument (2). A la fin de ses tudes, le nouveau mdecin occupera non pas le poste de son choix, mais celui qui lui aura t assign selon les besoins ou les vacances, en gnral la campagne; quand il aura pris de l'exprience, il pourra demander une place de plus de responsabilit et mieux rmunre. Il devra (1) SABAROT DE L'AVERNIRE, Vile de Lgislation mdicale adresse aux Etats gnraux (1789), p. 3. (2) On trouve chez MENURET, Essai Sur le moyen de former de bons mdecins (Paris, 1791), l'ide d'un financement de la mdecine par les revenus ecclsiastiques, mais seulement quand il s'agit de soigner les indigents. |PAGE 33 rendre compte ses suprieurs de ses activits et sera responsable de ses fautes. Devenue activit publique, dsintresse et contrle,
la mdecine pourra se perfectionner indfiniment; elle rejoindra, dans le soulagement des misres physiques, la vieille vocation spirituelle de l'Eglise, dont elle formera comme le dcalque laque. Et l'arme des prtres qui veillent sur le salut des mes, correspondra celle des mdecins qui se proccupent de la sant des corps. L'autre mythe procde d'une rflexion historique pousse la limite. Lies aux conditions d'existence et aux modes de vie des individus, les maladies varient avec les poques, comme avec les lieux. Au Moyen Age, l'poque des guerres et des famines, les malades taient livrs la peur et l'puisement (apoplexies, fivres hectiques) ; mais avec le XVIe et le XVIIe sicle, on voit se relcher le sentiment de la Patrie et des obligations qu'on a son gard; l'gosme se replie sur lui-mme, on pratique la luxure et la gourmandise (maladies vnriennes, encombrement des viscres et du sang) ; au XVIIIe sicle, la recherche du plaisir passe par l'imagination; on va au thtre, on lit des romans, on s'exalte en de vaines conversations; on veille la nuit, on dort le jour; d'o les hystries, les hypocondries, les maladies nerveuses (1). Une nation qui vivrait sans guerre, sans passions violentes, sans oisifs, ne connatrait donc aucun de ces maux; et surtout, une nation qui ne connatrait pas la tyrannie qu'exerce la richesse sur la pauvret, ni les abus auxquels elle se livre d'elle-mme. Les riches? -Au sein de l'aisance et parmi les plaisirs de la vie, leur irascible orgueil, leurs dpits amers, leurs abus et les excs auxquels les porte le mpris de tous les principes, les rendent la proie des infirmits de tout genre; bientt... leur visage se sillonne, leurs cheveux blanchissent, les maladies les moissonnent avant le temps (2). Quant aux pauvres soumis au despotisme des riches et de leurs rois, ils ne connaissent que les impts qui les rduisent la misre, la disette dont profitent les accapareurs, les habitations insalubres qui les contraignent ne point lever de familles ou ne procrer tristement que des tres faibles et malheureux (3). La premire tche du mdecin est donc politique: la lutte contre la maladie doit commencer par une guerre contre les mauvais gouvernements: l'homme ne sera totalement et dfinitivement (1) MARET, Mmoire o on cherche dterminer quelle influence les moeurs ont sur la sant (Amiens, 1771). (2) LANTHENAS, De l'influence de la libert sur la sant (Paris, 1792), p. 8. (3) Ibid., p. 4. |PAGE 34
guri que s'il est d'abord libr: Qui devra donc dnoncer au genre humain les tyrans, si ce n'est les mdecins qui font de l'homme leur tude unique, et qui tous les jours chez le pauvre et le riche, chez le citoyen et chez le plus puissant, sous le chaume et les lambris, contemplent les misres humaines qui n'ont d'autre origine que la tyrannie et l'esclavage? (1). Si elle sait tre politiquement efficace, la mdecine ne sera plus mdicalement indispensable. Et dans une socit enfin libre, o les ingalits sont apaises et o rgne la concorde, le mdecin n'aura plus qu'un rle transitoire jouer: donner au lgislateur et au citoyen des conseils pour l'quilibre du coeur et du corps. Il ne sera plus besoin d'acadmies ni d'hpitaux: De simples lois dittiques, en formant les citoyens la frugalit, en faisant connatre aux jeunes gens surtout les plaisirs dont une vie, mme dure, est la source, en leur faisant chrir la plus exacte discipline dans la marine et dans les armes, que de maux prvenus, que de dpenses supprimes, que de facilits nouvelles... pour les entreprises les plus grandes et les plus difficiles. Et peu peu, dans cette jeune cit, toute livre au bonheur de sa propre sant, le visage du mdecin s'effacerait, laissant peine au fond des mmoires des hommes le souvenir de ce temps des rois et des richesses o ils taient esclaves, appauvris et malades. Rveries que tout cela; songe d'une cit en fte, d'une humanit de plein air o la jeunesse est nue et o l'ge ne connat pas d'hiver; symbole familier des stades antiques, auquel vient se mler le thme plus rcent d'une nature o se recueilleraient les formes les plus matinales de la vrit: toutes ces valeurs s'effaceront vite (2). Et pourtant, elles ont eu un rle important: en liant la mdecine aux destins des Etats, elles ont fait apparatre en elle une signification positive. Au lieu de rester ce qu'elle tait, la sche et triste analyse de millions d'infirmits, la douteuse ngation du ngatif, elle reoit la belle tche d'instaurer dans la vie des hommes les figures positives de la sant, de la vertu et du bonheur; elle de scander le travail par les ftes, d'exalter les passions calmes; elle de veiller sur les lectures et l'honntet des spectacles; elle aussi de contrler que les mariages ne se font pas pour le seul intrt, ou par un engouement passager, (1) Ibid., p. 8. (2) Lanthenas, qui tait girondin, fut mis le 2 juin 1793 sur la liste des proscrits, puis ray, Marat l'ayant qualifi de pauvre d'esprit. Cf. MATHIEZ La Rvolution franaise, t. II (Paris, 1945, p. 221). |PAGE 35
mais qu'ils sont bien fonds sur la seule condition durable du bonheur, qui est l'utilit de l'Etat (1). La mdecine ne doit plus tre seulement le corpus des techniques de la gurison et du savoir qu'elles requirent; elle enveloppera aussi une connaissance de l'homme en sant c'est--dire la fois une exprience de l'homme non malade, et une dfinition de l'homme modle. Dans la gestion de l'existence humaine, elle prend une posture normative, qui ne l'autorise pas simplement distribuer des conseils de vie sage, mais la fonde rgenter les rapports physiques et moraux de l'individu et de la socit o il vit. Elle se situe dans cette zone en lisire, mais, pour l'homme moderne, souveraine, o un certain bonheur organique, lisse, sans passion et muscl, communique de plein droit avec l'ordre d'une nation, la vigueur de ses armes, la fcondit de son peuple et la marche patiente de son travail. Lanthenas, ce songe-creux, a donn de la mdecine une dfinition brve, mais lourde de toute une histoire: Enfin, la mdecine sera ce qu'elle doit tre, la connaissance de l'homme naturel et social (2). Il est important de dterminer comment et sur quel mode les diverses formes du savoir mdical se rfrent aux notions positives de sant et de normalit. D'une faon trs globale, on peut dire que jusqu' la fin du XVIIIe sicle, la mdecine s'est rfre beaucoup plus la sant qu' la normalit; elle ne prenait pas appui sur l'analyse d'un fonctionnementrgulier de l'organisme pour chercher o il est dvi, par quoi il est perturb, comment on peut le rtablir; elle se rfrait plutt des qualits de vigueur, de souplesse, de fluidit que la maladie ferait perdre et qu'il s'agirait de restaurer. Dans cette mesure, la pratique mdicale pouvait accorder une grande place au rgime, la dittique, bref, toute une rgle de vie et d'alimentation que le sujet s'imposait lui-mme. Dans ce rapport privilgi de la mdecine la sant se trouvait inscrite la possibilit d'tre mdecin de soi-mme. La mdecine du XIXe sicle s'ordonne plus, en revanche, la normalit qu' la sant; c'est par rapport un type de fonctionnement ou de structure organique qu'elle forme ses concepts et prescrit ses interventions; et la connaissance physiologique, autrefois savoir marginal pour le mdecin et purement thorique, va s'installer (Claude Bernard en porte (1) cf. GANNE, De l'homme physique et moral, ou recherches sur les moyens de rendre l'homme plus sage (Strasbourg, 1791). (2) LANTHENAS, loc. cit., p. 18. |PAGE 36
tmoignage) au coeur mme de toute rflexion mdicale. Il y a plus: le prestige des sciences de la vie au XIXe sicle, le rle de modle qu'elles ont men, surtout dans les sciences de l'homme, n'est pas li primitivement au caractre comprhensif et transfrable des concepts biologiques, mais plutt au fait que ces concepts taient disposs dans un espace dont la structure profonde rpondait l'opposition du sain et du morbide. Lorsqu'on parlera de la vie des groupes et des socits, de la vie de la race, ou mme de la vie psychologique, on ne pensera pas seulement la structure interne de l'tre organis, mais la bipolarit mdicale du normal et du pathologique. La conscience vit, puisqu'elle peut tre altre, ampute, drive de son cours, paralyse ; les socits vivent puisqu'il y en a de malades qui s'tiolent, et d'autres, saines, en pleine expansion; la race est un tre vivant qu'on voit dgnrer; et les civilisations aussi, dont on a pu constater tant de fois la mort. Si les sciences de l'homme sont apparues dans le prolongement des sciences de la vie, c'est peut-tre parce qu'elles taient biologiquement sous-tendues, mais c'est aussi qu'elles l'taient mdicalement: sans doute par transfert, importation et souvent mtaphore, les sciences de l'homme ont utilis des concepts forms par les biologistes; mais l'objet mme qu'elles se donnaient (l'homme, ses conduites, ses ralisations individuelles et sociales) se donnait donc un champ partag selon le principe du normal et du pathologique. D'o le caractre singulier des sciences de l'homme, impossibles dtacher de la ngativit o elles sont apparues, mais lies aussi la positivit qu'elles situent, implicitement, comme norme. |PAGE 37 CHAPITRE III Le Champ Libre L'opposition entre une mdecine des espces pathologiques et une mdecine de l'espace social tait, aux yeux des contemporains, esquive sous les prestiges trop visibles d'une consquence qui leur tait commune: la mise hors circuit de toutes les institutions mdicales qui formaient opacit en face des nouvelles exigences du regard. Il fallait en effet que ft constitu un champ de l'exprience mdicale entirement ouvert, afin que la ncessit naturelle des espces pt y apparatre sans rsidu ni brouillage; il fallait aussi qu'il ft assez prsent dans sa totalit et ramass en son contenu, pour que puisse se former une connaissance fidle, exhaustive et
permanente de la sant d'une population. Ce champ mdical restitu sa vrit d'origine, et parcouru du regard en son entier, sans obstacle, ni altration, est analogue, dans sa gomtrie implicite, l'espace social dont rvait la Rvolution, au moins dans ses formules premires: une configuration homogne en chacune de ses rgions constituant un ensemble de points quivalents susceptibles d'entretenir avec leur totalit des relations constantes; un espace de la libre circulation o le rapport des parties au tout fut toujours transposable et rversible. Il y a donc un phnomne de convergence entre les exigences de l'idologie politique et celles de la technologie mdicale. D'un seul mouvement, mdecins et hommes d'Etat rclament en un vocabulaire parfois semblable, mais pour des raisons diffremment enracines, la suppression de tout ce qui peut faire obstacle la constitution de ce nouvel espace: les hpitaux qui altrent les lois spcifiques rgissant la maladie, et qui perturbent celles, non moins rigoureuses, dfinissant les rapports de la proprit |PAGE 38 et de la richesse, de la pauvret et du travail; la corporation des mdecins qui empche la formation d'une conscience mdicale centralise, et le libre jeu d'une exprience sans limitation, accdant d'elle-mme l'universel; les Facults enfin qui ne reconnaissent le vrai que dans des structures thoriques, et font du savoir un privilge social. La libert doit briser toutes les entraves qui s'opposent la force vive de la vrit. Il doit y avoir un monde o le regard libre de tout obstacle n'est plus soumis qu' la loi immdiate du vrai; mais le regard n'est pas fidle au vrai et soumis la vrit sans assurer par l une souveraine matrise: le regard qui voit est un regard qui domine; et s'il sait se soumettre aussi, il matrise ses matres: C'est le despotisme qui a besoin de tnbres, mais la libert toute rayonnante de gloire ne peut subsister qu'environne de toutes les lumires qui peuvent clairer les hommes; c'est pendant le sommeil des peuples que la tyrannie peut s'tablir et se naturaliser parmi eux... Rendez les autres nations tributaires non de votre autorit politique, non de votre gouvernement, mais de vos talents et de vos lumires, ...il existe une dictature pour les peuples dont le joug ne rpugne point ceux qui se courbent sous lui: c'est la dictature du gnie (1). Le thme idologique, qui oriente toutes les rformes de structures mdicales depuis 1789 jusqu' Thermidor an II, est celui de la souveraine libert du vrai: la violence majestueuse de la lumire, qui est elle-mme son propre rgne, abolit le royaume obscur des
savoirs privilgis et instaure l'empire sans cloison du regard. 1. La mise en question des structures hospitalires Le Comit de Mendicit de l'Assemble Nationale est acquis la fois aux ides des conomistes et celles des mdecins qui estiment que le seul lieu possible de rparation de la maladie, c'est le milieu naturel de la vie sociale, la famille. L, le cot de la maladie est pour la nation rduit au minimum; et disparat aussi le risque de la voir se compliquer dans l'artifice, se multiplier par elle-mme et prendre, comme l'hpital, la forme aberrante d'une maladie de la maladie. En famille, la maladie est l'tat de nature, c'est--dire conforme sa nature propre, (1) BOISSY D'ANGLAS, Adresse la Convention 25 pluvise an II. Cit in GUILLAUME, Procs-verbaux du Comit d'Instruction publique de la Convention (t. II, pp. 640-642).
|PAGE 39 et librement. offerte aux forces rgnratrices de la nature. Le regard que les proches portent sur elle a la force vive de la bienveillance et la discrtion de l'expectative. Il y a, dans la maladie librement regarde, quelque chose qui dj la compense: Le malheur... excite par sa prsence la bienfaisante compassion, fait natre dans le coeur des hommes le besoin pressant de lui porter du soulagement et des consolations, et les soins donns aux malheureux dans leur propre asile mettent profit cette source fconde de biens que rpand la bienfaisance particulire. Le pauvre est-il plac dans les hpitaux? Toutes ces ressources cessent pour lui... (1). Sans doute existe-t-il des malades qui n'ont point de famille, ou d'autres qui sont si pauvres qu'ils vivent entasss dans des greniers. Pour ceux-l, il faut crer des maisons communales de malades qui devront fonctionner comme des substituts de famille et faire circuler, dans la forme de la rciprocit, le regard de la compassion; les misrables trouveront ainsi dans les compagnons de leur sort des tres naturellement compatissants et auxquels ils ne sont pas au moins tout fait trangers (2). Ainsi la maladie trouvera partout son lieu naturel, ou quasi naturel: elle y aura la libert de suivre son cours et de s'abolir elle-mme dans sa vrit. Mais les ides du Comit de Mendicit s'apparentent aussi bien au thme d'une conscience sociale et centralise de la maladie. Si la famille est lie au malheureux par un devoir naturel de compassion, la nation lui est lie par un devoir social et collectif d'assistance. Les fondations hospitalires, biens immobiliss et crateurs, par leur inertie mme, de pauvret, doivent disparatre, mais au profit d'une
richesse nationale et toujours mobilisable qui peut assurer chacun les secours ncessaires. L'Etat devra donc aliner son avantage les biens des hpitaux, puis les runir en une masse commune. On crera une administration centrale charge de grer cette masse; elle formera comme la conscience mdico-conomique permanente de la nation; elle sera perception universelle de chaque maladie et reconnaissance immdiate de tous les besoins. Le grand Oeil de la Misre. On la chargera du soin d'affecter des sommes ncessaires et compltement suffisantes au soulagement des malheureux. Elle financera la Maison communale et distribuera des secours particuliers aux familles pauvres qui soignent elles-mmes leurs malades. (1) BLOCH et TUTEY, Procs-verbaux et rapports du Comit de Mendicit (Paris, 1911), p. 395. (2) Ibid., p. 396. |PAGE 40 Deux problmes ont fait chouer le projet. L'un, celui de l'alination des biens hospitaliers, est de nature politique et conomique. L'autre est de nature mdicale, il concerne les maladies complexes ou contagieuses. L 'Assemble lgislative revient sur le principe de la nationalisation des avoirs; elle prfre en runir simplement les revenus pour les affecter un fond d'assistance. Il ne faut pas non plus confier une seule administration -centrale le soin de les grer; elle serait trop lourde, trop lointaine et par l impuissante rpondre aux besoins. La conscience de la maladie et de la misre, pour tre immdiate et efficace, doit tre une conscience gographiquement spcifie. Et la Lgislative, en ce domaine, comme en bien d'autres, revient du centralisme de la Constituante un systme beaucoup plus lche, de type anglais: ce sont les administrations locales qui sont charges de constituer les relais essentiels, elles devront se tenir au courant des besoins, et distribuer elles-mmes les revenus; elles formeront un rseau multiple de surveillance. Ainsi se trouve pos le principe de la communalisation de l'Assistance auquel le Directoire, dfinitivement, se ralliera. Mais l'assistance dcentralise et confie aux instances locales ne peut plus assurer de fonctions pnales: il va donc falloir dissocier les problmes de l'assistance et ceux de la rpression. Tenon, dans son souci de rgler la question de Bictre et de la Salptrire, voulait que la Lgislative crt un comit des hpitaux et des maisons d'arrestation qui aurait comptence gnrale pour les tablissements hospitaliers, les prisons, le vagabondage et les
pidmies. L 'Assemble s 'y oppose allguant que c'tait avilir d'une certaine manire les dernires classes du peuple en confiant galement le soin des infortuns et des criminels aux mmes personnes (1). La conscience de la maladie, et de l'assistance qui lui est due chez les pauvres, prend son autonomie; elle s'adresse maintenant un type de misre bien spcifique. Corrlativement, le mdecin se met jouer un rle dcisif dans l'organisation des secours. A l'chelon social o ils sont distribus, il devient agent dtecteur des besoins, et juge de la nature et du degr de l'aide qu'il faut apporter. La dcentralisation des moyens de l'assistance autorise une mdicalisation de son exercice. On reconnat l une ide familire Cabanis, celle du mdecin-magistrat; c'est lui que la cit (1) Cit in IMBERT, Le droit hospitalier sous la Rvolution et l'Empire (Paris, 1954), p. 52. |PAGE 41 doit confier la vie des hommes au lieu de la laisser la merci des jongleurs et des commres ; c'est lui qui doit juger que la vie du puissant et du riche n'est pas plus prcieuse que celle du faible et de l'indigent ; c'est lui enfin qui saura refuser les secours aux malfaiteurs publics (1). Outre son rle de technicien de la mdecine, il joue un rle conomique dans la rpartition des secours, un rle moral et quasi judiciaire dans leur attribution; le voil devenu le surveillant de la morale, comme de la sant publique (2). Dans cette configuration o les instances mdicales sont multiples afin de mieux assurer une surveillance continue, l'hpital doit avoir sa place. Il est ncessaire pour les malades sans famille; mais il est ncessaire aussi dans les cas contagieux, et pour les maladies difficiles, complexes, extraordinaires auxquelles la mdecine sous sa forme quotidienne ne peut faire face. L encore, l'influence de Tenon et de Cabanis est visible. L 'hpital qui, sous sa forme la plus gnrale, ne porte que les stigmates de la misre, apparat au niveau local comme une indispensable mesure de protection. Protection des gens sains contre la maladie; protection des malades contre les pratiques des gens ignorants: il faut prserver le peuple de ses propres erreurs (3) ; protection des malades les uns l'gard des autres. Ce que Tenon projette, c'est un espace hospitalier diffrenci. Et diffrenci selon deux principes: celui de la formation, qui destinerait chaque hpital une catgorie de malades ou une famille de maladies; celui de la distribution qui dfinit, l'intrieur d'un mme hpital, l'ordre suivre pour y ranger les espces de malades que l'on sera convenu d'y recevoir (4). Ainsi, la famille, lieu
naturel de la maladie, se trouve double d'un autre espace qui doit reproduire comme un microcosme la configuration spcifique du monde pathologique. L, sous le regard du mdecin d'hpital, les maladies seront groupes par ordres, genres et espces, en un domaine rationalis qui restitue la distribution originaire des essences. Ainsi conu, l'hpital permet de classer tellement les malades que chacun trouve ce qui convient son tat sans aggraver par son voisinage lei mal d'autrui, sans rpandre la contagion, soit dans l'hpital, (1) CABANIS, Du degr de certitude de la mdecine (3e d., Paris, 1819), p. 135 et p. 154. (2) Ibid., p. 146, n. 1. (3) CABANIS, Du degr de certitude de la mdecine, p. 135. (4) TENON, Mmoires sur les hpitaux (Paris, 1788), p. 359. |PAGE 42 soit au-dehors (1). La maladie rencontre l son haut lieu, et comme la rsidence force de sa vrit. Dans les projets du Comit des Secours, deux instances sont donc juxtaposes: l'ordinaire, qui implique, par la rpartition de l'aide une surveillance continue de l'espace social avec un systme de relais rgionaux fortement mdicaliss; quant l'instance extraordinaire, elle est constitue d'espaces discontinus exclusivement mdicaux, et structurs selon le modle du savoir scientifique. La maladie est prise ainsi dans un double systme d'observation: il y a un regard qui la confond et la rsorbe dans l'ensemble des misres sociales supprimer; et un regard qui l'isole pour la mieux cerner dans sa vrit de nature. La Lgislative laissait la Convention deux problmes qui n'taient pas rsolus: celui de la proprit des biens hospitaliers, et celui, nouveau, du personnel des hpitaux. Le 18 aot 1792, l'Assemble avait dclar dissoutes toutes les corporations religieuses et congrgations sculires d'hommes ou de femmes ecclsiastiques ou laques (2). Mais la plupart des hpitaux taient tenus par des ordres religieux, ou, comme la Salptrire, par des organisations laques conues sur un modle quasi monastique; c'est pourquoi le dcret ajoute: Nanmoins, dans les hpitaux et maisons de charit, les mmes personnes continueront comme ci-dessus le service des pauvres et le soin des malades titre individuel, sous la surveillance des corps municipaux et administratifs, jusqu' l'organisation dfinitive que le Comit des Secours prsentera incessamment l'Assemble Nationale. En fait, jusqu' Thermidor, la Convention pensera surtout le problme de l'assistance et de l'hpital en termes
de suppression. Suppression immdiate des secours de l'Etat demande par les Girondins qui redoutent l'encadrement politique des classes les plus pauvres par les Communes, s'il leur est donn de rpartir l'assistance; pour Roland, le systme des secours manuels est le plus dangereux : sans doute la bienfaisance peut-elle et doitelle s'exercer par souscription prive, mais le gouvernement ne doit pas s'en mler; il serait tromp, et ne secourrait pas ou secourrait mal (3). Suppression des hpitaux, demande par les Montagnards, car ils y voient comme une institutionalisation de la misre; et l'une des tches de la Rvolution doit tre de les faire disparatre en les rendant inutiles; propos d'un (1) Ibid., p. 354. (2) J.-B. DUVERGIER, Collection complte des lois..., t. IV, p. 325. (3) Archives parlementaires, t. LVI, p. 646; cit in IMBERT, Le droit hospitalier sous la Rvolution et l'Empire, p. 76, n. 29. |PAGE 43 hpital consacr l'humanit souffrante, Lebon demandait: Doit-il y avoir une partie quelconque de l'humanit qui soit en souffrance? ...Mettez donc au-dessus des portes de ces asiles des inscriptions qui annoncent leur disparition prochaine. Car si la Rvolution finie, nous avons encore des malheureux parmi nous, nos travaux rvolutionnaires auront t vains (1). Et Barre, dans la discussion de la loi du 22 floral an II, lancera la formule clbre: Plus d'aumnes, plus d'hpitaux. Avec la victoire de la Montagne, l'ide l'emporte d'une organisation par l'Etat du secours public et d'une suppression complmentaire, chance plus ou moins lointaine, des tablissements hospitaliers. La constitution de l'an II proclame dans sa Dclaration des droits que les secours publics sont une dette sacre ; la loi du 22 floral prescrit la formation d'un grand livre de la bienfaisance nationale et l'organisation d'un systme de secours la campagne. Il n'est prvu de maisons de sant que pour les malades qui n'ont point de domicile ou qui ne pourront y recevoir de secours (2). La nationalisation des biens hospitaliers, dont le principe tait acquis depuis le 19 mars 1793, mais dont l'application devrait tre retarde jusqu'aprs l'organisation complte, dfinitive et en plusieurs activits du secours public, devient immdiatement excutoire avec la loi du 23 messidor an II. Les biens hospitaliers seront vendus parmi les biens nationaux, et l'assistance assure par le Trsor. Des agences cantonales seront charges de distribuer domicile les secours ncessaires. Ainsi commence passer, sinon dans la ralit du moins dans la lgislation, le grand rve d'une dshospitalisation totale de la
maladie et de l'indigence. La pauvret est un fait conomique auquel l'assistance doit remdier tant qu'elle existe; la maladie est un accident individuel auquel la famille doit rpondre en assurant la victime les soins ncessaires. L 'hpital est une solution anachronique qui ne rpond pas aux besoins rels de la pauvret, et qui stigmatise dans sa misre l'homme malade. Il doit y avoir un tat idal o l'tre humain ne connatra plus l'puisement des travaux pnibles, et l'hpital qui conduit la mort. Un homme n'est fait ni pour les mtiers, ni pour l'hpital, ni pour les hospices: tout cela est affreux (3). (1) Ibid., p. 78. (2) Loi du 19 mars 1793. (3) SAINT-JUST, in BUCHEZ et Roux, Histoire parlementaire, t. XXXV, p. 296. |PAGE 44 2. Le droit d'exercice et l'enseignement mdical Les dcrets de Marly, pris au mois de mars 1707, avaient rgl pour tout le XVIIIe sicle la pratique de la mdecine et la formation des mdecins. Il s'agissait alors de lutter contre les charlatans, les empiriques, et les personnes sans titre et sans capacit qui exeraient la mdecine ; corrlativement, il avait fallu rorganiser les facults tombes depuis plusieurs annes dans le plus extrme relchement. Il tait prescrit que la mdecine dsormais serait enseigne dans toutes les universits du royaume qui avaient, ou avaient eu, une facult; que les chaires, au lieu de demeurer indfiniment vacantes, seraient mises la dispute aussitt que libres; que les tudiants ne recevraient leur degr qu'aprs 3 ans d'tudes, dment vrifies par des inscriptions prises tous les 4 mois; que chaque anne, ils subiraient un examen avant les actes leur donnant le titre de bachelier, licenci et docteur; qu'ils devraient assister obligatoirement aux cours d'anatomie, de pharmacie chimique et galnique, et aux dmonstrations de plantes (1). Dans ces conditions, l'article 26 du dcret posait en principe: nul ne pourra exercer la mdecine, ni donner aucun remde mme gratuitement s'il n'a obtenu le degr de licenci ; et le texte ajoutait -ce qui en tait la consquence primordiale et la fin achete par les Facults de Mdecine au prix de leur rorganisation: Que tous les religieux mendiants ou non mendiants soient et demeurent compris dans la prohibition porte par l'article prcdent (2). A la fin du sicle, les critiques sont unanimes, sur quatre points au moins: les charlatans continuent fleurir; l'enseignement canonique donn la Facult ne
rpond plus aux exigences de la pratique, ni aux dcouvertes nouvelles (on n'enseigne que la thorie; on ne fait place ni aux mathmatiques, ni la physique) ; il Y a trop d'Ecoles de Mdecine pour que l'enseignement puisse tre assur partout de manire satisfaisante; la concussion y rgne (on se procure les chaires comme des charges; les professeurs donnent des cours payants; les tudiants achtent leurs examens, et font crire leurs thses par des mdecins besogneux), ce qui rend les tudes mdicales fort coteuses, d'autant plus que pour se former enfin la pratique, le nouveau docteur doit suivre dans ses visites un praticien (1) Articles 1, 6, 9, 10, 14 et 22. (2) Articles 26 et 27. Le texte complet des dcrets de Marly est cit par GILIBERT, L'anarchie mdicinale (Neuchtel, 1772), t. II, pp. 58118. |PAGE 45 renomm qu'il lui faut alors ddommager (1). La Rvolution Se trouve donc en prsence de deux sries de revendications: les unes en faveur d'une limitation plus stricte du droit d'exercer; les autres en faveur d'une organisation plus rigoureuse du cursus universitaire. Or, les unes et les autres vont l'encontre de tout ce mouvement de rformes qui aboutit la suppression des jurandes et corporations, et la fermeture des universits. De l, une tension entre les exigences d'une rorganisation du savoir, celles de l'abolition des privilges, celles enfin d'une surveillance efficace de la sant de la nation. Comment le libre regard que la mdecine et, travers elle, le gouvernement doivent poser sur les citoyens, peut-il tre arm et comptent sans tre pris dans l'sotrisme d'un savoir et la rigidit des privilges sociaux? Premier problme: la mdecine peut-elle tre un mtier libre que ne protgerait aucune loi corporative, aucun interdit d'exercice, aucun privilge de comptence? La conscience mdicale d'une nation peutelle tre aussi spontane que sa conscience civique ou morale? Les mdecins dfendent leurs droits corporatifs en faisant valoir qu'ils n'ont pas le sens du privilge, mais de la collaboration. Le corps mdical se distingue d'une part des corps politiques, en ceci qu'il ne cherche pas limiter la libert d'autrui, et imposer des lois ou des obligations aux citoyens; il n'impose d'impratif qu' lui-mme; sa juridiction est concentre dans son sein (2) ; mais il se distingue aussi des autres corps professionnels, car il n'est pas destin maintenir des droits et des traditions obscures, mais confronter et communiquer le savoir: sans un organe constitu, les lumires s'teindraient ds leur naissance, l'exprience de chacun tant
perdue pour tous. Les mdecins en s'unissant font ce serment implicite: Nous voulons nous clairer en nous fortifiant de toutes nos connaissances; la faiblesse de quelques-uns d'entre nous se corrige par la supriorit des autres; en nous rassemblant sous une police commune nous exciterons sans cesse l'mulation (3). Le corps des mdecins se critique lui-mme plus qu'il ne se protge, et il est, de ce fait, indispensable pour protger le peuple contre ses propres illusions et les charlatans (1) Cf. ce sujet GILIBERT cit plus haut; THIERY, Voeux d'un patriote sur la mdecine en France (1789) : ce texte aurait t crit en 1750 et publi seulement l'occasion des Etats gnraux. (2) CANTIN, Projet de rforme adress l'Assemble Nationale (Paris, 1790), p. 14. (3) CANTIN, ibid. |PAGE 46 mystificateurs (1); Si les mdecins et les chirurgiens forment un corps ncessaire dans la socit, leurs fonctions importantes exigent de la part de l'autorit lgislative une considration particulire qui prvient les abus (2). Un tat libre qui veut maintenir les citoyens libres de l'erreur et des maux qu'elle entrane ne peut pas autoriser un libre exercice de la mdecine. En fait, nul ne songera, mme parmi les plus libraux des Girondins, librer entirement la pratique mdicale et l'ouvrir un rgime de concurrence sans contrle. Mathieu Graud lui-mme, en demandant la suppression de tous les corps mdicaux constitus, voulait tablir dans chaque dpartement une Cour qui jugerait tout particulier se mlant de mdecine sans avoir fait ses preuves de capacit (3). Mais le problme de l'exercice de la mdecine tait li trois autres: la suppression gnrale des corporations, la disparition de la socit de mdecine, et surtout la fermeture des universits. Jusqu' Thermidor, les projets de rorganisation des Ecoles de Mdecine sont innombrables. On peut les grouper en deux familles, les uns supposant la persistance des structures universitaires, les autres tenant compte des dcrets du 17 aot 1792. Dans le groupe des rformistes, on rencontre constamment l'ide qu'il faut effacer les particularismes locaux, en supprimant les petites Facults qui vgtent, o les professeurs insuffisamment nombreux, peu comptents, distribuent ou vendent les examens et les titres. Quelques Facults importantes offriront dans tout le pays des chaires que les meilleurs postuleront; ils formeront des docteurs dont la qualit ne sera conteste par personne; le contrle de l'Etat et celui de l'opinion joueront ainsi d'une manire efficace pour la gense d'un
savoir et d'une conscience mdicale devenue enfin adquate aux besoins de la nation. Thiery estime qu'il suffirait de quatre Facults; Gallot de deux seulement avec quelques coles spciales pour un enseignement moins savant (4). Il faudra aussi que les tudes durent plus longtemps: 7 annes selon Gallot, 10 d'aprs Cantin ; c'est qu'il s'agit maintenant d'inclure dans le cycle des tudes les mathmatiques, la gomtrie, la physique et la chimie (5), (1) CABANIS, Du degr de certitude de la mdecine. (2) JADELOT, Adresse Nos Seigneurs de l'Assemble Nationale (Nancy, 1790), p. 7. (3) cf. supra, p. 29. (4) THIERY, loc. cit.; J.-P. GALLOT, Vues gnrales sur la restauration de l'art de gurir (Paris, 1790). (5) THIERY, loc. cit., pp. 89-98. |PAGE 47 tout ce qui a un lien organique avec la science mdicale. Mais surtout, il faut envisager un enseignement pratique. Thiery souhaiterait un Institut royal, peu prs indpendant de la Facult et qui assurerait l'lite des jeunes mdecins une formation perfectionne et essentiellement pratique; on crerait dans le Jardin du Roi une sorte d'internat doubl d'un hpital (on pourrait utiliser la Salptrire, toute voisine) ; l des professeurs enseigneraient en visitant les malades; la Facult se contenterait de dlguer un docteur-rgent pour les examens publics de l'Institut. Cantin propose que, l'essentiel une fois appris, les candidats mdecins soient envoys tantt dans les hpitaux, tantt dans les campagnes auprs de ceux qui y exercent; c'est que, ici et l, on a besoin de maind'oeuvre, et les malades qu'on y soigne ont rarement besoin de mdecins bien comptents; faisant de rgion en rgion cette sorte de tour de France mdical, les futurs docteurs recevraient lenseignement le plus divers, apprendraient connatre les maladies de chaque climat, et s'informeraient des mthodes qui russissent le mieux. Formation pratique nettement dissocie de l'enseignement thorique et universitaire. Alors que dj (nous le verrons plus loin) la mdecine est en possession des concepts qui lui permettraient de dfinir l'unit d'un enseignement clinique, les rformateurs ne parviennent pas en proposer une version institutionnelle: la formation pratique n'est pas l'application pure et simple du savoir abstrait (il suffirait alors de confier cet enseignement pratique aux professeurs des coles ellesmmes) ; mais elle ne peut pas tre non plus la clef de ce savoir (on ne peut l'acqurir qu'une fois ce savoir acquis par ailleurs) ; c'est
qu'en fait cet enseignement pratique est dfini d'aprs les normes d'une mdecine du groupe social, alors qu'on ne dtache pas la formation universitaire d'une mdecine plus ou moins proche parente de la thorie des espces. D'une manire assez paradoxale, cette acquisition de la pratique, qui est domine par le thme de l'utilit sociale, est laisse peu prs entirement l'initiative prive, l'Etat ne contrlant gure que l'enseignement thorique. Cabanis voudrait que tout mdecin d'hpital et la permission de former une cole d'aprs le plan qu'il jugerait le meilleur : lui et lui seul fixerait chaque lve le temps d'tudes ncessaire; pour certains, deux ans suffiraient; pour d'autres, moins dous, il en faudrait quatre; dues l'initiative individuelle, ces leons seraient ncessairement payantes, et les professeurs en fixeraient |PAGE 48 eux-mmes le prix; celui-ci, sans doute, pourrait tre trs lev, si le professeur tait clbre et son enseignement recherch, mais il n'y a l aucun inconvnient: la noble mulation alimente par toutes sortes de motifs ne pourrait que tourner au profit des malades, des lves et de la science (1). Curieuse structure de cette pense rformatrice. On entendait laisser l'assistance l'initiative individuelle, et maintenir les tablissements hospitaliers pour une mdecine plus complexe et comme privilgie; la configuration de l'enseignement est inverse: il suit un cheminement obligatoire et public l'universit; l'hpital, il devient priv, concurrentiel et payant. C'est qu'alors les normes d'acquisition du savoir et les rgles de formation de la perception ne sont pas encore superposables: la manire dont on pose le regard et la manire dont on l'instruit ne se rejoignent pas. Le champ de la pratique mdicale est partag entre un domaine libre et indfiniment ouvert, celui de l'exercice domicile, et un lieu clos, ferm sur les vrits d'espces qu'il rvle; le champ de l'apprentissage est partag entre le domaine clos du savoir transmis, et celui, libre, o la vrit parle d'elle-mme. Et l'hpital joue tour tour ce double rle: lieu des vrits systmatiques pour le regard que pose le mdecin, il est celui des expriences libres pour le savoir que formule le matre. Aot 1791, fermeture des universits; septembre, la Lgislative est dissoute. L'ambigut de ces structures complexes va se dfaire. Les Girondins se rclament d'une libert qui devrait se limiter elle-mme par son propre jeu; et leur viennent en aide tous ceux, favoriss par l'ancien tat de choses, qui pensent pouvoir, en l'absence de toute organisation, retrouver sinon leurs privilges, du moins leur influence.
Des catholiques comme Durand Maillane, d'anciens oratoriens comme Daunou ou Sieys, des modrs comme Fourcroy, sont partisans du plus extrme libralisme dans l'enseignement des sciences et des arts. Le projet de Condorcet menace, leur avis, de reconstituer une corporation formidable (2) ; on verrait renatre ce qu' peine on vient d'abolir, les gothiques universits et les aristocratiques acadmies (3) ; ds lors, il ne serait pas besoin d'attendre longtemps pour que se renoue le rseau d'un (1) CABANIS, Observations sur les hpitaux (Paris, 1790), pp. 32-33. (2) DURAND MAILLANE, J. GUILLAUME, Procs-verbaux du Comit d'Instruction publique de la Convention, t. I, p. 124. (3) FOURCROY, Rapport sur l'enseignement libre des sciences et des arts (Paris, an II) p. 2. |PAGE 49 sacerdoce plus redoutable peut-tre que celui que la raison du peuple vient de renverser (1). Aux lieux et places de ce corporatisme, l'initiative individuelle portera la vrit partout o elle sera rellement libre: Rendez au gnie toute la latitude de pouvoir et de libert qu'il rclame; proclamez ses droits imprescriptibles; prodiguez aux interprtes utiles de la nature partout o ils se trouvent les honneurs et les rcompenses publiques; ne resserrez pas dans un cercle troit les lumires qui ne cherchent qu' s'tendre (2). Pas d'organisation, mais simplement une libert donne: les citoyens clairs dans les lettres et les arts sont invits se livrer l'enseignement dans toute l'tendue de la Rpublique franaise. Ni examens, ni autres titres de comptence que l'ge, l'exprience, la vnration des citoyens; qui veut enseigner mathmatiques, beauxarts, ou mdecine, devra seulement obtenir de sa municipalit un certificat de civisme et de probit: s'il en a besoin, et s'il le mrite, il pourra aussi demander aux organismes locaux qu'on lui prte du matriel d'enseignement et d'exprimentation. Ces leons librement donnes seront, par les lves, rtribues en accord avec le matre; mais les municipalits pourront, qui le mrite, distribuer des bourses. L'enseignement, dans le rgime du libralisme conomique et de la concurrence, renoue avec la vieille libert grecque: le savoir, spontanment, se transmet par la Parole, et celle-l triomphe qui porte en elle le plus de vrit. Et comme pour donner une marque de nostalgie et d'inaccessibilit son rve, pour lui confrer un sigle plus grec encore qui rende ses intentions inattaquables et cache mieux ses relles vises, Fourcroy propose qu'aprs 25 ans d'enseignement, les matres chargs d'annes et de vnration soient, comme autant de Socrate enfin reconnus par une meilleure Athnes, nourris pour
leur longue vieillesse au Prytane. Paradoxalement, ce sont les Montagnards, et les plus proches de Robespierre, qui dfendent des ides voisines du projet de Condorcet. Le Pelletier dont le plan, aprs son assassinat, est repris par Robespierre, puis Romme (les Girondins une fois tombs) projettent un enseignement centralis et chaque chelon contrl par l'Etat; mme la Montagne, on s'inquite de ces 40000 bastilles o l'on propose de renfermer la gnration naissante (3). Bouquier, membre du Comit d'Instruction publique, soutenu par les Jacobins, offre un plan mixte, (1) Ibid., p. 2. (2) Ibid., p. 8. (3) SAINTE-Foy, Journal de la Montagne, no 29, 12 dcembre 1793. |PAGE 50 moins anarchique que celui des Girondins, moins strict que chez Le Pelletier et Romme. Il y fait une distinction importante entre les connaissances indispensables au citoyen, et sans lesquelles il ne peut devenir un homme libre -l'Etat lui doit cette instruction, comme il lui doit la libert elle-mme -et lesconnaissances ncessaires la socit : l'Etat se doit de les favoriser, mais il ne peut ni les organiser, ni les contrler comme les premires; elles servent la collectivit, elles ne forment pas l'individu. La mdecine en fait partie avec les sciences et les arts. Dans 9 villes du pays, on crera des Ecoles de Sant avec chacune 7 Instituteurs ; mais celle de Paris en aura 14. De plus, un officier de sant donnera des leons dans les hpitaux rservs aux femmes, aux enfants, aux fous et aux vnriens. Ces Instituteurs seront la fois rtribus par l'Etat (3500 livres par an), et lus par des jurys choisis par les administrateurs du district runis aux citoyens (1). Ainsi, la conscience publique trouvera dans cet enseignement la fois sa libre expression et l'utilit qu'elle recherche. Lorsque arrive Thermidor, les biens des hpitaux sont nationaliss, les corporations interdites, les socits et acadmies abolies, l'Universit, avec les Facults et les Ecoles de Mdecine, n'existe plus; mais les Conventionnels n'ont pas eu le loisir de mettre en oeuvre la politique d'assistance dont ils ont admis le principe, ni de donner des limites au libre exercice de la mdecine, ni de dfinir les comptences qui lui sont ncessaires, ni de fixer enfin les formes de son enseignement.
Une telle difficult surprend quand on songe que, pendant des dizaines d'annes, chacune de ces questions avait t discute, que tant de solutions avaient t depuis longtemps proposes, indiquant une conscience thorique des problmes; et que, surtout, la Lgislative avait pos en principe ce que, de Thermidor au Consulat, on redcouvrira comme solution. Durant toute cette priode, une structure indispensable manquait: celle qui aurait pu donner unit une forme d'exprience dj dfinie par l'observation individuelle, l'examen des cas, la pratique quotidienne des maladies, et une forme d'enseignement dont on saisit bien qu'il devrait se donner l'hpital (1) FOURCROY, loc. cit. |PAGE 51 plutt qu' Id Facult, et dans le parcours entier du monde concret de la maladie. On ne savait pas comment restituer par la parole ce qu'on savait n'tre donn qu'au regard. Le Visible n'tait pas Dicible, ni Discible. C'est que si les thories mdicales s'taient beaucoup modifies depuis un demi-sicle, si de nouvelles observations avaient t faites en grand nombre, le type d'objet auquel s'adressait la mdecine tait rest le mme; la position du sujet connaissant et percevant tait reste la mme; les concepts se formaient selon les mmes rgles. Ou plutt tout l'ensemble du savoir mdical obissait deux types de rgularit: l'un, c'tait celui des perceptions individuelles et concrtes quadrill selon le tableau nosologique des espces morbides; l'autre c'tait celui de l'enregistrement continu, global et quantitatif d'une mdecine des climats et des lieux. Toute la rorganisation pdagogique et technique de la mdecine achoppait cause d'une lacune centrale: l'absence d'un modle nouveau, cohrent et unitaire pour la formation des objets, des perceptions et des concepts mdicaux. L'unit politique et scientifique de l'institution mdicale impliquait pour tre ralise cette mutation en profondeur. Or, chez les rformateurs de la Rvolution, cette unit n'tait effectue que sous la forme de thmes thoriques qui regroupaient aprs coup des lments de savoir dj constitus. Ces thmes flottants exigeaient bien une unit de la connaissance et de la pratique mdicale; ils lui indiquaient un lieu idal; mais ils taient aussi bien le principal obstacle sa ralisation. L'ide d'un domaine transparent, sans cloisonnement, ouvert de fond en comble un regard arm pourtant de ses privilges et de sa comptence,
dissipait ses propres difficults dans les pouvoirs prts la libert: en elle, la maladie devait formuler d'elle-mme une vrit inaltre et offerte, sans trouble, au regard du mdecin; et la socit, mdicalement investie, instruite et surveille, devait se librer par l mme de la maladie. Grand mythe du libre regard, qui, dans sa fidlit dcouvrir, reoit la vertu de dtruire; regard purifi qui purifie; libr de l'ombre, il dissipe les ombres. Les valeurs cosmologiques implicites dans l'Aufklrung jouent encore ici. Le regard mdical, dont on se met reconnatre les pouvoirs, n'a pas encore reu dans le savoir clinique ses nouvelles conditions d'exercice; il n'est qu'un segment de la dialectique des Lumires transport dans l'oeil du mdecin. Par un effet li la fortune de la mdecine moderne, la clinique |PAGE 52 demeurera, pour la majorit des esprits, plus apparente ces thmes de la lumire et de la libert, qui l'ont en somme esquive, qu' la structure discursive o elle a pris effectivement naissance. On pensera volontiers que la clinique est ne dans ce libre jardin o, d'un commun consentement, mdecin et malade viennent se rencontrer, o l'observation se fait, dans le mutisme des thories, la seule clart du regard, o, de matre disciple, l'exprience se transmet en dessous mme des mots. Et au profit de cette histoire qui lie la fcondit de la clinique un libralisme scientifique, politique et conomique, on oublie qu'il fut pendant des annes, le thme idologique qui fit obstacle l'organisation de la mdecine clinique. |PAGE 53 CHAPITRE IV Vieillesse de la Clinique Le principe que le savoir mdical se forme au lit mme du malade ne date pas de la fin du XVIIIe sicle. Beaucoup, sinon toutes les rvolutions de la mdecine ont t faites au nom de cette exprience pose comme source premire et norme constante. Mais ce qui se modifiait sans cesse, c'tait la grille mme selon laquelle cette exprience se donnait, s'articulait en lments analysables et trouvait une formulation discursive. Non seulement le nom des maladies, non seulement le groupement des symptmes n'taient pas les mmes; mais ont vari aussi les codes perceptifs fondamentaux qu'on
appliquait au corps des malades, le champ des objets auxquels s'adressait l'observation, les surfaces et profondeurs que parcourait le regard du mdecin, tout le systme d'orientation de ce regard. Or, depuis le XVIIIe sicle, la mdecine a une certaine tendance raconter sa propre histoire comme si le lit des malades avait toujours t un lieu d'exprience constant et stable, par opposition aux thories et systmes qui auraient t en perptuel changement et auraient masqu sous leur spculation la puret de l'vidence clinique. Le thorique aurait t lment de la perptuelle modification, le point partir duquel se dploient toutes les variations historiques du savoir mdical, le lieu des conflits et des disparitions; c'est dans cet lment thorique que le savoir mdical marquerait sa fragile relativit. Au contraire, la clinique aurait t l'lment de son accumulation positive: c'est ce constant regard sur le malade, cette attention millnaire et pourtant neuve en chaque instant qui aurait permis la mdecine de ne pas disparatre entirement avec chacune de ses spculations, mais de se conserver, de prendre peu peu |PAGE 54 la figure d'une vrit qui serait dfinitive sans tre acheve pour autant, bref, de se dvelopper, au-dessous des pisodes bruyants de son histoire, dans une historicit continue. Dans l'invariant de la clinique, la mdecine aurait nou la vrit et le temps. De l, tous ces rcits un peu mythiques dans lesquels on a rassembl, la fin du XVIIIe sicle et au dbut du XIXe, l'histoire de la mdecine. C'est dans la clinique, disait-on, que la mdecine avait trouv sa possibilit d'origine. A l'aube de l'humanit, avant toute vaine croyance, avant tout systme, la mdecine en son entier rsidait dans un rapport immdiat de la souffrance ce qui la soulage. Ce rapport tait d'instinct et de sensibilit, plus encore que d'exprience; il tait tabli par l'individu de lui-mme lui-mme, avant d'tre pris dans un rseau social: La sensibilit du malade lui apprend que telle ou telle position le soulage ou le tourmente (1). C'est ce rapport, tabli sans la mdiation du savoir, qui est constat par l'homme sain; et cette observation mme n'est pas option pour une connaissance venir; elle n'est pas mme prise de conscience; elle s'accomplit dans l'immdiat et l'aveugle: Une voix secrte nous dit ici: contemple la nature (2) ; multiplie par elle-mme, transmise des uns aux autres, elle devient une forme gnrale de conscience dont chaque individu est la fois le sujet et l'objet: Tout le monde indistinctement pratiquait cette mdecine... les expriences que chacun faisait taient communiques d'autres personnes... et ces connaissances
passaient du pre aux enfants (3). Avant d'tre un savoir, la clinique tait un rapport universel de l'humanit elle-mme: ge de bonheur absolu pour la mdecine. Et la dchance commena quand furent inaugurs l'criture et le secret, c'est--dire la rpartition de ce savoir dans un groupe privilgi, et la dissociation du rapport immdiat, sans obstacle ni limites, entre Regard et Parole: ce qu'on avait su n'tait plus communiqu aux autres et revers au compte de la pratique qu'une fois pass par l'sotrisme du savoir (4). Longtemps, sans doute, l'exprience mdicale demeura ouverte, et sut trouver entre le voir et le savoir un quilibre (1) CANTIN, Projet de rforme adress l'Assemble Nationale (Paris, 1790), p. 8. (2) Ibid. (3) COAKLEY LETTSON, Histoire de l'origine de la mdecine (trad. fr., Paris, 1787), p. 7. (4) Ibid., pp. 9-10. |PAGE 55 qui la protgea de l'erreur: Dans les temps loigns, l'art de la mdecine s'enseignait en prsence de son objet et les jeunes gens apprenaient la science mdicale au lit du malade ; ceux-ci bien souvent taient logs au domicile mme du mdecin, et les lves accompagnaient les matres, matin et soir dans la visite de ses clients (1). De cet quilibre, Hippocrate serait la fois le dernier tmoin et le reprsentant le plus ambigu: la mdecine grecque du Ve sicle ne serait pas autre chose que la codification de cette clinique universelle et immdiate; elle en formerait la premire conscience totale, et en ce sens, elle serait aussi simple et pure (2) que cette exprience premire; mais dans la mesure o elle l'organise en un corps systmatique afin d'en faciliter et d'en abrger l'tude, une dimension nouvelle est introduite dans l'exprience mdicale: celle d'un savoir qu'on peut dire, la lettre, aveugle, puisqu'il est sans regard. Cette connaissance qui ne voit pas est l'origine de toutes les illusions; une mdecine hante par la mtaphysique devient possible: Aprs qu'Hippocrate eut rduit la mdecine en systme, l'observation fut abandonne et la philosophie s'y introduisit (3). Telle est l'occultation qui a permis la longue histoire des systmes, avec la multiplicit des diffrentes sectes opposes et contradictoires (4). Histoire qui s'annule par l mme, ne conservant du temps que sa marque destructrice. Mais, sous celle qui dtruit, veille une autre histoire, plus fidle au temps parce que plus proche de sa vrit d'origine. En celle-ci se recueille imperceptiblement la vie sourde de la clinique. Elle demeure sous les thories spculatives
(5), maintenant la pratique mdicale au contact du monde peru et l'ouvrant au paysage immdiat de la vrit: De tout temps, il a exist des mdecins qui aprs avoir, l'aide de l'analyse si naturelle l'esprit humain, dduit de l'aspect du malade toutes les donnes ncessaires sur son idiosyncrasie, se sont contents d'tudier les symptmes... (6). Immobile, mais toujours proche des choses, la clinique donne la mdecine son vritable mouvement historique ; elle efface les systmes, cependant que l'exprience qui les (1) P. MOSCATI, De l'emploi des systmes dans la mdecine pratique (trad. fr., Strasbourg, an VII), p. 13. (2) P.-A.-O. MAHON, Histoire de la mdecine clinique (Paris, an XII), p. 323. (3) MOSCATI, loc. cit., pp. 4-5. (4) Ibid., p. 26. (5) DEZEIMERIS, Dictionnaire historique de la mdecine (Paris, 1828) t. I, article, Clinique, pp. 830-837. (6) J.-B. REGNAULT, Considrations sur l'Etat de la mdecine (Paris 1819), p. 10. |PAGE 56 dment accumule sa vrit. Ainsi, se trame une continuit fconde qui assure la pathologie l'uniformit ininterrompue de cette science dans les diffrents sicles (1). Contre les systmes, qui appartiennent au temps ngateur, la clinique est le temps positif du savoir. On n'a donc pas l'inventer, mais il la redcouvrir: elle tait l dj avec les formes premires de la mdecine; elle en a constitu toute la plnitude ; il suffit donc de nier ce qui la nie, de dtruire ce qui par rapport elle est nant, c'est--dire le prestige des systmes, et la laisser enfin ce jouir de tous ses droits (2). La mdecine alors sera de plain-pied avec sa vrit. Ce rcit idal, qu'on trouve si frquemment la fin du XVIIIe sicle, doit se comprendre par rfrence la mise en place rcente des institutions et des mthodes cliniques: il leur donne un statut la fois universel et historique. Il les fait valoir comme restitution d'une vrit de toujours dans un dveloppement historique continu o les seuls vnements ont t d'un ordre ngatif: oubli, illusion, occultation. En fait, une pareille manire de rcrire l'histoire esquivait elle-mme une histoire beaucoup plus complexe. Elle la masquait en rduisant la mthode clinique n'importe quelle tude de cas, conformment au vieil usage du mot; et par l, elle autorisait toutes les simplifications ultrieures qui devaient faire de la clinique et qui en font encore de nos jours un pur et simple examen de l'individu.
Pour comprendre le sens et la structure de l'exprience clinique, il faut refaire d'abord l'histoire des institutions dans lesquelles s'est manifest son effort d'organisation. Jusqu'aux dernires annes du XVIIIe sicle, cette histoire prise comme suite chronologique est fort limite. En 1658, Franois de La Boe ouvre une cole clinique l'hpital de Leyden : il en publie les observations sous le titre Collegium Nosocomium (3). Le plus illustre de ses successeurs sera Boerhaave; il se peut cependant qu'il y ait eu ds la fin du XVIe sicle une chaire de clinique Padoue. En tout cas, c'est de Leyde, avec Boerhaave et ses lves, que partit, au (1) P.-A.-O. MAHON, Histoire de la mdecine clinique (Paris, an XII), p. 324. (2) Ibid., p. 323. (3) Leyden, 1667. |PAGE 57 XVIIIe sicle, le mouvement de cration, travers toute l'Europe, de chaires ou d'Instituts cliniques. Ce sont des disciples de Boerhaave qui, en 1720, rforment l'Universit d'Edimbourg et crent une clinique sur le modle de Leyde; elle est imite Londres, Oxford, Cambridge, Dublin (1). En 1733, on demande Van Swieten un plan pour l'tablissement d'une clinique l'hpital de Vienne: le titulaire en est un autre lve de Boerhaave, de Haen, auquel succdent Stoll puis Hildenbrand (2); l'exemple est suivi Gttingen o enseignent tout tour Brendel, Vogel, Baldinger et J.-P. Franck (3) ; Padoue, quelques lits de l'hpital sont consacrs la clinique, avec Knips comme professeur ; Tissot, charg d'organiser une clinique Pavie, en fixe le plan dans sa leon inaugurale le 26 novembre 1781 (4) ; vers 1770 Lacassaigne, Bourru, Guilbert et Colombier avaient voulu organiser titre priv et leurs frais une maison de sant de 12 lits, rserve aux maladies aigus; les mdecins traitants y auraient en mme temps enseign la pratique (5) ; mais le projet choue. La Facult, le corps des mdecins en gnral, avaient trop intrt ce que se maintienne l'ancien tat de choses o un enseignement pratique tait donn en ville, titre individuel et onreux, par les consultants les plus notables. C'est dans les hpitaux militaires que l'enseignement clinique fut d'abord organis; le Rglement pour les hpitaux tabli en 1775 porte en son article XIII que chaque anne d'tude doit comprendre un cours de pratique et clinique des principales maladies qui rgnent parmi les troupes dans les armes et garnisons (6). Et Cabanis cite en exemple la clinique de l'hpital de
la marine Brest fonde par Dubreil sous les auspices du marchal de Castries (7). Notons enfin la cration en 1787 d'une clinique d'accouchement Copenhague (8). Telle est, semble-t-il, la suite des faits. Pour en comprendre le sens et cerner les problmes quelle pose, il faut d'abord revenir sur un certain nombre de constatations qui devraient en diminuer l'importance. L'examen des cas, leur compte (1) J. AIKIN, Observations suries hpitaux (trad. fr., Paris, 1777), pp. 94-95. (2) A. STORCK, Instituta Facultatis medicae Vivobonensis (Vienne, 1775). (3) DEZEIMERIS, Dictionnaire historique de la mdecine (Paris, 1828), t. I, pp. 830-837 (article. Clinique). (4) TISSOT, Essai sur les tudes de mdecine (Lausanne, 1785), p. 118. (5) COLOMBIER, Code de Justice militaire, Il, pp. 146-147. (6) Rglement pour les hpitaux militaires de Strasbourg, Metz et Lille, fait sur ordre du roi par P. HAUDESIERCK (1775), cit par BOULIN, Mmoires pour servir l'histoire de la mdecine (Paris, 1776), t. 1 l, pp. 73-80. (7) CABANIS, Observations sur les hpitaux (Paris, 1790), p. 31. (8) J.-B. DEMANGEON, Tableau historique d'un triple tablissement runi en un seul hospice Copenhague (Paris, an VII). |PAGE 58 rendu dtaill, leur rapport une explication possible est une tradition fort ancienne dans l'exprience mdicale; l'organisation de la clinique n'est donc pas corrlative de la dcouverte du fait individuel dans la mdecine; les innombrables recueils de cas rdigs depuis la Renaissance suffisent en donner la preuve. D'autre part, la ncessit d'un enseignement par la pratique elle-mme tait, elle aussi, trs largement reconnue : la visite des hpitaux par les apprentis mdecins tait chose acquise; et il arrivait que certains d'entre eux achvent leur formation dans un hpital o ils vivaient et exeraient sous la direction d'un mdecin (1). Dans ces conditions, de quelle nouveaut et de quelle importance pouvaient tre ces tablissements cliniques auxquels le XVIIIe sicle, en sa fin surtout, attachait tant de prix? En quoi cette proto-clinique pouvait-elle se distinguer la fois d'une pratique spontane qui avait fait corps avec la mdecine, et de la clinique telle qu'elle s'organisera plus tard en un corps complexe et cohrent o se joignent une forme d'exprience, une mthode d'analyse et un type d'enseignement? Peut-on lui
dsigner une structure spcifique qui serait propre, sans doute, l'exprience mdicale du XVIIIe sicle dont elle est la contemporaine? 1. Cette proto-clinique est plus qu'une tude successive et collective de cas: elle doit runir et rendre sensible le corps organis de la nosologie. La clinique ne sera donc ni ouverte au tout venant, comme peut l'tre la pratique quotidienne d'un mdecin, ni non plus spcialise, comme elle le sera au XIXe sicle: elle n'est ni le domaine clos de ce qu'on a choisi d'tudier, ni le champ statistique ouvert de ce qu'on est vou recevoir; elle se referme sur la totalit didactique d'une exprience idale. Elle n'a pas charge de montrer des cas, leurs points dramatiques, leurs accents individuels, mais de manifester en un parcours complet le cercle des maladies. La clinique d'Edimbourg fut longtemps un modle du genre; elle est constitue de telle sorte que s'y trouvent runis les cas qui paraissent les plus propres instruire (2). Avant d'tre rencontre du malade et du mdecin, d'une vrit dchiffrer et d'une ignorance, et pour pouvoir l'tre, la clinique doit former, constitutionnellement, un champ nosologique tout structur. (1) Tel tait le cas en France, par exemple pour l'Hpital Gnral; pendant tout le XVIIIe sicle un apprenti chirurgien vivait la Salptrire, suivait le chirurgien dans ses visites et donnait lui-mme quelques soins rudimentaires. (2) AIKIN, Observations sur les hpitaux (trad. fr., Paris, 1777), pp. 94-95. |PAGE 59 2. Son mode de branchement sur l'hpital est particulier. Elle n'en est pas l'expression directe, puisqu'un principe de choix sert entre elle et lui de limite slective. Cette slection n'est pas simplement quantitative, bien que le chiffre optimal des lits d'une clinique ne doive pas, selon Tissot, excder une trentaine (1); elle n'est pas seulement qualitative, bien qu'elle porte de prfrence sur tel ou tel cas haute valeur instructive. En triant, elle altre en sa nature mme le mode de manifestation de la maladie, et le rapport de celleci au malade; l'hpital on a affaire des individus qui sont indiffremment porteurs d'une maladie ou d'autre autre; le rle du mdecin d'hpital est de dcouvrir la maladie dans le malade; et cette intriorit de la maladie fait qu'elle est souvent enfouie dans le malade, cache en lui comme un cryptogramme. A la clinique, on a affaire inversement des maladies dont le porteur est indiffrent: ce qui est prsent, c'est la maladie elle-mme, dans le corps qui lui est propre et qui n'est pas celui du malade, mais celui de sa vrit. Ce sont les diffrentes maladies qui servent de texte (2) : le malade est seulement ce travers quoi le texte est donn lire, parfois compliqu et brouill. A l'hpital, le malade est sujet de sa maladie;
c'est--dire qu'il s'agit d'un cas; la clinique, o il n'est question que d'exemple le malade est l'accident de sa maladie, l'objet transitoire dont elle s'est empare. 3. La clinique n'est pas un instrument pour dcouvrir une vrit encore inconnue; c'est une certaine manire de disposer la vrit dj acquise et de la prsenter pour qu'elle se dvoile systmatiquement. La clinique est une sorte de thtre nosologique dont l'lve ne connat pas, d'entre de jeu, la clef. Tissot prescrit de la lui faire longtemps chercher. Il conseille de confier chaque malade de la clinique deux tudiants; ce sont eux, et eux seuls, qui l'examineront avec dcence, avec douceur, avec cette bont qui est si consolante pour ces pauvres infortuns (3). Ils commenceront par l'interroger sur sa patrie, et les constitutions qui y rgnent, sur son mtier, ses maladies antrieures; la manire dont celle-ci a commenc, les remdes pris; ils feront l'investigation de ses fonctions vitales (respiration, pouls, temprature), de ses fonctions naturelles (soif, apptit, excrtions), et de ses fonctions animales (sens, facults, (1) TISSOT, Mmoire pour la construction d'un hpital clinique, in Essai sur les tudes mdicales (Lausanne, 1785). (2) CABANIS, Observations Sur les hpitaux, p. 30. (3) TISSOT, loc. cit., p. 120. |PAGE 60 sommeil, douleur) ; ils devront aussi lui palper le bas-ventre pour constater l'tat de ses viscres (1). Mais que cherchent-ils ainsi, et quel principe hermneutique doit guider leur examen? Quels sont les rapports tablis entre les phnomnes constats, les antcdences apprises, les troubles et les dficits remarqus? Rien d'autre que ce qui permet de prononcer un nom, celui de la maladie. La dsignation une fois faite, on en dduira aisment les causes, le pronostic, les indications en se demandant: qu'est-ce qui pche dans ce malade? Qu'y a-t-il par l mme changer? (2). Par rapport aux mthodes ultrieures d'examen, celle recommande par Tissot n'est gure moins mticuleuse, quelques dtails prs. La diffrence de cette enqute avec l'examen clinique est en ceci qu'on n'y fait pas l'inventaire d'un organisme malade; on y relve les lments qui permettront de mettre la main sur une clef idale -clef qui a quatre fonctions puisqu'elle est un mode de dsignation, un principe de cohrence, une loi d'volution et un corps de prceptes. En d'autres termes, le regard qui parcourt un corps souffrant ne rejoint la vrit qu'il cherche qu'en passant par le moment dogmatique du nom en qui se recueille une double vrit: celle, cache mais dj prsente,
de la maladie, celle, clairement dductible, de l'issue et des moyens. Ce n'est donc pas le regard lui-mme qui a pouvoir d'analyse et de synthse; mais la vrit d'un savoir discursif qui vient s'ajouter de l'extrieur et comme une rcompense au regard vigilant de l'colier. Dans cette mthode clinique o l'paisseur du peru ne cache que l'imprieuse et laconique vrit qui nomme, il s'agit non d'un examen, mais d'un dcryptement. 4. On comprend dans ces conditions que la clinique n'ait eu qu'une seule direction : celle qui va, de haut en bas, du savoir constitu l'ignorance. Au XVIIIe sicle, il n'y a de clinique que pdagogique, et encore sous une forme restreinte puisqu'on n'admet pas que le mdecin lui-mme puisse chaque instant lire, par cette mthode, la vrit que la nature a dpose dans le mal. La clinique ne concerne que cette instruction, au sens troit, qui est donne par le matre ses lves. Elle n'est pas en elle-mme une exprience, mais le condens, l'usage des autres, d'une exprience antrieure. Le professeur indique ses lves l'ordre dans lequel les objets doivent tre observs pour tre mieux vus et mieux se graver dans la mmoire; (1) Ibid., pp. 121-123. (2) Ibid., p. 124. |PAGE 61 il leur abrge leur travail; il les fait profiter de son exprience (1). En aucune manire la clinique ne dcouvrira par le regard; elle doublera seulement l'art de dmontrer en montrant. C'est ainsi que Desault avait compris les leons de clinique chirurgicale qu'il donnait depuis 1781 l'Htel-Dieu; Sous les yeux de ses auditeurs, il faisait amener les malades les plus gravement affects, classait leur maladie, en analysait les traits, traait la conduite tenir, pratiquait les oprations ncessaires, rendait compte de ses procds et de leurs motifs, instruisait chaque jour des changements survenus, et prsentait ensuite l'tat des parties aprs la gurison... ou dmontrait sur le corps priv de vie les altrations qui avaient rendu l'art inutile (2). 5. L'exemple de Desault montre cependant que cette parole, pour didactique qu'elle ft en son essence, acceptait malgr tout le jugement et le risque de l'vnement. Au XVIIIe sicle, la clinique n'est pas une structure de l'exprience mdicale, mais elle est exprience au moins en ce sens qu'elle est preuve: preuve d'un savoir que le temps doit confirmer, preuve de prescriptions auxquelles l'issue donnerait tort ou raison, et ceci devant le jury spontan que constituent les tudiants: il y a comme une joute
devant tmoins avec la maladie qui a son mot dire et qui, malgr la parole dogmatique qui a pu la dsigner, tient son langage propre. Si bien que la leon donne par le matre peut se retourner contre lui, et profrer au-dessus de son vain langage, un enseignement qui est celui de la nature elle-mme. Cabanis explique ainsi cette leon de la mauvaise leon: si le professeur se trompe, ses fautes sont bientt dvoiles par la nature... dont il est impossible d'touffer ou d'altrer le langage. Souvent mme elles deviennent plus utiles que ses succs et rendent plus inefficaces des images qui, sans cela peuttre, n'eussent fait sur eux que des impressions passagres (3). C'est donc quand la dsignation magistrale choue et lorsque le temps l'a rendue drisoire, que le mouvement de la nature est reconnu pour lui-mme: le langage du savoir se tait, et on regarde. La probit de cette preuve clinique tait grande puisqu'elle se liait son propre enjeu par une sorte de contrat quotidiennement renouvel. A la clinique d'Edimbourg, les tudiants tenaient cahier du diagnostic port, de l'tat du malade chaque visite, et des mdicaments pris (1) CABANIS, Observations sur les hpitaux (Paris, 1790), p. 30. (2) M.-A. PETIT, Eloge de Desault, in Mdecine du Coeur, p. 108. (3) CABANIS, Observations sur les hpitaux, p. 30. |PAGE 62 dans la journe (1). Tissot, qui, lui aussi, recommande qu'on fasse un journal, ajoute dans le rapport au comte Firmian o il dcrit la clinique idale, qu'on devrait en faire chaque anne la publication (2). Enfin, la dissection, en cas de dcs, doit permettre une dernire confirmation (3). Ainsi la parole savante et synthtique qui dsigne s'ouvre sur un champ d'ventualits observes pour former une chronique des constatations. On le voit: l'institution clinique telle qu'elle tait tablie ou projete, tait encore trop drive des formes dj constitues du savoir pour avoir une dynamique propre et entraner par sa seule force une transformation gnrale de la connaissance mdicale. Elle ne peut pas dcouvrir par elle-mme de nouveaux objets, former de nouveaux concepts, ni disposer autrement le regard mdical. Elle pousse et organise une certain forme du discours mdical; elle n'invente pas un nouvel ensemble de discours et de pratiques. Au XVIIIe sicle, la clinique est donc une figure bien plus complexe dj qu'une pure et simple connaissance des cas. Et cependant, elle n'a pas jou un rle spcifique dans le mouvement mme de la connaissance scientifique; elle forme une structure marginale qui
s'articule au champ hospitalier sans avoir la mme configuration que lui; elle vise l'apprentissage d'une pratique qu'elle rsume plus qu'elle ne l'analyse; elle regroupe toute l'exprience autour des jeux d'un dvoilement verbal qui n'en est que la simple forme de transmission, thtralement retarde. Or, en quelques annes, les dernires du sicle, la clinique va tre brusquement restructure: dtache du contexte thorique o elle tait ne, elle va recevoir un champ d'application non plus limit celui o se dit un savoir, mais coextensif celui o il nat, s'prouve et s'accomplit: elle fera corps avec le tout de l'exprience mdicale. Encore faut-il qu'elle ait t pour cela arme de nouveaux pouvoirs, dtache du langage partir duquel on la profrait comme leon et libre pour un mouvement de dcouverte. (1) J. AIKIN, Observations sur les hpitaux (trad. fr., 1777). p. 95. (2) TISSOT, Mmoire pour la construction d'un hpital clinique, in Essai sur les tudes mdicales. (3) Cf. TISSOT, ibid., et M.-A. PETIT, Eloge de Desault, cit plus haut. |PAGE 63
CHAPITRE V La Leon des Hpitaux Dans l'article Abus du Dictionnaire de Mdecine, Vicq d'Azyr prte l'organisation d'un enseignement en milieu hospitalier valeur de solution universelle pour les problmes de la formation mdicale; l est la rforme, pour lui majeure, accomplir: Les maladies et la mort offrent de grandes leons dans les hpitaux. En profite-t-on ? Ecrit-on l'histoire des maux qui y frappent tant de victimes? Y enseigne-t-on l'art d'observer et de traiter les maladies? Y a-t-on tabli des chaires de mdecine clinique? (1). Or, en peu de temps, cette rforme de la pdagogie va prendre une signification infiniment plus large; on lui reconnatra la facult de rorganiser toute la connaissance mdicale et d'instaurer, dans le savoir de la maladie elle-mme, des formes d'exprience inconnues ou oublies, mais plus fondamentales et plus dcisives: la clinique et la seule clinique pourra renouveler chez les modernes des temples d'Apollon et d'Esculape (2). Manire d'enseigner et de dire devenue manire d'apprendre et de voir. A la fin du XVIIIe sicle, la pdagogie comme systme des normes de formation s'articulait directement sur la thorie de la reprsentation et de l'enchanement des ides. L'enfance, la jeunesse des choses et des hommes taient charges d'un pouvoir ambigu: dire la naissance
de la vrit; mais aussi mettre l'preuve la vrit tardive des hommes, la rectifier, la rapprocher de sa nudit. L'enfant devient le matre immdiat de l'adulte dans la mesure o la vraie formation s'identifie la gense (1) VICQ D'AZYR, Oeuvres (Paris, 1805), t. V, p. 64. (2) DEMANGEON, Du moyen de perfectionner la mdecine, p. 29. |PAGE 64 mme du vrai. Inlassablement, en chaque enfant, les choses rptent leur jeunesse, le monde reprend contact avec sa forme natale: il n'est jamais adulte pour qui le regarde la premire fois. Quand il a dnou ses parents vieillies, l'oeil peut s'ouvrir au ras des choses et des ges; et de tous les sens et de tous les savoirs, il a 1 habilet de pouvoir tre le plus malhabile en rptant agilement sa lointaine ignorance. L'oreille a ses prfrences, la main ses traces et ses plis; l'oeil, qui a parent avec la lumire, ne supporte que son prsent. Ce qui permet l'homme de renouer avec l'enfance et de rejoindre la permanente naissance de la vrit, c'est cette navet claire, distante, ouverte du regard. D'o les deux grandes expriences mythiques o la philosophie du XVIIIe sicle a voulu fonder son commencement: le spectateur tranger dans un pays inconnu et 1'aveugle de naissance rendu la lumire. Mais Pestalozzi et les Bildung romane s'inscrivent eux aussi dans le grand thme du Regard-Enfance. Le discours du monde passe par des yeux ouverts, et ouverts chaque instant comme pour la premire fois. Aussitt arrive la raction thermidorienne, le pessimisme de Cabanis et de Gant in semble confirm : le brigandage prvu (1) s'installe partout. Depuis le dbut de la guerre, mais surtout depuis la leve en masse de l'automne 93, beaucoup de mdecins sont partis pour l'arme, volontaires ou appels; les empiriques ont les coudes franches (2). Une ptition adresse le 26 brumaire an II la Convention et rdige par un certain Caron, de la section Poissonnire, dnonait encore dans les mdecins forms par la Facult de vulgaires charlatans contre lesquels le peuple voulait tre dfendu (3). Mais trs vite, cette crainte change de signe, et le danger est peru du ct des charlatans qui ne sont pas mdecins: Le public est victime d'une foule d'individus peu instruits qui, de leur autorit, sont rigs en matres de l'art, qui distribuent des remdes au hasard, et compromettent l'existence de plusieurs milliers de (1) CANTIN, Projet de rforme adress l'Assemble (Paris, 1790), p. 13. (2) LIOULT, Les charlatans dvoils (Paris, an VIII), avant-propos non
pagin. (3) A.N. 17, A 1146, d. 4 cit par A. SOBOUL, Les Sans-Culottes parisiens en l'an I (Paris, 1958), p. 494, n. 127. |PAGE 65 citoyens (1). Les dsastres de cette mdecine l'tat sauvage sont tels dans un dpartement comme celui de l'Eure que le Directoire, alert, en saisit l'Assemble des Cinq-Cents (2) et, deux reprises, le 13 messidor an IV et le 24 nivse an VI, le gouvernement demande au pouvoir lgislatif de limiter cette prilleuse libert: 0 citoyens reprsentants, la patrie fait entendre ses cris maternels et le Directoire excutif en est l'organe! C'est bien sur une telle matire quil y a urgence: le retard d'un jour est peut-tre un arrt de mort pour plusieurs citoyens (3). Les mdecins improviss ou les empiriques chevronns sont d'autant plus redoutables que l'hospitalisation des malades pauvres devient de plus en plus difficile. La nationalisation des biens hospitaliers a t parfois jusqu' la confiscation de l'argent liquide, et bien des conomes ( Toulouse, Dijon) ont t obligs de renvoyer purement et simplement les pensionnaires qu'ils ne pouvaient plus entretenir. Les blesss ou malades militaires occupent de nombreux tablissements: et les municipalits s'en flicitent, qui n'ont plus alors trouver de ressources pour leurs hpitaux: Poitiers, le 15 juillet 1793, on renvoie les 200 malades de l'Htel-Dieu pour faire place aux blesss militaires pour qui l'arme paie pension (4). Cette dshospitalisation de la maladie que les faits imposent dans une convergence singulire avec les grandes rveries rvolutionnaires, loin de restituer les essences pathologiques une vrit de nature qui les rduirait par l mme, en multiplie les ravages et laisse la population sans protection ni secours. Sans doute de nombreux officiers de sant librs de l'arme, viennent-ils s'installer comme mdecins de ville ou de campagne la fin de la priode thermidorienne ou au dbut du Directoire. Mais cette nouvelle implantation mdicale n'est pas de qualit homogne. Beaucoup d'officiers de sant n'ont qu'une formation et une exprience trs insuffisantes. En l'an II, le Comit de Salut public avait demand au Comit d'Instruction publique de prparer un projet de dcret dfinissant la manire de former sans dlai pour le besoin des armes de la Rpublique des officiers de sant (5) ; mais l'urgence avait t trop grande, on avait pris (1) Message du Directoire au Conseil des Cinq-Cents du 24 nivse an VI cit par Baraillon dans son rapport du 6 germinal an VI. (2) 22 brumaire et 4 frimaire an V.
(3) Message du 24 nivse an VI. (4) P. RAMBAUD, L'Assistance publique Poitiers jusqu' l'an V, t. II, p. 200. (5) GUILLAUME, Procs-verbaux du Comit d'Instruction publique de la Convention, t. IV, pp. 878-879. |PAGE 66 tous les volontaires, on avait form sur place le personnel indispensable, et hormis les officiers de sant de premire classe, qui devaient tmoigner d'une formation pralable, tous les autres ne connaissaient de la mdecine que ce qu'ils en apprenaient peu peu grce une exprience htivement transmise. Dj, l'arme, on avait pu leur reprocher bien des erreurs (1). Exerant au milieu de la population civile, et sans contrle hirarchique, de tels mdecins commettent des ravages bien pires: on cite cet officier de sant dans la Creuse qui tue ses malades en les purgeant l'arsenic (2). De toutes parts, on demande des instances de contrle et une nouvelle lgislation:De combien d'ignorants assassins n'inonderiez-vous pas la France, si vous autorisiez les mdecins, chirurgiens et pharmaciens de 2e et 3e classe... pratiquer leurs professions respectives sans un nouvel examen; ...c'est surtout dans cette Socit homicide qu'on trouve toujours les charlatans les plus accrdits, les plus dangereux, ceux que la loi doit plus particulirement surveiller (3). Contre cet tat de choses, des organismes de protection naissent spontanment. Les uns, trs prcaires, sont d'origine populaire. Si certaines sections parisiennes, les plus modres, restent fidles l'axiome des Montagnards: Plus d'indigents, plus d'hpitaux, et continuent demander la distribution de secours individuels au profit de malades qui seront soigns domicile (4), d'autres, parmi les plus pauvres, sont bien contraintes, devant la pnurie des subsistances et la difficult recevoir des soins, de rclamer les crations d'hpitaux o les malades indigents seraient reus, nourris et traits; on souhaite en revenir au principe des hospices pour les pauvres (5) ; des maisons furent effectivement cres, en dehors videmment de toute initiative gouvernementale, et avec des fonds runis par les socits et assembles populaires (6). Aprs Thermidor au contraire, c'est d'en haut que vient le mouvement. Les classes claires, les cercles intellectuels, revenus au pouvoir ou y accdant enfin, souhaitent restituer au savoir les privilges qui sont susceptibles de protger la fois l'ordre social et les existences (1) BARAILLON, Rapport au Conseil des Cinq-Cents (6 germinal an VI), p. 6, propos du scandale des amputations. (2) Ibid.
(3) Opinion de Porcher au Conseil des Anciens (sance du 16 vendmiaire an VI), pp. 14-15. (4) Par la section des Lombards, cf. SOBOUL, loc. cit., p. 495. (5) Adresse de la section de l'Homme arm, des Invalides et Lepeletier la Convention (ibid.). (6) Hospice pour les femmes enceintes tabli par la Section du Contrat social. |PAGE 67 individuelles. Dans plusieurs grandes villes, les administrations effrayes des maux dont elles taient les tmoins et affliges du silence de la loi n'attendent pas les dcisions du pouvoir lgislatif: elles dcident d'tablir d'elles-mmes un contrle sur ceux qui prtendent exercer la mdecine; elles crent des commissions formes de mdecins d'Ancien Rgime, qui doivent juger des titres, du savoir et de l'exprience des nouveaux venus (1). Il y a plus: certaines Facults abolies continuent fonctionner dans une semiclandestinit : les anciens professeurs runissent ceux qui veulent s'instruire et se font accompagner par eux dans leurs visites; s'ils sont chargs d'un service l'hpital, c'est l, au lit des malades, qu'ils donneront leur enseignement et qu'ils pourront juger de l'aptitude de leurs lves. Il arrive mme qu' la suite de ces tudes purement prives, la fois pour les sanctionner et mieux marquer les distances, une sorte de diplme officieux soit dlivr, attestant que l'colier est devenu un vrai mdecin. C'est ce qui se produit dans certaines provinces particulirement modres, Caen ou Douai. Montpellier offre un exemple, assez rare sans doute, de rencontre entre ces diverses formes de raction: on y voit apparatre la fois la ncessit de former des mdecins pour l'arme, l'utilisation des comptences mdicales consacres par l'Ancien Rgime, l'intervention des assembles populaires, celle aussi de l'administration et l'esquisse spontane d'une exprience clinique. Baumes, ancien professeur l'Universit, avait t dsign, la fois cause de son exprience et de ses opinions rpublicaines, pour exercer l'hpital militaire de Saint-Eloi. A ce titre, il devait faire un choix parmi les candidats aux fonctions d'officiers de sant; mais comme aucun enseignement n'tait organis, les lves en mdecine intervinrent auprs de la socit populaire; et celle-ci, par une ptition, obtint de l'administration du district la cration d'un enseignement clinique l'hpital Saint-Eloi et celui-ci est attribu Baumes. L'anne suivante, en 1794, Baumes publie le rsultat de ses observations et de son enseignement: Mthode de gurir les maladies suivant qu'elles paraissent dans le cours de l'anne
mdicinale (2). Cet exemple est sans doute privilgi, il n'en est pas moins significatif. Par la rencontre et l'entrecroisement de pressions et (1) E. PASTORET, Rapport fait au nom de la Commission d'Instruction publique sur un mode provisoire d'examen pour les officiers de sant (16 thermidor an V), p. 2. (2) A. GIRBAL, Essai sur l'esprit de la clinique mdicale de Montpellier (Montpellier, 1858), p. 7-11. |PAGE 68 d'exigences venant de classes sociales, de structures institutionnelles, de problmes techniques ou scientifiques fort diffrents les uns des autres, une exprience est en train de se former. Apparemment, elle ne fait que remettre jour, comme seule voie de salut possible, la tradition clinique que le XVIIIe sicle avait labore. En fait, c'est d'autre chose dj qu'il s'agit. Dans ce mouvement autonome et la quasi-clandestinit qui l'a suscit et le protge, ce retour la clinique est en fait la premire organisation d'un champ mdical la fois mixte et fondamental: mixte puisque l'exprience hospitalire dans sa pratique quotidienne y rejoint la forme gnrale d'une pdagogie; mais fondamental aussi parce qu' la diffrence de la clinique du XVIIIe sicle, il ne s'agit pas de la rencontre, aprs coup, d'une exprience dj forme et d'une ignorance informer; il s'agit d'une nouvelle disposition des objets du savoir: un domaine o la vrit s'enseigne d'elle-mme et de la mme faon au regard de l'observateur expriment et celui de l'apprenti encore naf; pour l'un et pour l'autre, il n'y a qu'un seul langage: l'hpital, o la srie des malades examins est, en ellemme, cole. La double abolition des vieilles structures hospitalires et de l'universit permettait ainsi la communication immdiate de l'enseignement avec le champ concret de l'exprience ; mais plus encore, elle effaait le discours dogmatique comme moment essentiel dans la transmission de la vrit; la mise au silence de la parole universitaire, la suppression de la chaire, a permis que se noue audessous du vieux langage et dans l'ombre d'une pratique un peu aveugle, bouscule par les circonstances, un discours dont les rgles taient toutes nouvelles: il devait s'ordonner un regard qui ne se contente plus de constater, mais qui dcouvre. Dans ce recours htif la clinique, une autre clinique naissait, celle, bientt du XIXe sicle. Il ne faut pas s'tonner si brusquement, la fin de la Convention, le thme d'une mdecine tout entire organise autour de la clinique, dborde celui, dominant jusqu'en 1793, d'une mdecine restitue la libert. Il ne s'agit vrai dire ni d'une raction (bien que les
consquences sociales en aient t gnralement ractionnaires), ni d'un progrs (bien que la mdecine, comme pratique et comme science, en ait plus d'un titre bnfici) ; il s'agit de la restructuration, dans un contexte historique prcis, du thme de la mdecine en libert : dans un domaine libr, la ncessit du vrai qui s'impose au regard va dfinir les structures institutionnelles et scientifiques qui lui sont propres. Ce n'est pas seulement par opportunisme politique, mais sans doute aussi |PAGE 69 par une obscure fidlit des cohrences qu'aucune sinuosit dans les vnements ne peut flchir, que le mme Fourcroy, en l'an II, s'levait centre tout projet de reconstituer les gothiques universits et les aristocratiques acadmies (1), et souhaitait en l'an III que la suppression provisoire des Facults en permt la rforme et l'amlioration (2) ; il ne fallait pas que l'empirisme meurtrier et l'ambitieuse ignorance tendent de toutes parts des piges la douleur crdule (3) : ce qui, jusqu'alors, avait fait dfaut, la pratique mme de l'art, l'observation au lit des malades devait devenir la part essentielle de la mdecine nouvelle. Thermidor et le Directoire ont pris la clinique comme thme majeur de la rorganisation institutionnelle de la mdecine: c'tait pour eux un moyen de mettre un terme la prilleuse exprience d'une libert totale, une manire cependant de lui donner un sens positif, une voie aussi pour restaurer, conformment au voeu de certains, quelques structures de l'Ancien Rgime. 1. Les mesures du 14 frimaire an III Fourcroy avait t charg de prsenter la Convention un rapport sur l'tablissement d'une Ecole de Sant Paris. Les justifications qu'il apporte sont dignes de remarque, d'autant plus qu'elles seront reprises peu de chose prs, dans les considrants du dcret effectivement vot bien qu'il s'carte plus d'une fois de la lettre et de l'esprit du projet. Il s'agit avant tout de crer, sur le modle de l'Ecole centrale des Travaux publics, une cole unique pour toute la France, o on formera les officiers de sant ncessaires aux hpitaux et surtout aux hpitaux militaires: 600 mdecins ne viennent-ils pas d'tre tus aux armes en moins de 18 mois? En dehors de cette raison d'urgence et de la ncessit de mettre un terme aux mfaits (1) FOURCROY, Rapport et projet de dcret sur l'enseignement libre des sciences et des arts (an II), p. 2. (2) FOURCROY, Rapport la Convention au nom des Comits de Salut public et d'Instruction publique (7 frimaire an III), p. 3. (3) Ibid., p. 3.
|PAGE 70 des charlatans, il faut lever un certain nombre d'objections capitales contre cette mesure qui peut restaurer les anciennes corporations et leurs privilges: la mdecine est une science pratique dont la vrit et les succs intressent la nation tout entire; en crant une cole, on ne favorise pas une poigne d'individus, on permet que, par des intermdiaires qualifis, le peuple puisse se ressentir des bienfaits de la vrit: C'est vivifier, dit le rapporteur non sans embarras de style et de pense, plusieurs canaux qui font circuler l'industrieuse activit des arts et des sciences dans toutes les ramifications du corps social (1). Or, ce qui garantit la mdecine ainsi entendue, d'tre un savoir utile tous les citoyens, c'est son rapport immdiat la nature: au lieu d'tre comme l'ancienne Facult, le lieu d'un savoir sotrique et livresque, la nouvelle cole sera le Temple de la nature ; on n'y apprendra point ce que croyaient savoir les matres d'autrefois, mais cette forme de vrit ouverte tous que manifeste l'exercice quotidien: la pratique, la manipulation seront jointes aux prceptes thoriques. Les lves seront exercs aux expriences chimiques, aux dissections anatomiques, aux oprations chirurgicales, aux appareils. Peu lire, beaucoup voir, et beaucoup faire, exercer la pratique elle-mme et ceci au lit des malades: voil qui apprendra, au lieu des vaines physiologies, le vritable art de gurir (2). La clinique devient donc un moment essentiel la cohrence scientifique, mais aussi l'utilit sociale et la puret politique de la nouvelle organisation mdicale. Elle en est la vrit dans la libert garantie. Fourcroy propose que sur trois hpitaux (Hospice de l'Humanit, celui de l'Unit, et l'Hpital de l'Ecole), l'enseignement clinique soit assur par des professeurs suffisamment rmunrs pour pouvoir s'y consacrer entirement (3). Le public sera largement admis la nouvelle cole de sant: on espre ainsi que tous ceux qui exercent sans formation suffisante viendront spontanment complter leur exprience. De toute faon, on choisira dans chaque district, des lves ayant une bonne conduite, des moeurs pures, l'amour de la Rpublique, et la haine des tyrans, une culture assez soigne et surtout la connaissance de quelques sciences qui servent de prliminaire l'art de gurir, et on les enverra l'Ecole centrale (1) Rapport de Fourcroy la Convention, au nom des Comits de Salut public et d'Instruction publique (7 frimaire an III), p. 6. (2) Ibid., p. 9. (3) Ibid., p. 10. |PAGE 71
de Mdecine pour qu'ils deviennent aprs trois ans officiers de sant (1). Pour la province, Fourcroy n'avait prvu que des coles spciales. Les dputs du Midi s'y opposent et exigent que Montpellier ait aussi son cole centrale. Enfin, Ehrman le demande pour Strasbourg, si bien que le dcret du 14 frimaire an III porte cration de trois coles de mdecine. Il tait prvu trois ans d'enseignement. A Paris, la classe des commenants tudie au premier semestre l'anatomie, la physiologie, la chimie mdicale, au second, la matire mdicale, la botanique, la physique : tout au cours de l'anne, les lves devront frquenter les hpitaux pour y prendre l'habitude de voir les malades, et la manire gnrale de les soigner (2). Dans la classe des commencs, on tudie d'abord l'anatomie, la physiologie, la chimie, la pharmacie, la mdecine opratoire, puis la matire mdicale, la pathologie interne et externe; au cours de cette seconde anne, les tudiants pourront, dans les hpitaux, tre employs au service des malades. Enfin, au cours de la dernire anne, on reprend les cours prcdents, et, profitant de l'exprience hospitalire dj acquise, on commence les cliniques proprement dites. Les lves sont rpartis dans trois hpitaux o ils resteront quatre mois puis changeront. La clinique comprend deux parts: Au lit de chaque malade, le professeur s'arrtera le temps ncessaire pour le bien interroger, pour l'examiner convenablement; il fera remarquer aux lves les signes diagnostiques et les symptmes importants de la maladie; puis, l'amphithtre, le professeur reprendra l'histoire gnrale des maladies observes dans les salles de l'hpital: il en indiquera les causes connues, probables et caches, il noncera le pronostic, et donnera les indications vitales, curatives ou palliatives (3). Ce qui caractrise cette rforme, c'est que la rquilibration de la mdecine autour de la clinique y est corrlative d'un enseignement thorique largi. Au moment o on dfinit une exprience pratique faite partir du malade lui-mme, on insiste sur la ncessit de lier le savoir particulier un systme gnral de connaissances. Les deux premiers principes par lesquels la nouvelle Ecole de Paris commente les dcrets du 14 frimaire posent qu'elle feraconnatre l'conomie animale depuis la structure (1) Ibid., pp. 12-13. (2) Plan gnral de l'enseignement dans l'Ecole de Sant de Paris (Paris, an III), p. 11. (3) Ibid., p. 39. |PAGE 72
lmentaire du corps inanim jusqu'aux phnomnes les plus composs de l'organisme et de la vie ; et elle s'efforcera de montrer dans quels rapports les corps vivants se trouvent avec tous ceux dont la nature est compose (1). D'un autre ct, cet largissement mettra la mdecine au contact de toute une srie de problmes et d'impratifs pratiques: mettant jour la solidarit de l'tre humain avec les conditions matrielles d'existence, elle montrera comment on peut conserver longtemps une existence autant exempte de maux qu'il est permis aux hommes de l'esprer; et elle manifestera le point de contact par o l'art de gurir rentre dans l'ordre civil (2). La mdecine clinique n'est donc pas une mdecine replie sur le degr premier de l'empirisme et cherchant rduire toutes ses connaissances, toute sa pdagogie, par un scepticisme mthodique, la seule constatation du visible. La mdecine, en ce premier temps, ne se dfinit pas comme clinique sans se dfinir aussitt comme savoir multiple de la nature et connaissance de l'homme en socit. 2. Rformes et discussions en l'an V et en l'an VI Les mesures prises le 14 frimaire taient loin de rsoudre tous les problmes poss. En ouvrant les Ecoles de Sant au public, on esprait y attirer les officiers de sant insuffisamment forms et faire disparatre par l'effet de la libre concurrence les empiriques et tant de mdecins improviss. Il n'en fut rien: le trop petit nombre d'coles, l'absence d'examens, sauf pour les lves boursiers, empchrent que se constitue un corps de mdecins qualifis: quatre reprises, le 13 messidor an IV, les 22 brumaire et 4 frimaire an V, le 24 nivse an VI, le Directoire fut oblig de rappeler aux Assembles les ravages dus au libre exercice de la mdecine, la mauvaise formation des praticiens, et l'absence d'une lgislation efficace. Il fallait donc la fois trouver un systme de contrle l'gard des mdecins installs depuis la Rvolution, et largir le recrutement, la rigueur et l'influence des Ecoles nouvelles. D'un autre ct, l'enseignement donn par les Ecoles elles-mmes prtait critique. Le programme, dans sa largeur extrme, tait prsomptueux, d'autant que les tudes ne duraient (1) Ibid., p. 1. (2) Ibid., p. 1-2. |PAGE 73 comme sous l'Ancien Rgime que trois ans: Pour trop exiger, on n'arrive rien (1). Entre les diffrents cours, il n'y avait gure d'unit: ainsi l'Ecole de Paris, on apprenait d'un ct une mdecine clinique des symptmes et des signes, tandis que Doublet, en pathologie interne, enseignait la mdecine des espces la plus
traditionnelle (les causes les plus gnrales, puis les phnomnes gnraux, la nature et le caractre de chaque classe de maladies et de ces principales divisions; il rptait le mme examen sur les genres et les espces) (2). Quant la clinique, elle n'avait pas sans doute la valeur formatrice qu'on attendait: trop d'tudiants, trop de malades aussi: On circule rapidement dans une salle, on dit deux mots l'issue d'une pareille course, on se retire ensuite avec prcipitation, et c'est l ce qu'on nomme l'enseignement de la clinique interne. Dans les grands hpitaux, on voit pour l'ordinaire beaucoup de malades, mais trs peu de maladies (3). Enfin, portant toutes ces dolances, s'en faisant les inlassables agents de diffusion, afin d'exiger avec plus de force la reconstitution d'une profession mdicale dfinie par les comptences et protge par les lois, les socits mdicales qui avaient disparu, avec l'Universit, en aot 1792, se sont reconstitues peu aprs la loi du 14 frimaire. C'est d'abord la Socit de Sant, fonde le 2 germinal an IV avec Desgenettes, Lafisse, Bertrand Pelletier et Leveill ; en son principe, elle veut seulement tre comme un organe libral et neutre d'information: communication rapide des observations et des expriences, savoir largi tous ceux qui s'occupent de l'art de gurir, bref, une sorte de grande clinique l'chelle de la nation, o il ne sera question que d'observer et de pratiquer: la mdecine, dit le premier prospectus de la socit, est fonde sur des prceptes auxquels l'exprience seule peut servir de base. Pour les recueillir, il faut le concours des observateurs. Aussi plusieurs branches de la mdecine languissaient-elles depuis la destruction des compagnies savantes. Mais elles vont crotre et refleurir de nouveau l'ombre d'un gouvernement constitu qui ne peut voir qu'avec satisfaction se former des socits libres d'observateurs-praticiens (4). C'est dans cet esprit que la socit, (1) BARAILLON, Rapport' au Conseil des Cinq-Cents (6 germinal an VI), p. 2. (2) Plan gnral de l'enseignement dans l'Ecole de Sant de Paris (an III), p. 31. (3) Opinion de J.-Fr. Baraillon, sance de l'Assemble des Cinq-Cents (17 germinal an VI), p. 4. (4) Prospectus accompagnant la premire livraison du Recueil priodique de la Socit de Sant de Paris. |PAGE 74 convaincue que l'isolement des personnes... est entirement prjudiciable aux intrts de l'humanit (1) publie un Recueil priodique, bientt doubl d'un autre consacr la littrature
mdicale trangre. Mais trs tt, ce souci d'information universelle manifesta ce qui tait sans doute sa proccupation vritable: regrouper ceux des mdecins dont la comptence avait t valide par des tudes ordinaires, et lutter pour qu'on dfinisse nouveau des limites au libre exercice de la mdecine: Que ne m'est-il permis de drober l'histoire le souvenir de ces moments dsastreux o une main impie et barbare a bris en France les autels consacrs au culte de la mdecine! Ils ont disparu, ces corps dont l'antique clbrit attestait les longs succs (2). Le mouvement, avec cette signification plus slective qu'informative, s'tend la province: des socits se fondent Lyon, Bruxelles, Nancy, Bordeaux, Grenoble. La mme anne, le 5 messidor, une autre socit tient sa sance inaugurale Paris avec Alibert, Bichat, Bretonneau, Cabanis, Desgenettes, Dupuytren, Fourcroy, Larrey et Pinel. Mieux que la Socit de Sant, elle reprsente les options de la nouvelle mdecine: il faut fermer les portes du temple ceux qui, sans le mriter, y sont entrs, profitant de ce qu'au premier signal de la Rvolution le sanctuaire de la mdecine comme le temple de Janus se voit ouvert deux battants et que la foule n'ait eu qu' s'y prcipiter (3) ; mais il faut galement rformer la mthode d'enseignement qu'on applique dans les coles de l'an III : formation htive et composite, qui ne met le mdecin en possession d'aucune mthode sre d'observation et de diagnostic; on veut donc substituer la marche philosophique et raisonne de la mthode la marche irrgulire et tourdie de l'irrflexion (4). Devant l'opinion publique, en dehors du Directoire et des Assembles, mais non sans leur assentiment au moins tacite, et avec l'appui constant des reprsentants de la bourgeoisie claire et des idologues proches du gouvernement (5), ces socits vont mener une incessante campagne. Et, dans ce mouvement, l'ide clinique va prendre une signification assez diffrente de celle qu'introduisent les lgislateurs de l'an III. (1) Recueil priodique, I, p. 3. (2) Recueil priodique, II, p. 234. (3) Mmoires de la Socit mdicale d'mulation, t. I (an V), p. II. (4) Ibid., p. IV. (5) A partir du mois de mars 1798, Cabanis sige l'Assemble des Cinq-Cents, au titre de l'Institut. |PAGE 75 L'article 356 de la Constitution du Directoire portail que la loi surveille les professions qui intressent la sant des citoyens ; c'est au nom de cet article qui semblait promettre contrle, limites et garanties, que toutes les polmiques vont tre menes. Il n'est pas
possible d'entrer dans leur dtail. Disons seulement que l'essentiel du dbat portait sur le point de savoir s'il fallait d'abord rorganiser l'enseignement, puis tablir les conditions d'exercice de la mdecine, ou au contraire purer en premier lieu le corps mdical, dfinir les normes de la pratique, puis fixer le cours des tudes indispensables. Entre les deux thses, le partage politique tait clair; les moins loigns de la tradition conventionnelle, comme Daunou, Prieur de la Cte-d'Or, voudraient rintgrer les officiers de sant et tous les francs-tireurs de la mdecine grce un enseignement largement ouvert; les autres, autour de Cabanis et de Pastoret, voudraient hter la reconstitution d'un corps mdical ferm. Au dbut du Directoire, ce sont les premiers qui ont le plus d'audience. Le premier plan de rforme avait t rdig par Daunou, un des auteurs de la Constitution de l'an III, et qui, la Convention, avait eu des sympathies girondines. Il ne veut pas modifier en leur substance les dcrets de Frimaire, mais il voudrait voir tablir en outre des cours complmentaires de mdecine dans vingt-trois hpitaux de province (1) : l les praticiens pourront perfectionner leurs connaissances, et il sera possible alors aux autorits locales d'exiger des preuves de comptence pour l'exercice de la mdecine: Vous ne rtablirez pas les jurandes, mais vous exigerez des preuves de capacit, on pourra devenir mdecin sans avoir frquent aucune cole, mais vous demanderez une caution solennelle des connaissances de tout candidat: et vous concilierez ainsi les droits de la libert personnelle avec ceux de la sret publique (2). L, plus clairement encore qu'auparavant, la clinique apparat comme la solution concrte au problme de la formation des mdecins et de la dfinition de la comptence mdicale. Le projet Daunou, dans sa timidit rformatrice, et dans sa fidlit aux principes de l'an III, fut unanimement critiqu: vritable organisation du meurtre, dit Baraillon (3). Quelques (1) P.-C.-F. DAUNOU, Rapport l'Assemble des Cinq-Cents sur l'organisation des coles spciales (25 floral an V), p. 26. (2) Ibid. (3) BARAILLON, Rapport au Conseil des Anciens (6 germinal an VI), p. 2. |PAGE 76 semaines plus tard, la Commission d'Instruction publique prsente un autre rapport, de Cals cette fois. Il est dj d'un esprit tout diffrent: pour faire accepter la reconstitution, implicite dans son projet, d'un corps professionnel de mdecins, il s'lve contre la distinction qui rserve les mdecins aux villes, les chirurgiens tant tout ce qu'il
faut pour la campagne, et les apothicaires se voyant confier les enfants (1). Il faut que, dans les 5 coles qui seront tablies Paris, Montpellier, Nancy, Bruxelles et Angers, les cours soient communs aux mdecins, aux chirurgiens et aux apothicaires. Les tudes seront sanctionnes par 6 examens, auxquels les lves se prsenteront quand bon leur semblera (il en suffira de trois pour tre chirurgien). Enfin, dans chaque dpartement, un jury de salubrit, nomm parmi les mdecins et les pharmaciens, sera consult sur tous les objets relatifs l'art de gurir et la salubrit publique (2). Sous prtexte d'un enseignement plus rationnel, donn par des Facults plus nombreuses et distribu de manire uniforme tous ceux qui s'occupent de la sant publique, le projet Cals a pour fin essentielle le rtablissement d'un corps de mdecins qualifis par un systme d'tudes et d'examens normaliss. A son tour, le projet Cals, soutenu par des mdecins comme Baraillon et Vite t, est violemment attaqu, de l'extrieur par l'Ecole de Montpellier qui se dclare satisfaite des mesures prises par la Convention, l'Assemble elle-mme par tous ceux qui restent fidles l'esprit de l'an III. Les choses tranent en longueur. Profitant du coup d'arrt donn la contre-rvolution par le 18 fructidor, Prieur de la Cte-d'Or, ancien membre du Comit de Salut public, obtient le renvoi du projet Cals devant la Commission d'Instruction publique. Il lui reproche la place insignifiante qu 'y reoit la clinique, et le retour la pdagogie des anciennes Facults: or, il ne suffit pas que l'lve coute et lise, il faut encore qu'il voie, qu'il touche, et surtout qu'il s'exerce faire et en acquire l'habitude (3). Par cette argumentation, Prieur prenait un double avantage tactique: il validait ainsi, au niveau scientifique, l'exprience acquise par ceux qui s'taient plus ou moins improviss mdecins depuis 1792; d'autre part, en soulignant lui-mme combien cet enseignement (1) Rapport de J.-M. Cals sur les Ecoles spciales de Sant (12 prairial an V), p. 11. (2) Ibid., articles 43-46. (3) Motion d'ordre de C. A. Prieur relative au projet sur les Ecoles de Sant (sance des Cinq-Cents du 12 brumaire an V), p. 4. |PAGE 77 clinique est coteux, il suggre de ne maintenir d'Ecole qu' Paris, au lieu d'en multiplier le nombre et d'en sacrifier la qualit. C'est revenir tout simplement ce qu'tait le projet de Fourcroy dans sa formulation premire. Mais entre-temps, et la veille mme du coup de force qui allait, en dnonant en lui un des chefs du complot royaliste, le contraindre
l'exil, Pastoret avait fait admettre, par les Cinq-Cents, un dcret concernant l'exercice de la mdecine. Auprs des trois Ecoles de Sant, un jury compos de deux mdecins, de deux chirurgiens et d'un pharmacien est charg de contrler tous ceux qui voudraient exercer dans leur ressort; de plus tous ceux qui exercent actuellement l'art de gurir sans avoir t lgalement reus dans les formes prescrites par les lois anciennes seront tenues de se prsenter dans les trois mois (1). Toute l'implantation mdicale depuis les cinq dernires annes est donc soumise rvision, et ceci par des jurys forms l'ancienne cole; les mdecins vont pouvoir nouveau contrler leur propre recrutement; ils se reconstituent comme corps capable de dfinir les critres de sa comptence. Le principe est acquis, mais le petit nombre des Ecoles de Sant en rend l'application difficile; en demandant qu'on les rduise encore, Prieur pense qu'il rendrait impossible l'application du dcret Pastoret. De toute faon, celui-ci resta lettre morte, et quatre mois peine s'taient couls depuis qu'il avait t vot, quand le Directoire fut nouveau oblig d'attirer l'attention des lgislateurs sur les dangers que faisait courir aux citoyens une mdecine incontrle: Qu'une loi positive astreigne de longues tudes, l'examen d'un jury svre celui qui prtend l'une des professions de l'art de gurir; que la science et l'habitude soient honores, mais que l'impritie et l'imprudence soient contenues; que des peines publiques effraient la cupidit et rpriment des crimes qui ont quelque ressemblance avec l'assassinat (2). Le 17 ventse an VI, Vitet reprend devant les CinqCents les grandes lignes du projet Cals : 5 coles de mdecine; dans chaque dpartement un conseil de sant qui s'occupe des pidmies et des moyens de conserver la sant des habitants, et qui participe l'lection des professeurs; une srie de 4 examens, qui ont lieu date fixe. La seule innovation relle c'est la cration d'une preuve (1) Rapport fait par Pastoret sur un mode provisoire d'examen pour les officiers de Sant (16 thermidor an V), p. 5. (2) Message du Directoire l'Assemble des Cinq-Cents (24 nivse an VI). |PAGE 78 de clinique: Le candidat mdecin exposera au pied du lit du malade le caractre de l'espce de maladie et son traitement. Ainsi se trouvent runis, pour la premire fois, dans un cadre institutionnel unique les critres du savoir thorique et ceux d'une pratique qui ne peut tre lie qu' l'exprience et l'habitude. Le projet de Vitet ne permet pas l'intgration ou l'assimilation progressive dans la mdecine officielle de cet exercice de francs-tireurs pratiqu depuis
1792 ; mais il reconnat thoriquement, et dans le cycle des tudes normales, la valeur d'une pratique acquise dans les hpitaux. Ce n'est pas la mdecine empirique qui est reconnue, mais la valeur de l'exprience comme telle dans la mdecine. Le plan Cals avait paru trop rigoureux en l'an V; celui de Vitet, soutenu son tour par Cals et Baraillon, suscite autant d'opposition. Il apparat, avec clart, qu'aucune rforme de l'enseignement ne sera possible tant que n'aura pas t rsolu le problme auquel elle sert d'cran: celui de l'exercice de la mdecine. Le projet de Cals ayant t renvoy, Baraillon propose aux Cinq-Cents une rsolution qui traduit en clair ce qui en tait le sens implicite: nul ne pourra exercer l'art de gurir s'il n'a un titre soit des nouvelles Ecoles, soit des anciennes Facults (1). Porcher, au Conseil des Anciens, soutient la mme thse (2). Telle est l'impasse politique et conceptuelle dans laquelle se trouve plac le problme; du moins toutes ces discussions ont-elles permis de mettre au jour ce qui tait rellement en question: non pas le nombre ou le programme des Ecoles de Sant, mais le sens mme de la profession mdicale et le caractre privilgi de l'exprience qui la dfinit. 3. L'intervention de Cabanis et la rorganisation de l'an XI Dans l'ordre chronologique, Cabanis dpose son rapport sur la police mdicale entre le projet de Baraillon et la discussion de Vendmiaire aux Anciens, le 4 messidor an VI. En fait, ce texte est dj d'un autre ge; il marque le moment o l'Idologie va prendre une part active et souvent dterminante dans la restructuration politique et sociale. Dans cette mesure, le texte de Cabanis sur la police mdicale est plus proche, par son esprit, (1) BARAILLON, Rapport l'Assemble des Cinq-Cents sur la partie de la police qui tient la mdecine (6 germinal an VI). (2) PORCHER, Opinion sur le mode provisoire d'examen pour les officier de Sant (Assemble des Anciens) (16 vendmiaire an VI). |PAGE 79 des rformes du Consulat que des polmiques qui lui sont contemporaines. S'il essaie de dfinir les conditions d'une solution pratique, il cherche surtout donner, dans ses lignes gnrales, une thorie de la profession mdicale. Dans l'immdiat et au niveau de la pratique, Cabanis fait un sort deux problmes: celui des officiers de sant, celui des examens. Pour les officiers en chef, on peut les admettre exercer sans nouvelle formalit, les autres, en revanche, devront passer un examen qui leur sera spcialement destin; il se limitera aux connaissances fondamentales de l'art, et particulirement ce qui
concerne sa pratique. Quant aux tudes mdicales ordinaires, elles devront tre sanctionnes par un examen comportant une preuve crite, une autre orale, et des exercices d'anatomie, de mdecine opratoire et de mdecine clinique tant interne qu'externe. Les critres de comptence une fois poss, on pourra faire le tri de ceux qui on confiera sans danger la vie des citoyens; la mdecine, alors, deviendra une profession ferme: Toute personne qui exercera la mdecine sans avoir les examens des coles ou sans tre passe devant les jurys spciaux sera condamne une amende et la prison en cas de rcidive (1). L'essentiel du texte concerne ce qu'est, en sa nature, la profession mdicale. Le problme tait de lui assigner un domaine clos et elle rserv, sans retrouver les structures corporatives de l'Ancien Rgime, ni retomber dans les formes de contrle tatique qui pouvaient rappeler la priode conventionnelle. Cabanis distingue dans l'industrie, prise au sens large du terme, deux catgories d'objets. Certains sont d'une nature telle que les consommateurs eux-mmes sont juges de leur utilit: c'est--dire que la conscience publique suffit en dterminer la valeur; celle-ci, fixe par l'opinion, est extrieure l'objet: elle est sans secret, sans erreur ni mystification possibles puisqu'elle rside en un consensus. L'ide de fixer une valeur par dcret n'a pas plus de sens que de vouloir lui imposer une vrit de l'extrieur; la vraie valeur ne peut tre que la valeur libre: Dans un tat social bien rgl, la libert d'industrie ne doit rencontrer aucun obstacle; elle doit tre entire, illimite; et comme le dveloppement d'une industrie ne peut devenir utile celui qui la cultive qu'autant qu'elle l'est elle-mme au (1) CABANIS, Rapport du Conseil des Cinq-Cents sur un mode provisoire de police mdicale (4 messidor an VI), pp. 12-18. |PAGE 80 public, il s'ensuit que l'intrt gnral est ici vritablement confondu avec l'intrt particulier. Mais il y a des industries qui sont telles que leur objet et sa valeur ne dpendent pas d'une estimation collective: soit que ces objets sont parmi ceux qui servent fixer la valeur marchande des autres (ainsi les mtaux prcieux), soit qu'il s'agisse de l'individu humain propos duquel toute erreur devient funeste. Ainsi, la valeur d'un objet d'industrie ne peut pas tre fixe par le consensus lorsqu'il est un critre marchand ou lorsqu'il concerne, dans son existence, un membre du consensus. Dans ces deux cas, l'objet de l'industrie a une valeur intrinsque qui n'est pas immdiatement visible: elle est donc sujette erreur et fraude; il faut par consquent la jauger. Mais
comment donner au public comptent un instrument de mesure qui impliquerait, prcisment, la comptence? Il faut qu'il dlgue l'Etat un contrle non sur chacun des objets produits (ce qui serait contraire aux principes de la libert conomique), mais sur le producteur luimme: il faut vrifier sa capacit, sa valeur morale, et de temps autre la valeur relle et la bont des objets qu'il dbite. Il faut donc surveiller les mdecins comme les orfvres, c'est--dire ces hommes d'industrie seconde qui ne produisent pas de richesse, mais qui traitent ce qui mesure ou produit la richesse: Voil pourquoi surtout les mdecins, les chirurgiens, les pharmaciens doivent tre trs examins tout galement sur leur savoir, sur leurs capacits, sur les habitudes morales... Ce n'est pas l gner l'industrie, ce n'est point attenter la libert de l'individu (1). La proposition de Cabanis ne fut pas accepte; elle indiquait pourtant dans ses lignes fondamentales, la solution qui allait tre adopte, dictant la mdecine ce statut de profession librale et protge qu'elle a conserv jusqu'au XXe sicle. La loi du 19 ventse an XI sur l'exercice de la mdecine est conforme aux thmes de Cabanis et, d'une faon plus gnrale, il ceux des Idologues. Elle prvoit une hirarchie deux niveaux dans le corps mdical: les docteurs en mdecine et en chirurgie reus dans l'une des 6 coles; et les officiers de sant, qui institutionnalisent titre dfinitif ceux que Cabanis voulait rintgrer titre provisoire. Les docteurs passeront, aprs quatre examens (anatomie et physiologie; pathologie et nosographie; matire mdicale; hygine et mdecine lgale), une preuve (1) Ibid., pp. 6-7. |PAGE 81 de clinique interne ou externe selon qu'ils veulent tre mdecins ou chirurgiens. Pour les officiers de sant, qui donneront les soins les plus ordinaires, ils n'tudieront que pendant 3 ans dans des Ecoles; encore n'est-ce pas indispensable; il leur suffira d'attester cinq ans de pratique dans les hpitaux civils et militaires, ou six ans comme lve et aide priv d'un docteur. Ils seront examins par un jury de dpartement. Toute personne, en dehors de ces deux catgories, qui se mlera d'exercer la mdecine encourra des peines allant de l'amende la prison. Tout ce mouvement d'ides, de projets et de mesures allant de l'an VI l'an XI, porte des significations dcisives. 1. Pour dfinir le caractre clos de la profession mdicale, on parvient ne pas emprunter le vieux modle corporatif, et viter d'autre part ce contrle sur les actes mdicaux eux-mmes qui rpugne au
libralisme conomique. Le principe du choix et son contrle sont tablis sur la notion de comptence c'est--dire sur un ensemble de virtualits qui caractrisent la personne mme du mdecin: savoir, exprience et aussi cette probit reconnue dont parle Cabanis (1). L 'acte mdical vaudra ce que vaut celui qui l'a accompli ; sa valeur intrinsque est fonction de la qualit, socialement reconnue, du producteur. Ainsi, l'intrieur d'un libralisme conomique manifestement inspir d'Adam Smith, se dfinit une profession la fois librale et ferme. 2. Dans ce monde des aptitudes, on a introduit cependant une diffrence de niveaux: d'un ct les docteurs, de l'autre les officiers de sant. La vieille diffrence entre mdecins et chirurgiens, entre l'interne et l'externe, ce qu'on sait et ce qu'on voit, se trouve coiffe et rendue secondaire par cette distinction nouvelle. Il ne s'agit plus d'une diffrence dans l'objet, ou la manire dont il se manifeste, mais d'une distinction de niveaux dans l'exprience du sujet qui connat. Sans doute, entre mdecins et chirurgiens, y avait-il dj une hirarchie qui tait marque dans les institutions: mais elle drivait d'une diffrence premire dans le domaine objectif de leur activit; elle est dcale maintenant vers l'indice qualitatif de cette activit. 3. Cette distinction a un corrlat objectif: les officiers de sant auront soigner le peuple industrieux et actif (2). (1) CABANIS, ibid. (2) Cit sous rfrence par J.-C.-F. CARON, Rflexions sur lexercice de la mdecine (Paris, an XII). |PAGE 82 On admettait, au XVIIIe sicle, que les gens du peuple et surtout de la campagne menant une vie plus simple, plus morale et plus saine taient affects surtout de maladies externes qui rclamaient le chirurgien. A partir de l'an XI, la distinction devient surtout sociale: pour soigner le peuple, souvent atteint d'accidents primitifs, et de simples indispositions, il n'est pas besoin d'tre savant et profond dans la thorie ; l'officier de sant avec son exprience y suffira. L'histoire de l'art comme celle des hommes prouve que la nature des choses comme l'ordre des socits civilises exige imprieusement cette distinction (1). Conformment l'ordre idal du libralisme conomique, la pyramide des qualits correspond la superposition des couches sociales. 4. Parmi ceux qui pratiquent l'art de gurir sur quoi se fonde la distinction? L'essentiel de la formation d'un officier de sant, ce sont ses annes de pratique, dont le nombre peut s'lever jusqu' 6 ; le
mdecin, lui, complte l'enseignement thorique qu'il a reu par une exprience clinique. C'est cette diffrence entre pratique et clinique qui constitue sans doute la part la plus nouvelle de la lgislation de l'an XI. La pratique exige de l'officier de sant est un empirisme contrl: savoir faire aprs avoir vu ; l'exprience est intgre au niveau de la perception, de la mmoire et de la rptition, c'est--dire au niveau de l'exemple. Dans la clinique, il s'agit d'une structure beaucoup plus fine et complexe o l'intgration de l'exprience se fait dans un regard qui est en mme temps savoir; c'est tout un nouveau codage du champ d'objets qui entre en jeu. On ouvrira la pratique aux officiers de sant, mais on rservera aux mdecins l'initiation la clinique. Cette nouvelle dfinition de la clinique tait lie une rorganisation du domaine hospitalier. Thermidor et le Directoire, son dbut, reviennent aux principes libraux de la Lgislative; Delecloy, le 11 thermidor an III, s'en prend au dcret de nationalisation des biens hospitaliers qui laisse les secours la seule charge de l'Etat, alors qu'il faudrait les mettre sous la sauvegarde de la commisration gnrale et (1) FOURCROY, Discours prononc au corps lgislatif le 19 ventse an XI, p. 3. |PAGE 83 sous la tutelle des gens aiss (1). De pluvise germinal an IV, le gouvernement envoie aux administrations locales une srie de circulaires qui reprennent, pour l'essentiel, les critiques morales et conomiques dresses, aussitt avant la Rvolution ou son dbut, contre le principe de l'hospitalisation (cot major d'une maladie traite l'hpital, habitude de paresse qu'on y prend, dtresse financire et misre morale d'une famille prive du pre ou de la mre) ; on souhaite que se multiplient les secours domicile (2). Cependant, le temps n'est plus o lon les croyait universellement valables et o on rvait d'une socit sans hospices ni hpitaux: la misre est trop gnrale -il y avait plus de 60000 indigents Paris en l'an II (3) et leur nombre ne fait qu'augmenter; on craint trop les mouvements populaires, on se mfie trop de l'usage politique qui pourrait tre fait des secours distribus, pour laisser reposer sur eux tout le systme de l'assistance. Il faut trouver, pour le maintien des hpitaux comme pour les privilges de la mdecine, une structure compatible avec les principes du libralisme et la ncessit de la protection sociale, entendue d'une faon ambigu comme la protection de la pauvret par la richesse, et la protection des riches contre les pauvres.
Une des dernires mesures de la Convention thermidorienne avait t de suspendre, le 2 brumaire an IV, l'excution de la loi de nationalisation des biens hospitaliers. Sur un nouveau rapport de Delecloy, le 12 vendmiaire an IV, la loi du 23 messidor an II est dfinitivement rapporte: les biens vendus devront tre remplacs par des biens nationaux, et par l le gouvernement se trouve dcharg de toute obligation: les hpitaux retrouvent la personnalit civile; leur organisation et leur gestion sont confies aux administrations municipales qui auront dsigner une commission excutive de 5 membres. Cette communalisation des hpitaux librait l'Etat du devoir d'assistance, et laissait aux collectivits restreintes la charge de se sentir solidaires des pauvres: chaque commune devenait responsable de sa misre et de la manire dont elle s'en protgeait. Entre les pauvres et les riches, le systme d'obligation et de compensation ne passait plus par la loi de l'Etat, mais par une sorte de contrat variable dans l'espace, rvocable dans le temps qui, situ au niveau des municipalits, tait plutt de l'ordre du libre consentement. Un contrat du mme genre, plus cach et plus trange, se noue (1) Cit par IMBERT, Le droit hospitalier sous la Rvolution et l'Empire, p. 93, n. 94. (2) Ibid., p. 104, n. 3. (3) Cf. SOBOUL, Les Sans-Culottes parisiens en l'an II (Paris, 1958). |PAGE 84 silencieusement vers la mme poque entre l'hpital o on soigne les pauvres et la clinique o se forment les mdecins. L encore dans ces dernires annes de Rvolution, on reprend, parfois mot pour mot, ce qui avait t formul dans la priode qui la prcdait immdiatement. Le problme moral le plus important que l'ide clinique avait suscit tait celui-ci: de quel droit pouvait-on transformer en objet d'observation clinique un malade que la pauvret avait contraint de venir demander assistance l'hpital? Il avait requis une aide dont il tait le sujet absolu dans la mesure o elle avait t conue pour lui; et on le requiert maintenant pour un regard, dont il est l'objet et l'objet relatif puisque ce qu'on dchiffre en lui est destin mieux connatre les autres. Il y a plus: la clinique, en observant, recherche; et cette part qu'elle fait la nouveaut, l'ouvre sur le risque: un mdecin dans le priv, remarque Aikin (1), doit mnager sa rputation; son chemin sera toujours celui, sinon de la certitude, de la scurit; l'hpital il est l'abri d'une pareille entrave et son gnie peut s'exercer d'une manire nouvelle. N'est-ce pas altrer jusque dans son essence le secours hospitalier que de poser ce principe:Les
malades d'hpital sont, sous plusieurs rapports, les sujets les plus propres pour un cours exprimental (2) ? Il n'y a l, bien entendre l'quilibre des choses, aucune injure aux droits naturels de la souffrance ni ceux que la socit doit la misre. Le domaine hospitalier est ambigu: thoriquement libre, et ouvert l'indiffrence de l'exprimentation par le caractre non contractuel du lien qui unit le mdecin son malade, il est hriss d'obligations et de limites morales en vertu du contrat sourd -mais pressant -qui lie l'homme en gnral la misre dans sa forme universelle. Si, l'hpital, le mdecin ne fait pas, en franchise de tout respect, des expriences thoriques, c'est qu'il fait, ds qu'il y entre, une exprience morale dcisive qui circonscrit sa pratique illimite par un systme clos du devoir. C'est en pntrant dans les asiles o languissent la misre et la maladie runies qu'il sentira ces motions douloureuses, cette commisration active, ce dsir ardent de porter le soulagement et la consolation, ce plaisir intime qui nat du succs et que le spectacle du bonheur rpandu augmente. C'est l qu'il apprendra tre religieux, humain, compatissant (3). Mais regarder pour savoir, montrer pour enseigner, n'est-ce (1) J. AIKIN, Observations sur les hpitaux (trad. fr., Paris, 1777), p. 104. (2) Ibid., p. 103. (3) MENURET, Essai sur les moyens de former de bons mdecins (Paris, 1791), pp. 56-57. |PAGE 85 pas violence muette, d'autant plus abusive qu'elle se tait, sur un corps de souffrance qui demande tre apais, non manifest? La douleur peut-elle tre spectacle? Elle peut l'tre, et mme elle le doit par la force d'un droit subtil, et qui rside en ceci que nul n'est seul et le pauvre moins que les autres, qui ne peut recevoir assistance que par la mdiation du riche. Puisque la maladie n'a de chance de trouver gurison que si les autres interviennent avec leur savoir, avec leurs ressources, avec leur piti, puisqu'il n'y a de malade guri qu'en socit, il est juste que le mal des uns soit transform pour les autres en exprience; et que la douleur reoive ainsi le pouvoir de manifester: L'homme souffrant ne cesse pas d'tre citoyen... L'histoire des souffrances auxquelles il est rduit est ncessaire ses semblables parce qu'elle leur apprend quels sont les maux dont ils sont menacs. En refusant de s'offrir comme objet d'instruction, le malade deviendrait ingrat, parce qu'il aurait joui des avantages qui rsultent de la sociabilit sans payer le tribut de la reconnaissance (1). Et par structure de rciprocit, se dessine pour le riche l'utilit de
venir en aide aux pauvres hospitaliss: en payant pour qu'on les soigne, il paiera du fait mme pour qu'on connaisse mieux les maladies dont lui-mme peut tre atteint; ce qui est bienveillance l'gard du pauvre se transforme en connaissance applicable au riche : Les dons bienfaisants vont adoucir les maux du pauvre d'o rsultent des lumires pour la conservation du riche. Oui, riches bienfaisants, hommes gnreux, ce malade que l'on couche dans le lit que vous lui avez fond prouve prsent la maladie dont vous ne tarderez pas tre attaqus vous-mmes; il gurira ou prira; mais dans l'un ou l'autre vnement, son sort peut clairer votre mdecin et vous sauver la vie (2). Voil donc les termes du contrat que passent richesse et pauvret dans l'organisation de l'exprience clinique. L'hpital y trouve, dans un rgime de libert conomique, la possibilit d'intresser le riche; la clinique constitue le reversement progressif de l'autre partie contractante; elle est, de la part du pauvre, l'intrt pay pour la capitalisation hospitalire consentie par le riche; intrt qu'il faut comprendre dans son paisse surcharge, puisqu'il s'agit d'un ddommagement qui est de l'ordre de l'intrt objectif pour la science et de l'intrt vital (1) CHAMBON DE MONTAUX, Moyen de rendre les hpitaux plus utiles la nation (Paris, ]787), pp. 171-172. (2) Du LAURENS, Moyens de rendre les hpitaux utiles et de perfectionner la mdecine (Paris, 1787), p. 12. |PAGE 86 pour le riche. L'hpital devient rentable pour l'initiative prive partir du moment o la souffrance qui vient y chercher apaisement est retourne en spectacle. Aider finit par payer, grce aux vertus du regard clinique. Ces thmes, si caractristiques de la pense pr-rvolutionnaire et plusieurs fois formuls alors, retrouvent leur sens dans le libralisme du Directoire, et reoivent ce moment une immdiate application. Expliquant en l'an VII comment fonctionne la clinique d'accouchement de Copenhague, Demangeon fait valoir, contre toutes les objections de pudeur ou de discrtion, qu'on n'y reoit queles femmes non maries, ou qui s'annoncent comme telles. Il semble que rien ne puisse tre mieux imagin, car c'est la classe des femmes dont les sentiments de pudeur sont censs tre les moins dlicats (1). Ainsi, cette classe moralement dsarme, et socialement si dangereuse, pourra servir la plus grande utilit des familles honorables; la morale trouvera sa rcompense dans ce qui la bafoue, car les femmes n'tant pas en tat d'exercer la bienfaisance... contribuent
au moins former de bons mdecins et rciproquent leurs bienfaiteurs avec usure (2). Le regard du mdecin est d'une pargne bien serre dans les changes comptables d'un monde libral... (1) J.-B. DEMANGEON, Tableau historique d'un triple tablissement runi en un seul hospice Copenhague (Paris, an VII), pp. 34-35. (2) Ibid., pp. 35-36. |PAGE 87 CHAPITRE VI Des Signes et des Cas Et voici, hors de toute mesure, l'tendue du domaine clinique. Dmler le principe et la cause d'une maladie travers la confusion et l'obscurit des symptmes; connatre sa nature, ses formes, ses complications; distinguer au premier coup d'oeil tous ses caractres et toutes ces diffrences; sparer d'elle au moyen d'une analyse prompte et dlicate tout ce qui lui est tranger; prvoir les vnements avantageux et nuisibles qui doivent survenir pendant le cours de sa dure; gouverner les moments favorables que la nature suscite pour en oprer la solution; estimer les forces de la vie et l'activit des organes; augmenter ou diminuer au besoin leur nergie; dterminer avec prcision quand il faut agir et quand il convient d'attendre; se dcider avec assurance entre plusieurs mthodes de traitement qui offrent toutes des avantages et des inconvnients; choisir celle dont l'application semble permettre plus de clrit, plus d'agrment, plus de certitude dans le succs; profiter de l'exprience ; saisir les occasions; combiner toutes les chances, calculer tous les hasards; se rendre matre des malades et de leurs affections ; soulager leurs peines; calmer leurs inquitudes; deviner leurs besoins; supporter leurs caprices; mnager leur caractre et commander leur volont, non comme un tyran cruel qui rgne sur des esclaves, mais comme un pre tendre qui veille sur la destine de ses enfants (1). Ce texte solennel et bavard livre son sens si on le confronte cet autre dont le laconisme lui est paradoxalement superposable: (1) C.-L. DUMAS, Eloge de Henri Fouquet (Montpellier, 1807), cit par A. GIRBAL, Essai sur l'esprit de la clinique mdicale de Montpellier (Montpellier, 1858), p. 18. |PAGE 88
Il faut, autant qu'il est en soi, rendre la science oculaire (1). Tant de pouvoirs, depuis le lent claircissement des obscurits, la lecture toujours prudente de l'essentiel, le calcul du temps et des chances, jusqu' la matrise du coeur et la confiscation des prestiges paternels, sont autant de formes travers lesquelles s'instaure la souverainet du regard. mil qui sait et qui dcide, oeil qui rgit. La clinique n'est sans doute pas la premire tentative pour ordonner une science l'exercice et aux dcisions du regard. L'histoire naturelle s'tait propos, depuis la seconde moiti du XVIIe sicle, l'analyse et la classification des tres naturels selon leurs caractres visibles. Tout ce trsor de savoir que l'Antiquit et le Moyen Age avaient accumul -et o il tait question des vertus des plantes, des pouvoirs des animaux, des correspondances et des sympathies secrtes -tout cela tait tomb depuis Ray dans les marges du savoir des naturalistes. Restaient connatre en revanche les structures, c'est--dire les formes, les dispositions spatiales, le nombre et la taille des lments : l'histoire naturelle se donnait pour tche de les reprer, de les transcrire dans le discours, de les conserver, confronter et combiner, pour permettre d'une part de dterminer les voisinages, les parents des tres vivants (donc l'unit de la cration) et d'autre part de reconnatre rapidement n'importe quel individu (donc sa place singulire dans la cration). La clinique demande autant au regard que l'histoire naturelle. Autant et jusqu' un certain point la mme chose: voir, isoler des traits, reconnatre ceux qui sont identiques et ceux qui sont diffrents, les regrouper, les classer par espces ou familles. Le modle naturaliste auquel la mdecine s'est pour une part soumise au XVIIIe sicle reste actif. Le vieux rve de Boissier de Sauvages, tre le Linn des maladies, n'est pas encore tout fait oubli au XIXe sicle: les mdecins continueront herboriser longtemps dans le champ du pathologique. Mais le regard mdical s'organise, en outre, sur un mode nouveau. D'abord, il n'est plus simplement le regard de n'importe quel observateur, mais celui d'un mdecin support et justifi par une institution, celui d'un mdecin qui a pouvoir de dcision et d'intervention. Ensuite, c'est un regard qui n'est pas li par la grille troite de la structure (forme, disposition, nombre, grandeur) mais qui peut et doit saisir les couleurs, les variations, les infimes anomalies, se tenant (1) M.-A. PETIT, Discours Sur la manire d'exercer la bienfaisance dans les hpitaux (3 nov. 1797), Essai sur la mdecine du coeur, p. 103. |PAGE 89 toujours aux aguets du dviant. Enfin, c'est un regard qui ne se
contente pas de constater ce qui videmment se donne voir; il doit permettre de dessiner les chances et les risques; il est calculateur. Il serait inexact sans doute de voir dans la mdecine clinique de la fin du XVIIIe sicle un simple retour la puret d'un regard longtemps alourdi de fausses connaissances. Il ne s'agit mme pas simplement d'un dplacement de ce regard, ou d'une plus fine application de ses capacits. De nouveaux objets vont se donner au savoir mdical dans la mesure o et en mme temps que le sujet connaissant se rorganise, se modifie et se met fonctionner sur un mode nouveau. Ce n'est donc pas la conception de la maladie qui a d'abord chang, puis la manire de la reconnatre' ce n'est pas non plus le systme signaltique qui a t modifi puis la thorie; mais tout ensemble et plus profondment le rapport de la maladie ce regard auquel elle s'offre et qu'en mme temps elle constitue. A ce niveau, pas de partage faire entre thorie et exprience, ou mthodes et rsultats; il faut lire les structures profondes de la visibilit o le champ et le regard sont lis l'un l'autre par des codes de savoir; nous les tudierons dans ce chapitre sous leurs deux formes majeures' la structure linguistique du signe, et celle, alatoire, du cas. Dans la tradition mdicale du XVIIIe sicle, la maladie se prsente l'observateur selon des symptmes et des signes. Les uns et les autres se distinguent par leur valeur smantique autant que par leur morphologie. Le symptme -de l sa place royale est la forme sous laquelle se prsente la maladie: de tout ce qui est visible, il est le plus proche de l'essentiel; et de l'inaccessible nature de la maladie, il est la transcription premire. Toux, fivre, douleur de ct et difficult de respirer ne sont pas la pleursie elle-mme -celle-ci n'est jamais offerte aux sens, ne se dvoilant que sous le raisonnement -mais elles en forment le symptme essentiel puisqu'elles permettent de dsigner un tat pathologique (par opposition la sant), une essence morbide (diffrente, par exemple, de la pneumonie), et une cause prochaine (un panchement de srosit) (1). Les symptmes (1) Cf. ZIMMERMANN, Trait de l'exprience (trad. fr., Paris, 1774), t. I, pp. 197-198. |PAGE 90 laissent transparatre la figure invariable, un peu en retrait, visible et invisible, de la maladie. Le signe annonce: pronostique, ce qui va se passer ; anamnestique, ce qui est pass; diagnostique, ce qui se droule actuellement. De lui la maladie rgne toute une distance qu'il ne franchit pas sans la souligner, car il s'offre de biais et par surprise souvent. Il ne donne pas connatre; tout au plus partir de lui peut-on esquisser une
reconnaissance. Une reconnaissance qui, ttons, s'avance dans les dimensions du cach: le pouls trahit la force invisible et le rythme de la circulation ; ou encore le signe dvoile le temps, comme le bleuissement des ongles qui annonce sans faute la mort, ou les crises du quatrime jour qui, dans les fivres intestinales, promettent la gurison. A travers l'invisible, le signe indique le plus loin, l'endessous, le plus tard. En lui, il est question de l'issue, de la vie et de la mort, du temps et non de cette vrit immobile, de cette vrit donne et cache, que les symptmes restituent en leur transparence de phnomnes. Ainsi, le XVIIIe sicle transcrivait-il la double ralit, naturelle et dramatique, de la maladie; ainsi fondait-il la vrit d'une connaissance et la possibilit d'une pratique. Structure heureuse et calme, o s'quilibrent le systme Nature-Maladie, avec des formes visibles s'enracinant dans l'invisible, et le systme Temps-Issue, qui anticipe sur l'invisible grce un reprage visible. Ces deux systmes existent pour eux-mmes; leur diffrence est un fait de nature auquel la perception mdicale s'ordonne mais qu'elle ne constitue pas. La formation de la mthode clinique est lie l'mergence du regard du mdecin dans le champ des signes et des symptmes. La reconnaissance de ses droits constituants entrane l'effacement de leur distinction absolue et le postulat que dsormais le signifiant (signe et symptme) sera entirement transparent pour le signifi qui apparat, sans occultation ni rsidu, en sa ralit mme, et que l'tre du signifi -le coeur de la maladie s'puisera tout entier dans la syntaxe intelligible du signifiant. 1. Les symptmes constituent une couche primaire indissociablement signifiante et signifie Par-del les symptmes, il n'y a plus d'essence pathologique: tout dans la maladie est phnomne d'elle-mme; dans cette mesure, les symptmes jouent le rle naf, premier de nature: |PAGE 91 Leur collection forme ce qu'on appelle la maladie (1). Ils ne sont rien d'autre qu'une vrit toute donne au regard; leur lien et leur statut ne renvoient pas une essence, mais indiquent une totalit naturelle qui a seulement ses principes de composition et ses formes plus ou moins rgulires de dure: Une maladie est un tout puisqu'on peut en assigner les lments; elle a un but puisqu'on peut en calculer les rsultats; elle est donc un tout plac dans les limites de l'invasion et de la terminaison (2). Le symptme est ainsi dchu de son rle d'indicateur souverain, n'tant que phnomne d'une loi
d'apparition ; il est au ras de la nature. Pas entirement toutefois: quelque chose, dans l'immdiat du symptme, signifie le pathologique, par quoi il s'oppose un phnomne relevant purement et simplement de la vie organique: Nous entendons par phnomne tout changement notable du corps sain ou malade; de l la division en ceux qui appartiennent la sant et ceux qui dsignent la maladie: ces derniers se confondent aisment avec les symptmes ou apparences sensibles de la maladie (3). Par cette simple opposition aux formes de la sant, le symptme quitte sa passivit de phnomne naturel et devient signifiant de la maladie, 'c'est--dire de lui-mme pris en sa totalit, puisque la maladie n'est que la collection des symptmes. Singulire ambigut puisque dans sa fonction signifiante, le symptme renvoie la fois au lien des phnomnes entre eux, ce qui constitue leur totalit et la forme de leur coexistence, et la diffrence absolue qui spare la sant de la maladie; il signifie donc, par une tautologie, la totalit de ce qu'il est, et par son mergence, l'exclusion de ce qu'il n'est pas. Indissociablement, il est, dans son existence de pur phnomne, la seule nature de la maladie et la maladie constitue sa seule nature de phnomne spcifique. Quand il est signifiant par rapport lui-mme, il est donc doublement signifi: par lui-mme et par la maladie qui, en le caractrisant, l'oppose aux phnomnes non pathologiques; mais, pris comme signifi (par lui-mme ou par la maladie), il ne peut recevoir son sens que d'un acte plus ancien, et qui n'appartient pas sa sphre: d'un acte qui le totalise et l'isole, c'est--dire d'un acte qui l'a par avance transform en signe. (1) J.-L.-V. BROUSSONNET, Tableau lmentaire de la smiotique (Montpellier, an VI), p. 60. (2) AUDIBERT-CAILLE, Mmoire sur l'utilit de l'analogie en mdecine (Montpellier, 1814), p. 42. (3) J.-L.-V. BROUSSONNET, loc. cit., p. 59. |PAGE 92 Cette complexit dans la structure du symptme se retrouve dans toute la philosophie du signe naturel; la pense clinique ne fait que transposer, dans le vocabulaire plus laconique et souvent plus confus de la pratique, une configuration conceptuelle, dont Condillac dispose, en toute latitude, la forme discursive. Le symptme, dans l'quilibre gnral de la pense clinique, joue peu prs le rle du langage d'action: il est pris comme lui, dans le mouvement gnral d'une nature; et sa force de manifestation est aussi primitive, aussi naturellement donne que l'instinct" qui porte cette forme initiale de langage (1) ; il est la maladie l'tat manifeste, comme le langage
d'action est l'impression elle-mme dans la vivacit qui la prolonge, la maintient et la retourne en une forme extrieure, qui est de mme grain que sa vrit intrieure. Mais il est conceptuellement impossible que ce langage immdiat prenne sens pour le regard d'un autre, si n'intervient pas un acte venu d'un autre lieu: acte dont Condillac se donne d'avance le jeu en confrant, aux deux sujets sans parole, imagins en leur immdiate motricit, la conscience (2) ; et dont il a cach la nature singulire et souveraine en l'insrant dans les mouvements communicatifs et simultans de l'instinct (3). Quand il pose le langage d'action l'origine' de la parole, Condillac y glissait secrtement, en la dpouillant de toute figure concrte (syntaxe, mots et mme sons), la structure linguistique inhrente chacun des actes d'un sujet parlant. Il lui tait dsormais possible d'en dgager le langage tout court, puisqu'il y avait engag l'avance sa possibilit. Il en est de mme, dans la clinique, pour les rapports entre ce langage d'action qui est le symptme, et la structure explicitement linguistique du signe. 2. C'est l'intervention d'une conscience qui transforme le symptme en signe Signes et symptmes sont et disent la mme chose: ceci prs que le signe dit cette mme chose qu'est prcisment le symptme. Dans sa ralit matrielle, le signe s'identifie au symptme lui-mme; celui-ci est le support morphologique indispensable du signe. Donc pas de signe sans symptme (4). Mais (1) CONDILLAC, Essai sur l'origine des connaissances humaines (Oeuvres compltes, an VI), t. I, p. 262. (2) CONDILLAC, ibid., p. 260. 13) CONDILLAC, ibid., pp. 262-263. (4) A.-J. LANDR-BEAUVAIS, Smiotique (Paris, 1813), p. 4. |PAGE 93 ce qui fait que le signe est signe n'appartient pas au symptme mais une activit qui vient d'ailleurs. Donc tout symptme est signe en droit, mais tout signe n'est pas symptme (1) en ce sens que la totalit des symptmes ne parviendra jamais il puiser la ralit du signe. Comment se fait cette opration qui transforme le symptme en lment signifiant, et qui signifie prcisment la maladie comme vrit immdiate du symptme? Par une opration qui se rend visible la totalit du champ de l'exprience en chacun de ses moments, et en dissipe toutes les structures d'opacit:
- opration qui totalise en comparant des organismes: tumeur, rougeur, chaleur, douleur, battements, impression de tension deviennent signe de phlegmon parce que l'on compare une main l'autre, un individu un autre (2) ; - opration qui remmore le fonctionnement normal: un souffle froid chez un sujet est signe d'une disparition de la chaleur animale et, par l, d'un affaiblissement radical des forces vitales et de leur destruction prochaine (3) ; - opration qui enregistre les frquences de la simultanit ou de la succession: Quel rapport y a-t-il entre la langue charge, le tremblement de la lvre infrieure et la disposition au vomissement? On l'ignore, mais l'observation a souvent fait voir les deux premiers phnomnes accompagns de cet tat et cela suffit pour qu' l'avenir ils deviennent signes (4) ; - opration enfin qui, au-del des apparences premires, scrute le corps et dcouvre l'autopsie un invisible visible: ainsi l'examen des cadavres a montr que, dans des cas de pripneumonie avec expectoration, la douleur brusquement interrompue et le pouls devenant peu peu insensible sont signes d'une hpatisation du poumon. Le symptme devient donc signe sous un regard sensible la diffrence, la simultanit ou la succession, et la frquence. Opration spontanment diffrentielle, voue la totalit et la mmoire, calculatrice aussi; acte par consquent qui joint, en un seul mouvement, l'lment et la liaison des lments notre eux. En quoi il n'est, au fond, que l'Analyse de Condillac mise en pratique dans la perception mdicale. Ici et l ne s'agit-il (1) Ibid. (2) FAVART, Essai sur l'entendement mdical (Paris, 1822), pp. 8-9. (3) J. LANDR-BEAUVAIS, loc. cit., p. 5. (4) Ibid., p. 6. |PAGE 94 pas simplement de composer et dcomposer nos ides pour en faire diffrentes comparaisons et pour dcouvrir par ce moyen les rapports qu'elles ont entre elles, et les nouvelles ides qu'elles peuvent produire (1) ? L'Analyse et le regard clinique ont aussi ce trait commun de ne composer et. dcomposer que pour mettre jour une ordonnance qui est l'ordre naturel lui-mme: leur artifice est de n'oprer que dans l'acte restitutif de l'originaire: Cette analyse est le vrai secret des dcouvertes parce qu'elle mous fait remonter l'origine des choses (2). Pour la clinique, cette origine, c'est l'ordre naturel des symptmes, la forme de leur succession ou de leur
dtermination rciproque. Entre signe et symptme, il y a une diffrence dcisive qui ne prend sa valeur que sur fond d'une identit essentielle: le signe c'est le symptme lui-mme, mais dans sa vrit d'origine. Enfin, l'horizon de l'exprience clinique, se dessine la possibilit d'une lecture exhaustive, sans obscurit ni rsidu: pour un mdecin dont les connaissances seraient portes au plus haut degr de perfection, tous les symptmes pourraient devenir des signes (3) : toutes les manifestations pathologiques parleraient un langage clair et ordonn. On serait enfin de plain-pied avec cette forme sereine et accomplie de la connaissance scientifique dont parle Condillac, et qui est langue bien faite. 3. L'tre de la maladie est entirement nonable en sa vrit Les signes extrieurs pris de l'tat du pouls, de la chaleur, de la respiration, des fonctions de l'entendement, de l'altration des traits du visage, des affections nerveuses ou spasmodiques, de la lsion des apptits naturels, forment par leurs diverses combinaisons des tableaux dtachs, plus ou moins distincts ou fortement prononcs... La maladie doit tre considre comme un tout indivisible depuis son dbut jusqu' sa terminaison, un ensemble rgulier de symptmes caractristiques et une succession de priodes (4). Il ne s'agit plus de donner de quoi reconnatre la maladie, mais de restituer, au niveau des mots, une histoire qui en couvre l'tre total. A la prsence exhaustive de la maladie dans ses symptmes, correspond la transparence (1) CONDILLAC, Essai sur l'origine des connaissances humaines, p. 109. (2) CONDILLAC, ibid. (3) DEMORCY-DELETTRE, Essai sur l'analyse applique au perfectionnement de la mdecine (Paris, 1810), p. 102. (4) Ph. PINEL, La mdecine clinique (3e d. Paris, 1815), introd. p. VII. |PAGE 95 sans obstacle de l'tre pathologique la syntaxe d'un langage descriptif: isomorphisme fondamental de la structure de la maladie et de la forme verbale qui la cerne. L'acte descriptif est, de plein droit, une prise d'tre, et inversement, l'tre ne se donne pas voir dans des manifestations symptomatiques, donc essentielles, sans s'offrir la matrise d'un langage qui est la parole mme des choses. Dans la mdecine des espces, la nature de la maladie et sa description ne pouvaient pas correspondre sans un moment intermdiaire qui tait, avec ses deux dimensions, le tableau ; dans la clinique, tre vu et tre parl communiquent d'emble dans la vrit manifeste de la
maladie donc c'est l prcisment tout l'tre. Il n'y a de maladie que dans l'lment du visible, et par consquent de l'nonable. La clinique met en jeu la relation, fondamentale chez Condillac, de l'acte perceptif et de l'lment du langage. La description du clinicien, comme l'Analyse du philosophe, profre ce qui est donn par la relation naturelle entre l'opration de conscience et le signe. Et dans cette reprise, s'nonce l'ordre des enchanements naturels; la syntaxe du langage, loin de pervertir les ncessits logiques du temps, les restitue dans leur articulation la plus originaire: Analyser n'est autre chose qu'observer dans un ordre successif les qualits d'un objet afin de leur donner dans l'esprit l'ordre simultan dans lequel elles existent... Or, quel est cet ordre? La nature l'indique d'elle-mme; c'est celui dans lequel elle offre les objets (1). L'ordre de la vrit ne fait qu'une chose avec celui du langage, parce que l'un et l'autre restituent en sa forme ncessaire et nonable, c'est--dire discursive, le temps. L'histoire des maladies, laquelle Sauvages donnait un sens obscurment spatial, prend maintenant sa dimension chronologique. Le cours du temps occupe dans la structure de ce nouveau savoir le rle tenu dans la mdecine classificatrice par l'espace plat du tableau nosologique. L'opposition entre la nature et le temps, entre ce qui se manifeste et ce qui annonce a disparu; disparu aussi le partage entre l'essence de la maladie, ses symptmes et ses signes; disparus enfin le jeu et la distance par lesquels la maladie se manifestait mais comme en retrait, par lesquels elle se trahissait mais dans le lointain et dans l'incertitude. La maladie a chapp cette structure tournante du visible qui la rend invisible et de l'invisible qui la fait voir, pour se dissiper dans la multiplicit (1) CONDILLAC cit par Ph. PINEL, Nosographie philosophique (Paris, an VI), introd. p. XI. |PAGE 96 visible des symptmes qui en signifient sans rsidu le sens. Le champ mdical ne connatra plus ces espces muettes, donnes et retires : il s'ouvrira sur quelque chose qui, toujours, parle un langage solidaire dans son existence et son sens du regard qui le dchiffre -langage indissociablement lu et lisant. Isomorphe de l'Idologie, l'exprience clinique lui offre un domaine immdiat d'application. Non pas que, dans le sillage suppos de Condillac, la mdecine soit revenue un respect enfin empirique de la chose perue; mais dans la Clinique, comme dans l'Analyse, l'armature du rel est dessine d'aprs le modle du langage. Le regard du clinicien et la rflexion du philosophe dtiennent des
pouvoirs analogues, parce qu'ils prsupposent tous deux une structure d'objectivit identique: o la totalit de l'tre s'puise dans des manifestations qui en sont le signifiant signifi; o le visible et le manifeste se rejoignent en une identit au moins virtuelle; o le peru et le perceptible peuvent tre tout entiers restitus dans un langage dont la forme rigoureuse en nonce l'origine. Perception discursive et rflchie du mdecin, et rflexion discursive du philosophe Sur la perception viennent se rejoindre en une exacte superposition, puisque le monde est pour eux l'anolagon du langage. La mdecine, connaissance incertaine: vieux thme auquel le XVIIIe sicle tait singulirement sensible. Il y retrouvait, souligne encore par la proche histoire, l'opposition traditionnelle de l'art mdical la connaissance des choses inertes: La science de l'homme s'occupe d'un objet trop compliqu, elle embrasse une multitude de faits trop varis, elle opre sur des lments trop subtils et trop nombreux pour donner toujours aux immenses combinaisons dont il est susceptible, l'uniformit, l'vidence, la certitude qui caractrisent les sciences physiques et mathmatiques (1). Incertitude qui tait signe de complexit du ct de l'objet, d'imperfection du ct de la science; aucun fondement objectif n'tait donn au caractre conjectural de la mdecine en dehors du rapport de cette extrme exigut cet excs de richesse. De ce dfaut, le XVIIIe sicle, en ses dernires annes, fait (1) C.-L. DUMAS, Discours sur les progrs futurs de la science de lhomme Montpellier, an XII), pp. 27-28. |PAGE 97 un lment positif de connaissance. A l'poque de Laplace, soit sous son influence, soit l'intrieur d'un mouvement de pense du mme type, la mdecine dcouvre que l'incertitude peut tre traite, analytiquement, comme la somme d'un certain nombre de degrs de certitude isolables et susceptibles d'un calcul rigoureux. Ainsi, ce concept confus et ngatif, qui tenait son sens d'une opposition traditionnelle la connaissance mathmatique, va pouvoir se retourner en un concept positif, offert la pntration d'une technique propre au calcul. Ce retournement conceptuel a t dcisif: il a ouvert l'investigation un domaine o chaque fait constat, isol, puis confront un ensemble a pu prendre place dans toute une srie d'vnements dont la convergence ou la divergence taient en principe mesurables. Il faisait de chaque lment peru un vnement enregistr, et de l'volution incertaine o il se trouve plac une srie alatoire. Il donnait au champ clinique une structure nouvelle o l'individu mis en
question est moins la personne malade que le fait pathologique indfiniment reproductible chez tous les malades semblablement atteints; o la pluralit des constatations n'est plus simplement contradiction ou confirmation, mais convergence progressive et thoriquement indfinie; o le temps enfin n'est pas un lment d'imprvisivibilit qui peut masquer et qu'il faut dominer par un savoir anticipateur, mais une dimension intgrer puisqu'il apporte dans son propre cours les lments de la srie comme autant de degrs de certitude. Par l'importation de la pense probabilitaire, la mdecine renouvelait entirement les valeurs perceptives de son domaine : l'espace dans lequel devait s'exercer l'attention du mdecin devenait un espace illimit, constitu d'vnements isolables dont la forme de solidarit tait de l'ordre de la srie. La dialectique simple de l'espce pathologique et de l'individu malade, d'un espace clos et d'un temps incertain, est, en principe, dnoue. La mdecine ne se donne plus voir le vrai essentiel sous l'individualit sensible; elle est devant la tche de percevoir, et l'infini, les vnements d'un domaine ouvert. C'est cela la clinique. Mais ce schma n'a t cette poque ni radicalis, ni rflchi, ni mme tabli d'une faon absolument cohrente. Plus que d'une structure d'ensemble, il s'agit plutt de thmes structuraux qui se juxtaposent sans avoir trouv leur fondement. Alors que pour la configuration prcdente (signe-langage) la cohrence tait relle, bien que souvent en demi-jour, ici, la probabilit est sans cesse invoque, comme forme d'explication ou de justification, |PAGE 98 mais le degr de cohrence qu'elle atteint est faible. La raison n'est pas dans la thorie mathmatique des probabilits, mais dans les conditions qui pouvaient la rendre applicable: le recensement des faits physiologiques ou pathologiques comme celui d'une population ou d'une srie d'vnements astronomiques n'tait pas techniquement possible une poque o le champ hospitalier demeurait encore ce point en marge de l'exprience mdicale qu'il en apparaissait souvent comme la caricature ou le miroir dformant. Une matrise conceptuelle de la probabilit en mdecine impliquait la validation d'un domaine hospitalier, qui, son tour, ne pouvait tre reconnu comme espace d'exprience que par une pense dj probabilitaire. D'o le caractre imparfait, prcaire et partiel du calcul des certitudes, et le fait qu'il se soit cherch un fondement confus, oppos son sens technologique intrinsque. Ainsi Cabanis tentait de justifier les instruments, encore en formation, de la clinique l'aide d'un concept dont le niveau technique et thorique appartenait une
sdimentation bien plus ancienne. Il n'avait laiss de ct le vieux concept d'incertitude que pour ractiver celui, gure mieux adapt, de l'imprcise et libre profusion de la nature. Celle-ci ne porte rien dans l'exacte prcision: elle semble avoir voulu se conserver une certaine latitude, afin de laisser aux mouvements qu'elle imprime cette libert rgulire qui ne leur permet jamais de sortir de l'ordre, mais qui les rend plus varis et leur donne plus de grce (1). Mais la part importante, dcisive du texte est dans la note qui l'accompagne:Cette latitude correspond exactement celle que l'art peut se donner dans la pratique, ou plutt elle en fournit la mesure. L'imprcision que Cabanis 'prte aux mouvements de la nature n'est qu'un vide laiss pour que vienne s'y loger et s'y fonder l'armature technique d'une perception des cas. En voici les principaux moments. 1. La complexit de combinaison. -La nosographie du XVIIIe sicle impliquait une configuration de l'exprience telle que, aussi brouills et compliqus que soient les phnomnes dans leur prsentation concrte, ils relevaient, plus ou moins directement, d'essences dont la gnralit croissante garantissait une complexit dcroissante: la classe tait plus simple que l'espce, qui l'tait toujours plus que la maladie prsente, avec tous ses phnomnes et chacune de leurs modifications chez un individu donn. A la fin du XVIIIe sicle, et dans une dfinition (1) CABANIS, Du degr de certitude de la mdecine (3e d., Paris, 1819), p. 125. |PAGE 99 de l'exprience du mme type que celle de Condillac, la simplicit ne se rencontre pas dans la gnralit essentielle, mais au niveau premier du donn, dans le petit nombre des lments indfiniment rpts. Ce n'est pas la classe des fivres qui, grce la faible comprhension de son concept, est principe d'intelligibilit; mais le petit nombre d'lments indispensables pour constituer une fivre, dans tous les cas concrets o elle se prsente. La varit combinatoire des formes simples constitue la diversit empirique: A chaque cas nouveau, l'on croirait que ce sont des faits nouveaux; mais ce ne sont que d'autres combinaisons, ce ne sont que d'autres nuances: dans l'tat pathologique, il n'y a jamais qu'un petit nombre de faits principaux, tous les autres rsultent de leur mlange et de leurs diffrents degrs d'intensit. L'ordre dans lequel ils paraissent, leur importance, leurs rapports divers suffisent pour donner naissance toutes les varits de maladies (1). Par consquent, la complexit des cas individuels n'est plus mettre au compte de ces incontrlables modifications qui perturbent les vrits essentielles, et
contraignent ne les dchiffrer que dans un acte de reconnaissance qui nglige et abstrait; elle peut tre saisie et reconnue en ellemme, dans une fidlit sans rsidu tout ce qu'elle prsente, si on l'analyse selon les principes d'une combinaison; c'est--dire si on dfinit l'ensemble des lments qui la compose, et la forme de cette composition. Connatre sera donc restituer le mouvement par lequel la nature associe. Et c'est en ce sens que la connaissance de la vie et la vie elle-mme obissent aux mmes lois de gense -alors que dans la pense classificatrice, cette concidence ne pouvait exister qu'une seule fois et dans l'entendement divin; le progrs de la connaissance a maintenant la mme origine et se trouve pris dans le mme devenir empirique que la progression de la vie: La nature a voulu que la source de nos connaissances ft la mme que celle de la vie; il faut recevoir des impressions pour vivre; il faut recevoir des impressions pour connatre (2) ; et la loi de dveloppement ici et l, c'est la loi de combinaison de ces lments. 2. Le principe de l'analogie. -L'tude combinatoire des lments met jour des formes analogues de coexistence ou de succession qui permettent d'identifier des symptmes et des maladies. La mdecine des espces et des classes en usait galement dans le dcryptement des phnomnes pathologiques: on reconnaissait la ressemblance des troubles d'un cas l'autre, (1) Ibid., pp. 86-87. (2) Ibid., pp. 76-77. |PAGE 100 comme d'une plante l'autre l'allure de leurs organes de reproduction. Mais ces analogies ne portaient jamais que sur des donnes morphologiques inertes: il s'agissait de formes perues dont les lignes gnrales taient superposables, d'un tat inactif et constant des corps, tat tranger la nature actuelle de la fonction (1). Les analogies sur lesquelles s'appuie le regard clinique pour reconnatre, sur diffrents malades, signes et symptmes, sont d'un autre ordre; elles consistent dans les rapports qui existent d'abord entre les parties constituantes d'une' seule maladie et ensuite entre une maladie connue et une maladie connatre (2). Ainsi comprise, l'analogie n'est plus une ressemblance de parent plus ou moins proche et s'effaant mesure qu'on s'loigne de l'identit essentielle; c'est un isomorphisme de rapports entre des lments: elle porte sur un systme de relations et d'actions rciproques, sur un fonctionnement ou un dysfonctionnement. Ainsi, la difficult de respirer est un phnomne qu'on retrouve sous une morphologie assez peu diffrente dans la phtisie, l'asthme, les maladies du coeur,
la pleursie et le scorbut: mais s'en tenir une telle ressemblance serait illusoire et dangereux; l'analogie fconde et qui dsigne l'identit d'un symptme, c'est un rapport entretenu avec d'autres fonctions ou d'autres troubles: la faiblesse musculaire (qu'on retrouve dans l'hydropisie), la lividit du teint (semblable celle des obstructions), les taches sur le corps (comme dans la variole) et le gonflement des gencives (identique celui provoqu par l'accumulation du tartre), forment une constellation o la coexistence des lments dsigne une interaction fonctionnelle propre au scorbut (3). C'est l'analogie de ces rapports qui permettra d'identifier une maladie dans une srie de malades. Mais il y a plus: l'intrieur d'une mme maladie et chez un seul malade, le principe d'analogie peut permettre de cerner dans son ensemble la singularit de la maladie. Les mdecins du XVIIIe sicle avaient us et abus, aprs le concept de sympathie, de la notion de complication qui permettait toujours de retrouver une essence pathologique puisqu'on pouvait soustraire la symptomatique manifeste ce qui, en contradiction avec la vrit essentielle, tait dsign comme interfrence. Ainsi une fivre gastrique (fivre, cphalalgie, soif, sensibilit l'pigastre) (1) AUDIBERT-CAILLE, Mmoire sur l'utilit de l'analogie en mdecine (Montpellier, 1814), p. 13. (2) Ibid., p. 30. (3) C.-A. BRULLEY, De l'art de conjecturer en mdecine (Paris, 1801), p. 85-87. |PAGE 101 restait conforme son essence lorsqu'elle tait accompagne de prostration, de djections involontaires, d'un pouls petit et intermittent, d'une gne de la dglutition: c'est qu'alors elle est complique d'une fivre adynamique (1). Un usage rigoureux de l'analogie devait permettre d'viter un tel arbitraire dans les partages et les groupements. D'un symptme l'autre, en un mme ensemble pathologique, on peut retrouver une certaine analogie dans leurs rapports avec les causes externes ou n ternes qui les produisent (2). Ainsi pour la pripneumonie bilieuse dont beaucoup de nosographes faisaient une maladie complique : si on peroit l'homologie de rapport qui existe entre la gastricit (entranant symptmes digestifs et douleurs pigastriques), et l'irritation des organes pulmonaires qui appelle l'inflammation et tous les troubles respiratoires, des secteurs symptomatologiques diffrents et semblant relever d'essences morbides distinctes permettent de donner pourtant la maladie son identit: celle d'une figure
complexe dans la cohrence d'une' unit, et non d'une ralit mixte faite d'essences croises. 3. La perception des frquences. -La connaissance mdicale n'aura de certitude qu' proportion du nombre de cas sur lesquels son examen aura port: cette certitude sera entire si on l'extrait d'une masse de probabilit suffisante ; mais s'il n'est point la dduction rigoureuse de cas assez nombreux, le savoir reste dans l'ordre des conjectures et des vraisemblances; il n'est plus que l'expression simple des observations particulires (3). La certitude mdicale se constitue non pas partir de l'individualit compltement observe, mais d'une multiplicit entirement parcourue de faits individuels. Par sa multiplicit, la srie devient porteuse d'un indice de convergence. L'hmoptysie tait place par Sauvages dans la classe des hmorragies, et la phtisie dans celle des fivres: rpartition conforme la structure des phnomnes, et qu'aucune conjonction symptomatique ne pouvait mettre en question. Mais si l'ensemble phtisie-hmoptysie (malgr bien des dissociations selon les cas, les circonstances, les moments) atteint dans la srie totale une certaine densit quantitative, leur appartenance deviendra, au-del de toute rencontre ou de toute lacune, en dehors mme de l'allure apparente des phnomnes, relation (1) Ph. PINEL, Mdecine clinique, p. 78. (2) AUDIBERT-CAILLE, loc. cit., p. 31. (3) C.-L. DUMAS, Discours sur les progrs futurs de la science de l'homme (Montpellier, an XII), p. 28. |PAGE 102 essentielle: C'est dans l'tude des phnomnes les plus frquents, dans la mditation de l'ordre de leurs rapports et de leur succession rgulire que l'on trouve les bases des lois gnrales de la nature (1). Les variations individuelles s'effacent spontanment par intgration. Dans la mdecine des espces, cet effacement des modifications singulires n'tait assur que par une opration positive: pour accder la puret de l'essence, il fallait dj la possder et oblitrer par elle le contenu trop riche de l'exprience; il fallait, par un choix primitif, distinguer ce qui est constant de ce qui s'y trouve de variable, et l'essentiel de ce qui n'est que purement accidentel (2). Les variations, dans l'exprience clinique, on ne les carte pas, elles se rpartissent d'elles-mmes; elles s'annulent dans la configuration gnrale, parce qu'elles s'intgrent au domaine de probabilit; jamais elles ne tombent hors limites, aussiinattendues, aussiextraordinaires qu'elles soient; l'anormal est encore une forme
de rgularit: L'tude des monstres ou des monstruosits de l'espce humaine nous donne une ide des ressources fcondes de la nature et des carts auxquels elle peut se livrer (3). Il faut bien alors abandonner l'ide d'un Spectateur idal et transcendant dont le gnie ou la patience des observateurs rels saurait plus ou moins s'approcher. Le seul observateur normatif, c'est la totalit des observateurs: leurs erreurs de perspectives individuelles se rpartissent en un ensemble qui a ses pouvoirs propres d'indication. Leurs divergences mme laissent apparatre, en ce noyau o, malgr tout, elles se recoupent, le profil d'irrcusables identits: Plusieurs observateurs ne voient jamais le mme fait de manire identique, moins que la nature ne leur ait rellement offert de la mme manire. Dans l'ombre, et sous un vocabulaire approch, des notions circulent, o on peut reconnatre le calcul d'erreur, l'cart, les limites, la valeur de la moyenne. Toutes indiquent que la visibilit du champ mdical prend une structure statistique et que la mdecine se donne pour champ perceptif non plus un jardin d'espces, mais un domaine d'vnements. Mais rien encore n'est formalis. Et curieusement, c'est dans l'effort pour penser un calcul des probabilits mdicales que l'chec va se dessiner, et les raisons de l'chec apparatre. (1) F.-J. DOUBLE, Smiologie gnrale (Paris, 1811), t. I, p. 33. (2) ZIMMERMANN, Trait de l'exprience, t. I, p. 146. (3) F.-J. DOUBLE, Smiologie gnrale, t. I, p. 33. |PAGE 103 Echec qui ne tient pas, en son principe, une ignorance, ou un usage trop superficiel de l'instrument mathmatique (1), mais l'organisation du champ. 4. Le calcul des degrs de certitude. -Si l'on dcouvre un jour dans le calcul des probabilits une mthode qui puisse convenablement s'adapter aux objets compliqus, aux ides abstraites, aux lments variables de la mdecine et de la physiologie, on y produira bientt le plus haut degr de certitude o les sciences puissent parvenir (2). Il s'agit d'un calcul qui, d'entre de jeu, vaut l'intrieur du domaine des ides, tant la fois principe de leur analyse en lments constituants, et mthode d'induction partir des frquences; il se donne d'une faon ambigu, comme dcomposition logique et arithmtique de l'approximation. C'est qu'en effet la mdecine de la fin du XVIIIe sicle n'a jamais su si elle s'adressait une srie de faits dont les lois d'apparition et de convergence devaient tre dtermines par la seule tude des rptitions, ou si elle s'adressait un ensemble de signes, de symptmes et de manifestations dont la
cohrence devait tre cherche dans une structure naturelle. Elle a sans cesse hsit entre une pathologie des phnomnes et une pathologie des cas. C'est pourquoi le calcul des degrs de probabilit a t aussitt confondu avec l'analyse des lments symptomatiques: d'une faon bien trange, c'est le signe en tant qu'lment d'une constellation qui s'est trouv affect, par une sorte de droit de nature, d'un coefficient de probabilit. Or ce qui lui donnait sa valeur de signe n'tait pas une arithmtique des cas, c'tait sa liaison avec un ensemble de phnomnes. Sous une apparence mathmatique, on jaugeait de la stabilit d'une figure. Le terme de degr de certitude prlev chez les mathmaticiens dsignait, par une arithmtique fruste, le caractre plus ou moins ncessaire d'une implication. Un exemple simple permettra de saisir sur le vif cette fondamentale confusion. Brulley rappelle le principe formul dans l'Ars conjectandi de Jacques Bernoulli, que toute certitude peut tre considre comme un tout divisible en autant de probabilits qu'on voudra (3). Ainsi la certitude de la grossesse chez une femme peut se diviser en 8 degrs: la disparition des (1) BRULLEY, par exemple, connat bien les textes de Bernoulli, de Condorcet, S'Gravesandy, Essai sur l'Art de conjecturer en mdecine (Paris, an X), pp. 35-37. (2) C.-L. DUMAS, loc. cit., p. 29. (3) C.-A. BRULLEY, loc. cit., pp. 26-27. |PAGE 104 rgles; les nauses et le vomissement au premier mois; au second, l'augmentation du volume de la matrice; augmentation plus considrable encore au 3e mois; puis apparition de la matrice audessus des os du pubis; le 6e degr, c'est, au 5e mois, la saillie de toute la rgion hypogastrique; le 7e, c'est le mouvement spontan du foetus, qui frappe la surface interne de la matrice; enfin, le 8e degr de certitude est constitu, au dbut du dernier mois, par les mouvements de ballottement et de dplacement (1). Chacun des signes porte donc en lui-mme un huitime de certitude: la succession des quatre premiers constitue une demi-certitude qui forme le doute proprement dit, et peut tre envisag comme une espce d'quilibre; au-del commence la vraisemblance (2). Cette arithmtique de l'implication vaut pour les indications curatives comme pour les signes diagnostiques. Un malade qui avait consult Brulley voulait se faire oprer de la pierre; en faveur de l'intervention, deux probabilits favorables : le bon tat de la vessie, le petit volume de la pierre; mais contre elles, quatre probabilits dfavorables: le malade est sexagnaire; il est du sexe masculin; il a
un temprament bilieux; il est atteint d'une maladie de peau. Or le sujet n'a pas voulu entendre cette arithmtique simple; il n'a pas survcu l'opration. On veut pondrer par une arithmtique des cas une appartenance de structure logique; on suppose qu'entre le phnomne et ce qu'il signifie, le lien est le mme qu'entre l'vnement et la srie dont il fait partie. Cette confusion n'est possible que par les vertus ambigus de la notion d'analyse dont les mdecins tout instant se rclament: Sans l'analyse, ce fil emblmatique de ddale, nous ne pourrions souvent, travers les routes tortueuses, aborder l'asile de la vrit (3). Or, cette analyse est dfinie selon le modle pistmologique des mathmatiques et selon la structure instrumentale de l'idologie. Comme instrument, elle sert dfinir, dans son ensemble complexe, le systme des implications: Par cette mthode, on dcompose, on dissque un sujet, une ide compose; on examine sparment les parties les unes aprs les autres; les plus essentielles d'abord, puis celles qui le sont moins, avec leurs divers rapports; on s'lve l'ide la plus simple; mais d'aprs le modle mathmatique, cette analyse devait servir dterminer une inconnue: On examine (1) Ibid., pp. 27-30. (2) Ibid., pp. 31-32. (3) ROUCHER-DERATTE, Leons sur l'art d'observer (Paris, 1807), p. 53. |PAGE 105 le mode de composition, la manire dont il s'est opr, et par l, on parvient du connu l'inconnu, et cela par l'usage de l'induction (1). Selle disait de la clinique qu'elle n'tait gure que l'exercice mme de la mdecine auprs du lit des malades, et que, dans cette mesure, elle s'identifiait avec la mdecine pratique proprement dite (2). Beaucoup plus qu'une reprise du vieil empirisme mdical, la clinique est la vie concrte, une des applications premires de l'Analyse. Aussi bien, tout en prouvant son opposition aux systmes et aux thories, reconnat-elle son immdiate parent avec la philosophie: Pourquoi sparer la science des mdecins de celle des philosophes? Pourquoi distinguer deux tudes qui se confondent par une origine et une destination communes? (3). La clinique ouvre un champ rendu visible par l'introduction dans le domaine pathologique de structures grammaticales et probabilitaires. Celles-ci peuvent tre historiquement dates, puisqu'elles sont contemporaines de Condillac et de ses successeurs. Avec elles la perception mdicale se libre du jeu de l'essence et des symptmes, et de celui, non moins ambigu, de l'espce et des individus: la figure
disparat, qui faisait pivoter le visible et l'invisible selon le principe que le malade cache et montre la fois la spcificit de 'sa maladie. Un domaine de claire visibilit s'ouvre pour le regard. Mais lui-mme, ce domaine, et ce qui, fondamentalement, le rend visible, ne sont-ils pas double entente? Ne reposent-ils pas sur des figures qui se chevauchent et l'une l'autre s'esquivent? Le modle grammatical, acclimat dans l'analyse des signes, reste implicite et envelopp sans formalisation au fond du mouvement conceptuel: il s'agit d'un transfert des formes de l'intelligibilit. Le modle mathmatique est toujours explicite et invoqu; il est prsent comme principe de cohrence d'un processus conceptuel qui s'est accompli hors de lui: il s'agit de l'apport de thmes de formalisation. Mais cette ambigut fondamentale n'est pas prouve comme telle. Et le regard qui se pose sur ce domaine apparemment libr a paru, un temps, un regard heureux. (1) Ibid., p. 53. (2) SELLE, Introduction l'tude de la nature (trad. fr., Paris, an III), p. 229. (3) C.-L. DUMAS, loc. cit., p. 21. |PAGE 107 CHAPITRE VII Voir, Savoir Hippocrate ne s'est attach qu' l'observation et a mpris tous les systmes. Ce n'est qu'en marchant sur ses traces que la mdecine peut tre perfectionne (1). Mais les privilges que la clinique vient de reconnatre l'observation sont bien plus nombreux et de tout autre nature que les prestiges qu'on lui prtait dans la tradition. Ce sont la fois les privilges d'un regard pur, antrieur toute intervention, fidle l'immdiat qu'il reprend sans le modifier, et ceux d'un regard quip de toute une armature logique qui exorcise d'entre de jeu la navet d'un empirisme non prpar. Il faut dcrire maintenant l'exercice concret d'une telle perception. Le regard qui observe se garde d'intervenir: il est muet et sans geste. L'observation laisse en place; il n'y a rien pour elle de cach dans ce qui se donne. Le corrlatif de l'observation n'est jamais l'invisible, mais toujours l'immdiatement visible, une fois carts les obstacles que suscitent la raison les thories, aux sens l'imagination. Dans la thmatique du clinicien, la puret du regard est lie un certain silence qui permet d'couter. Les discours bavards des systmes doivent s'interrompre: Toute thorie se tait ou s'vanouit toujours au
lit du malade (2) ; et doivent tre rduits galement les propos de l'imagination, qui anticipent sur ce qu'on peroit, dcouvrent d'illusoires rapports et font parler ce qui est inaccessible aux sens: Qu'il est rare cet observateur accompli qui sait attendre dans le silence de l'imagination, (1) CLIFTON, Etat de la mdecine ancienne et moderne, prface du traducteur, non pagin (Paris, 1742). (2) CORVISART, Prface la traduction d'AUENBRUGGER, Nouvelle mthode pour reconnatre les maladies internes de la poitrine (Paris, 1808), p. VII. |PAGE 108 dans le calme de l'esprit et avant de former son jugement, le rapport d'un sens actuellement en exercice! (1). Le regard s'accomplira dans sa vrit propre et aura accs la vrit des choses, s'il se pose en silence sur elles; si tout se tait autour de ce qu'il voit. Le regard clinique a cette paradoxale proprit d'entendre un langage au moment o il peroit un spectacle. Dans la clinique, ce qui se manifeste est originairement ce qui parle. L'opposition entre clinique et exprimentation recouvre exactement la diffrence entre le langage qu'on entend et, par consquent, qu'on reconnat, et la question qu'on pose, c'est--dire qu'on impose; L'observateur... lit la nature, celui qui fait l'exprience l'interroge (2). Dans cette mesure, observation et exprience s'opposent sans s'exclure: il est naturel que la premire conduise la seconde, mais la condition que celleci n'interroge que dans le vocabulaire et l'intrieur du langage qui lui a t propos par les choses observes; ses questions ne peuvent tre fondes que si elles sont rponses une rponse elle-mme sans question, une rponse absolue qui n'implique aucun langage antrieur, parce qu'elle est, au sens strict, le premier mot. C'est ce privilge d'indpassable origine que Double traduisait en termes de causalit: Il ne faut pas confondre l'observation avec l'exprience; celle-ci est le rsultat ou l'effet; celle-l le moyen ou la cause; l'observation conduit naturellement l'exprience (3). Le regard qui observe ne manifeste ses vertus que dans un double silence: celui, relatif, des thories, des imaginations et de tout ce qui fait obstacle l'immdiat sensible; et celui, absolu, de tout langage qui serait antrieur celui du visible. Sur l'paisseur de ce double silence, les choses vues peuvent enfin tre entendues, et entendues par le seul fait qu'elles sont vues. C'est alors que ce regard qui se retient au bord de toute intervention possible, de toute dcision exprimentale, ce regard qui ne modifie pas, montre que sa rserve est lie la solidit de son armature. Il ne
lui suffit pas, pour tre ce qu'il doit tre, d'exercer sa prudence ou son scepticisme; l'immdiat sur lequel il s'ouvre n'nonce la vrit que s'il est en mme temps l'origine, c'est--dire point de dpart, principe et loi de composition; et le regard doit restituer comme vrit ce qui a t produit selon une gense: en d'autres termes, il doit (1) Ibid., p. VIII. (2) ROUCHER-DERATTE, Leons sur l'art d'observer (Paris, 1807), p. 14. (3) DOUBLE, Smiologie gnrale, t. I, p. 80. |PAGE 109 reproduire dans les oprations qui lui sont propres ce qui a t donn dans le mouvement mme de la composition. C'est en cela justement qu'il est analytique. L'observation, c'est la logique au niveau des contenus perceptifs; et l'art d'observer serait une logique pour les sens qui enseignerait plus particulirement leurs oprations et leurs usages. En un mot, ce serait l'art d'tre en rapport avec les circonstances qui intressent, de recevoir les impressions des objets comme elles s'offrent nous, et d'en tirer les inductions qui en sont les justes consquences. La logique est... la base de l'art d'observer, mais cet art pourrait tre regard comme une des parties de la Logique dont l'objet serait plus dpendant des sens (1). On peut donc, en premire approximation, dfinir ce regard clinique comme un acte perceptif sous-tendu par une logique des oprations; il est analytique parce qu'il reconstitue la gense de la composition; mais il est pur de toute intervention dans la mesure o cette gense n'est que la syntaxe du langage que parlent les choses elles-mmes dans un originaire silence. Le regard de l'observation et les choses qu'il peroit communiquent par un mme Logos qui est ici gense des ensembles et l logique des oprations. L'observation clinique suppose l'organisation de deux domaines qui sont conjugus entre eux: le domaine hospitalier et le domaine pdagogique. Le domaine hospitalier est celui o le fait pathologique apparat dans sa singularit d'vnement et dans la srie qui l'entoure. Nagure encore, la famille formait le lieu naturel o la vrit affleurait sans altration; maintenant, on lui a dcouvert un double pouvoir d'illusion: la maladie risque d'y tre masque par des soins, un rgime, une tactique qui la perturbent; et elle est prise dans la singularit de conditions physiques qui la rendent incomparable aux autres. Du moment que la connaissance mdicale se dfinit en termes de frquence, ce n'est pas d'un milieu naturel qu'on a besoin, mais d'un domaine neutre, c'est--dire homogne en toutes ses
parties pour qu'une comparaison soit possible, et ouvert sans principe (1) SENEBIER, Essai sur l'art d'observer et de faire des expriences (2e d., Paris, 1802), t. I, p. 6. |PAGE 110 de slection ou d'exclusion toute forme d'vnement pathologique. Il faut que tout y soit possible et possible de la mme manire. Quelle source d'instruction que deux infirmeries de 100 150 malades chacune!... Quel spectacle vari de fivres ou de phlegmasies malignes ou bnignes, tantt trs dveloppes dans les constitutions fortes, tantt faiblement prononces et comme latentes, et avec toutes les formes et les modifications que peuvent offrir l'ge, la manire de vivre, les saisons et les affections morales plus ou moins nergiques! (1). Quant la vieille objection, que l'hpital provoque des modifications qui sont la fois des troubles pathologiques et des troubles de l'ordonnance des formes pathologiques, elle n'est ni leve ni nglige: mais, en toute rigueur, annule, puisque les modifications en question valent d'une faon uniforme pour tous les vnements; il est donc possible de les isoler par l'analyse et de les traiter sparment; c'est en mettant part les modifications dues aux localits, aux saisons, la nature du traitement qu'on peut parvenir mettre dans la clinique des hpitaux et l'exercice gnral de la mdecine, un degr de prvision et d'exactitude dont elle est encore susceptible (2). La clinique n'est donc pas ce paysage mythique o les maladies apparaissent en ellesmmes et absolument dvoiles; elle permet l'intgration, dans l'exprience, de la modification hospitalire sous forme constante. Ce que la mdecine des espces appelait la nature se rvle n'tre que la discontinuit des conditions htrognes et artificielles; quant aux maladies artificielles de l'hpital, elles autorisent une rduction l'homogne du champ des vnements pathologiques; sans doute le domaine hospitalier n'est pas pure transparence la vrit; mais la rfraction qui lui est propre permet, par sa constance, l'analyse de la vrit. Par le jeu indfini des modifications et des rptitions, la clinique hospitalire permet donc la mise part de l'extrinsque. Or, ce mme jeu rend possible la sommation de l'essentiel dans la connaissance: les variations, en effet, s'annulent, et l'effet de rptition des phnomnes constants dessine spontanment les conjonctions fondamentales. La vrit, en s'indiquant elle-mme sous une forme rptitive, indique le chemin qui permet de l'acqurir. Elle se donne connatre en se donnant reconnatre. L'lve... ne peut trop se familiariser avec la vue
(1) Ph. PINEL, Mdecine clinique (Paris, 1815), Introd., p. II. (2) Ibid., p. 1. |PAGE 111 rpte des altrations de tout genre dont sa pratique particulire pourra, dans la suite, lui offrir le tableau (1). La gense de la manifestation de la vrit est aussi la gense de la connaissance de la vrit. Il n'y a donc pas de diffrence de nature entre la clinique comme science et la clinique comme pdagogie. Ainsi, se forme un groupe, constitu par le matre et ses lves, o l'acte de reconnatre et l'effort pour connatre s'accomplissent en un seul et mme mouvement. L'exprience mdicale, dans sa structure et dans ses deux aspects de manifestation et d'acquisition, a maintenant un sujet collectif; elle n'est plus partage entre celui qui sait et celui qui ignore; elle est faite solidairement par celui qui dvoile et ceux devant qui on dvoile. L'nonc est le mme; la maladie parle le mme langage aux uns et aux autres. Structure collective du sujet de l'exprience mdicale; caractre de collection du champ hospitalier: la clinique se situe la rencontre des deux ensembles; l'exprience qui la dfinit parcourt la surface de leur affrontement et de leur rciproque limite. L elle prend son inpuisable richesse, mais aussi sa figure suffisante et ferme. Elle est la dcoupe du domaine infini des vnements par l'entrecroisement du regard et des questions concertes. A la clinique d'Edimbourg, l'observation clinique consistait en quatre sries de questions: la premire sur l'ge, le sexe, le temprament, la profession du malade; la seconde sur les symptmes qu'il prouvait; la troisime concernait l'origine et le dveloppement de la maladie; la quatrime enfin portait sur les causes loignes et les accidents antrieurs (2). Une autre mthode -et elle tait utilise Montpellier -consistait en un examen gnral de toutes les modifications visibles de l'organisme: 10 les altrations que prsentent les qualits du corps en gnral; 20 celles qu'on remarque dans les matires excrtes; 30 enfin celles qui sont dnotes par l'exercice des fonctions (3). A ces deux formes d'investigation, Pinel adresse le mme reproche: elles sont illimites. A la premire, il objecte: Au milieu de cette profusion de questions... comment saisir les caractres essentiels et spcifiques de la maladie? et la seconde, d'une faon symtrique: Quelle numration immense de symptmes...! N'est-ce point nous rejeter dans un nouveau chaos? (4). Les questions (1) MAYGRIER, Guide de l'tudiant en mdecine (Paris, 1818), pp. 9495.
(2) Ph. PINEL, Mdecine clinique, p. 4. (3) Ibid., p. 3. (4) Ibid., pp. 5 et 3. |PAGE 112 poser sont innombrables; les choses voir infinies. S'il n'est ouvert qu'aux tches du langage, ou qu'aux exigences du regard le domaine clinique n'a pas de clture, et par consquent, pas d'organisation. Il n'a de limite, de forme et de sens que si l'interrogation et l'examen s'articulent l'un sur l'autre, dfinissant au niveau d'un code qui leur est commun le lieu de rencontre du mdecin et du malade. Ce lieu, la clinique en sa forme initiale cherche le dterminer par trois moyens: 1. L'alternance des moments parls et des moments perus dans une observation.- Dans le schma de l'enqute idale dessin par Pinel, l'indice gnral du premier moment est visuel: on observe l'tat actuel dans ses manifestations. Mais, l'intrieur de cet examen, le questionnaire assure dj la place du langage; on note les symptmes qui frappent d'emble les sens de l'observateur ; mais aussitt aprs, on interroge le malade sur les douleurs qu'il prouve, enfin -forme mixte du peru et du parl, de' la question et de l'observation -on constate l'tat des grandes fonctions physiologiques connues. Le second moment est plac sous le signe du langage et aussi du temps, de la remmoration, des dveloppements et des incidences successives. Il s'agit d'abord de dire ce qui a t, un moment donn, perceptible (rappeler les formes de l'invasion, la suite des symptmes, l'apparition de leurs caractres actuels et les mdications dj appliques) ; puis, il faut interroger le malade ou son entourage sur son habitus, sa profession, sa vie passe. Le troisime moment de l'observation est nouveau un moment peru; on rend compte jour aprs jour du progrs de la maladie sous quatre rubriques: volution des symptmes, apparition ventuelle de nouveaux phnomnes, tat des scrtions, effet des mdicaments employs. Enfin, dernier temps, celui rserv la parole: prescription du rgime pour la convalescence (1). En cas de dcs, la plupart des cliniciens -mais Pinel moins volontiers que les autres, et nous verrons pourquoi -rservait au regard la dernire et la plus dcisive instance: l'anatomie du corps. Dans ce battement rgulier de la parole et du regard, la maladie peu peu prononce sa vrit, vrit qu'elle donne voir et entendre, et dont le texte, qui pourtant n'a qu'un sens, ne peut tre restitu, en sa totalit indubitable, que par deux sens: celui qui regarde et celui qui coute. C'est pourquoi le questionnaire sans l'examen, ou l'examen sans l'interrogation
(1) Ph. PINEL, ibid., p. 57. |PAGE 113 taient vous une tche infinie: il n'appartient aucun des deux de combler les lacunes qui ne relvent que de l'autre. 2. L'effort pour dfinir une forme statuaire de corrlation entre le regard et le langage. -Le problme thorique et pratique qui s'est pos aux cliniciens a t de savoir s'il serait possible de faire entrer dans une reprsentation spatiale ment lisible et conceptuelle ment cohrente, ce qui, de la maladie, relve d'une symptomatologie visible, et ce qui relve d'une analyse verbale. Ce problme s'est manifest dans une difficult technique trs rvlatrice des exigences de la pense clinique: le tableau. Est-il possible d'intgrer dans un tableau, c'est--dire dans une structure la fois visible et lisible, spatiale et verbale, ce qui est peru la surface du corps par l'oeil du clinicien, et ce qui est entendu par ce mme clinicien du langage essentiel de la maladie? L'essai, le plus naf sans doute, est celui de Fordyce : en abscisse, il portait toutes les notations concernant le climat, les saisons, les maladies rgnantes, le temprament du malade, l'idiosyncrasie, son habitus, son ge et les accidents antcdents; en ordonne, il indiquait les symptmes selon l'organe ou la fonction qui les manifestait (pouls, peau, temprature, muscles, yeux, langue, bouche, respiration, estomac, intestin, urines) (1). Il est clair que cette distinction fonctionnelle entre le visible et l'nonable, puis leur corrlation dans le mythe d'une gomtrie analytique ne pouvait tre d'aucune efficacit dans le travail de la pense clinique; un pareil effort est significatif seulement des donnes du problme et des termes qu'il s'agissait de mettre en corrlation. Les tableaux dresss par Pinel sont apparemment plus simples: leur structure conceptuelle est en fait plus subtile. Ce qui est port en ordonne, ce sont comme chez Fordyce les lments symptomatiques que la maladie offre la perception; mais en abscisse, il indique les valeurs significatives que ces symptmes peuvent prendre: ainsi dans une fivre aigu, une sensibilit douloureuse l'pigastre, une migraine, une soif violente sont mettre au compte d'une symptomatologie gastrique; en revanche, la prostration, la tension abdominale ont un sens adynamique; enfin, la douleur dans les membres, la langue aride, la respiration frquente, un paroxysme se produisant surtout le soir sont des signes la fois de gastricit et d'adynamisme (2). Chaque segment visible (1) FORDYCE, Essai dun nouveau plan d'observations mdicales (trad. fr., Paris, 1811). (2) Ph. PINEL, Mdecine clinique, p. 78.
|PAGE 114 prend ainsi une valeur significative et le tableau a bien, dans la connaissance clinique, une fonction d'analyse. Mais il est vident que la structure analytique n'est pas donne ni rvle par le tableau luimme; elle lui tait antrieure et la corrlation entre chaque symptme et sa valeur symptomatologique a t fixe une fois pour toutes dans un a priori essentiel; sous sa fonction apparemment analytique, le tableau n'a pour rle que de rpartir le visible l'intrieur d'une configuration conceptuelle dj donne. Le travail n'est donc pas de mise en corrlation, mais de pure et simple redistribution de ce qui tait donn par une tendue perceptible dans un espace conceptuel dfini l'avance. Il ne fait rien connatre; il permet tout au plus de reconnatre. 3. L'idal d'une description exhaustive.- L'allure arbitraire ou tautologique de ces tableaux entrane la pense clinique vers une autre forme de corrlation entre le visible et l'nonable; c'est la corrlation continue d'une description entirement, c'est--dire doublement fidle: par rapport son objet elle doit tre en effet sans lacune; et dans le langage o elle le transcrit elle ne doit se permettre aucune dviation. La rigueur descriptive sera la rsultante d'une exactitude dans l'nonc, et d'une rgularit dans la dnomination: ce qui est, selon Pinel, la mthode suivie maintenant dans toutes les autres parties de l'histoire naturelle (1). Ainsi le langage se trouve charg d'une double fonction: par sa valeur d'exactitude, il tablit une corrlation entre chaque secteur du visible et un lment nonable qui lui correspond au plus juste; mais cet lment nonable, l'intrieur de son rle de description, fait jouer une fonction dnominatrice qui, par son articulation sur un vocabulaire constant et fixe, autorise la comparaison, la gnralisation et la mise en place l'intrieur d'un ensemble. Grce cette double fonction, le travail de description assure une sage rserve pour s'lever des vues gnrales sans donner de la ralit des termes abstraits, et une distribution simple, rgulire et fonde invariablement sur des rapports de structures ou de fonctions organiques des parties (2). C'est dans ce passage, exhaustif et sans rsidu, de la totalit du visible la structure d'ensemble de l'nonable que s'accomplit enfin cette analyse significative du peru que l'architecture navement gomtrique du tableau ne parvenait pas assurer. (1) Ph. PINEL, Nosographie philosophique, Introd., p. III. (2) Ibid., pp. III-IV. |PAGE 115
C'est la description, ou plutt le labeur implicite du langage dans la description qui autorise la transformation du symptme en signe, le passage du malade la maladie, l'accs de l'individuel, au conceptuel. Et c'est l que se noue, par les vertus spontanes de la description, le lien entre le champ alatoire des vnements pathologiques et le domaine pdagogique o ils formulent l'ordre de leur vrit. Dcrire, c'est suivre l'ordonnance des manifestations, mais c'est suivre aussi la squence intelligible de leur gense; c'est voir et savoir en mme temps, parce qu'en disant ce qu'on voit, on l'intgre spontanment au savoir; c'est aussi apprendre voir puisque c'est donner la clef d'un langage qui matrise le visible. La langue bien faite, en laquelle Condillac et ses successeurs voyaient l'idal de la connaissance scientifique, ne doit donc pas tre cherche comme l'ont fait avec trop de hte certains mdecins (1) du ct d'une langue des calculs; mais du ct de cette langue mesure qui est la fois la mesure des choses qu'elle dcrit et du langage dans lequel elle les dcrit. Il faut donc substituer au rve d'une structure arithmtique du langage mdical, la recherche d'une certaine mesure interne faite de fidlit et de fixit, d'ouverture premire et absolue sur les choses et de rigueur dans l'usage rflchi des valeurs smantiques. L'art de dcrire les faits est le suprme art en mdecine: tout plit devant lui (2). Au-dessus de tous ces efforts de la pense clinique pour dfinir ses mthodes et ses normes scientifiques, plane le grand mythe d'un pur Regard qui serait pur Langage: oeil qui parlerait. Il se porterait sur la totalit du champ hospitalier, accueillant et recueillant chacun des vnements singuliers qui se produisent en lui; et mesure qu'il verrait, qu'il verrait plus et mieux, il se ferait parole qui nonce et enseigne; la vrit que les vnements par leurs rptitions et leur convergence dessineraient sous son regard, serait, par ce mme regard et dans leur ordre mme, rserve sous forme d'enseignement ceux qui ne savent pas et n'ont pas encore vu. Cet oeil qui parle serait le serviteur des choses et le matre de la vrit. On comprend comment, autour de ces thmes, un certain sotrisme mdical a pu se reconstituer aprs le rve rvolutionnaire d'une science et d'une pratique absolument ouvertes: on ne voit dsormais le visible que parce qu'on connat le Langage; les choses sont offertes celui qui a pntr dans le (1) Cf. supra, chap. VI. (2) AMARD, Association intellectuelle (Paris, 1821), t. I, p. 64. |PAGE 116
monde clos des mots; et si ces mots communiquent avec les choses, c'est qu'ils obissent une rgle qui est intrinsque leur grammaire. Ce nouvel sotrisme est diffrent dans sa structure, son sens et son usage de celui qui faisait parler latin aux mdecins de Molire: alors, il s'agissait seulement de n'tre pas compris et de maintenir au niveau des recettes du langage les privilges corporatifs d'une profession; maintenant on cherche acqurir une matrise opratoire sur les choses par un juste usage syntactique et une difficile familiarit smantique du langage. La description, dans la mdecine clinique, n'a pas pour sens de mettre le cach ou l'invisible la porte de ceux qui n'y ont pas accs; mais de faire parler ce que tout le monde voit sans le voir, et de le faire parler aux seuls qui soient initis la vraie parole. Quelques prceptes que l'on donne sur une matire aussi dlicate, elle restera toujours au-dessus de la porte de la multitude (1). Nous retrouvons l, au niveau des structures thoriques, ce thme initiatique dont le dessin se trouve dj dans les configurations institutionnelles de la mme poque (2) : nous sommes au coeur de l'exprience clinique -forme de manifestation des choses dans leur vrit, forme d'initiation la vrit des choses; c'est ce que Bouillaud noncera comme banalit d'vidence une quarantaine d'annes aprs '.La clinique mdicale peut tre considre soit comme science, soit comme mode d'enseignement de la mdecine (3), Un regard qui coute et un regard qui parle: l'exprience clinique reprsente un moment d'quilibre entre la parole et le spectacle. Equilibre prcaire, car il repose sur un formidable postulat: que tout le visible est nonable et qu'il est tout entier visible parce que tout entier nonable. Mais la rversibilit sans rsidu du visible dans l'nonable est reste dans la clinique une exigence et une limite plutt qu'un principe originaire. La descriptibilit totale est un horizon prsent et recul; c'est le rve d'une pense, beaucoup plus qu'une structure conceptuelle de base. Il y a cela une raison historique simple: c'est que la logique (1) AMARD, Association intellectuelle, I, p. 65. (2) Cf. supra, chap. V. (3) BOUILLAUD, Philosophie mdicale (Paris, 1831), p. 244. |PAGE 117 de Condillac qui servait de modle pistmologique la clinique ne permettait pas une science o le visible et le dicible fussent pris dans une totale adquation. La philosophie de Condillac a t peu peu dcale d'une analyse de l'impression originaire une logique opratoire des signes, puis de cette logique la constitution d'un
savoir qui serait la fois langue et calcul: utilise ces trois niveaux et chaque fois avec des sens diffrents, la notion d'lment assurait tout au long de cette rflexion une continuit ambigu, mais sans structure logique dfinie et cohrente; Condillac n'a jamais dgag une thorie universelle de l'lment -que cet lment soit perceptif, linguistique ou calculable; il a hsit sans cesse entre deux logiques des oprations : celle de la gense et celle du calcul. D'o la double dfinition de l'analyse: rduire les ides complexes aux ides simples dont elles ont t composes et suivre le progrs de leur gnration (1) ; et chercher la vrit par une espce de calcul, c'est--dire en composant et en dcomposant les notions pour les comparer de la manire la plus favorable aux dcouvertes qu'on a en vue (2). Cette ambigut a pes sur la mthode clinique, mais celle-ci a jou selon une pente conceptuelle qui est oppose exactement l'volution de Condillac: renversement terme terme du point d'origine et point d'achvement. Elle redescend de l'exigence du calcul au primat de la gense, c'est-dire qu'aprs avoir cherch dfinir le postulat d'adquation du visible l'nonable par une calculabilit universelle et rigoureuse, elle lui donne le sens d'une descriptibilit totale et exhaustive. L'opration essentielle n'est plus de l'ordre de la combinatoire, mais rie l'ordre de la transcription syntactique. ,De ce mouvement qui reprend, en sens inverse, toute la dmarche de Condillac, rien ne tmoigne mieux que la pense de Cabanis si on la compare l'analyse de Brulley. Celui-ci veutconsidrer la certitude comme un tout divisible en autant de probabilits qu'on voudra ; une probabilit est donc un degr, une partie de la certitude dont elle diffre comme la partie diffre du tout (3) ; la certitude mdicale doit donc s'obtenir par une combinatoire des probabilits; aprs en avoir donn les rgles, Brulley annonce qu'il n'ira pas plus avant, un mdecin plus clbre devant apporter sur ce sujet des lumires que lui-mme (1) CONDILLAC, Origine des connaissances humaines, p. 162. (2) Ibid., p. 110. (3) C.-A. BRULLEY, Essai sur l'art de conjecturer en mdecine, pp. 2627. |PAGE 118 serait bien en peine de donner (1). Selon toute vraisemblance, c'est de Cabanis qu'il s'agit. Or, dans les Rvolutions de la mdecine, la forme certaine de la science n'est pas dfinie par un type de calcul,
mais par une organisation dont les valeurs sont essentiellement expressives; il ne s'agit plus d'tablir un calcul pour aller du probable au certain, mais de fixer une syntaxe pour aller de l'lment peru la cohrence du discours: La partie thorique d'une science doit donc tre le simple nonc de l'enchanement de la classification et des rapports de tous les faits dont cette science se compose; elle en doit tre, pour ainsi dire, l'expression sommaire (2). Et si Cabanis fait place au calcul des probabilits dans l'dification de la mdecine, c'est seulement titre d'lment, parmi d'autres, dans la construction totale du discours scientifique. Brulley cherchait se situer au niveau de la Langue des calculs; Cabanis a beau citer ce dernier texte, sa pense est pistmologiquement de plain-pied avec l'Essai sur l'origine des connaissances. On pourrait penser -et tous les cliniciens de cette gnration l'ont cru -que les choses en resteraient l et qu' ce niveau un quilibre sans problme tait possible entre les formes de composition du visible et les rgles syntactiques de l'nonable. Brve priode d'euphorie, ge d'or sans lendemain o voir, dire et apprendre voir en disant ce qu'on voit communiquaient dans une transparence immdiate: l'exprience tait de plein droit science; et le connatre marchait du mme pas que l' apprendre. Le regard lisait souverainement un texte dont il recueillait sans effort la claire parole pour la restituer en un discours second et identique: donne par le visible, cette parole, sans rien changer, donnait voir. Le regard reprenait en son exercice souverain les structures de visibilit qu'il avait lui-mme dposes dans son champ de perception. Mais cette forme gnralise de la transparence laisse opaque le statut du langage, ou du moins du systme d'lments qui doit en tre la fois le fondement, la justification et l'instrument dli. Une telle carence, qui est en mme temps celle de la Logique de Condillac, ouvre le champ un certain nombre de mythes pistmologiques qui la masquent. Mais dj ils guident la clinique dans de nouveaux espaces, o la visibilit s'paissit, se trouble, o le regard se heurte des masses obscures, d'impntrables volumes, la pierre noire du corps. (1) BRULLEY, ibid. (2) CABANIS, Coup d'oeil sur les Rvolutions et la rforme de la mdecine (Paris, 1804), p. 271. |PAGE 119 1. Le premier de ces mythes pistmologiques concerne la structure alphabtique de la maladie. -A la fin du XVIIIe sicle, l'alphabet apparaissait aux grammairiens comme le schma idal de l'analyse
et la forme dernire de la dcomposition d'une langue; il constituait par l mme le chemin d'apprentissage de cette langue. Cette image alphabtique s'est transpose sans modification essentielle dans la dfinition du regard clinique. Le segment observable le plus petit possible, celui dont il faut bien partir et au-del duquel on ne peut pas remonter, c'est l'impression singulire qu'on reoit d'un malade, ou plutt d'un symptme chez un malade; il ne signifie rien par luimme, mais prendra sens et valeur, se mettra parler, s'il entre en composition avec d'autres lments: Les observations particulires, isoles, sont la science ce que les lettres et les mots sont au discours; celui-ci ne se fonde que du concours et de la runion des lettres et des mots dont il faut avoir tudi et mdit le mcanisme et la valeur avant d'en faire un bon et utile emploi; il en est de mme des observations (1). Cette structure alphabtique de la maladie ne garantit pas seulement qu'on puisse toujours remonter l'indpassable lment: elle assure aussi que le nombre de ces lments sera fini et mme restreint. Ce qui est divers et apparemment infini, ce ne sont pas les impressions premires mais leur combinaison l'intrieur d'une seule et mme maladie: de mme que le petit nombre de modifications dsignes par les grammairiens sous le nom de consonnes suffit donner l'expression du sentiment la prcision de la pense, de mme, pour les phnomnes pathologiques, chaque cas nouveau, on croirait que ce sont de nouveaux faits mais ce ne sont que d'autres combinaisons. Dans l'tat pathologique, il n'y a jamais qu'un petit nombre de phnomnes principaux... L'ordre dans lequel ils paraissent, leur importance, leurs rapports divers suffisent pour donner naissance toutes les varits de maladies (2). 2. Le regard clinique opre sur l'tre de la maladie une rduction nominaliste. -Composes de lettres, les maladies n'ont pas d'autre ralit que l'ordre de leur composition. Leurs varits renvoient en dernire analyse ces quelques individus simples, et tout ce qui peut se btir avec eux et au-dessus d'eux n'est que Nom. Et nom en un double sens: au sens dont usent les nominalistes quand ils critiquent la ralit substantielle des (1) F.-J. DOUBLE, Smiologie gnrale (Paris, 1811), t. I, p. 79. (2) CABANIS, Du degr de certitude (3e d., Paris, 1819), p. 86. |PAGE 120 tres abstraits et gnraux; et en un autre sens, plus proche d'une philosophie du langage, puisque la forme de composition' de l'tre de la maladie est de type linguistique. Par rapport l'tre individuel et concret, la maladie n'est qu'un nom; par rapport aux lments isols
dont elle est constitue, elle a toute l'architecture rigoureuse d'une dsignation verbale. Demander ce que c'est que l'essence d'une maladie, c'est comme si vous demandiez quelle est la nature de l'essence d'un mot (1). Un homme tousse; il crache du sang; il respire avec difficult; son pouls est rapide et dur; sa temprature s'lve: autant d'impressions immdiates, autant de lettres, pour ainsi dire. Toutes runies, elles forment une maladie, la pleursie: Mais qu'est-ce donc qu'une pleursie ?.. C'est le concours de ces accidents qui la constituent. Le mot pleursie ne fait que les retracer d'une manire plus abrge. La pleursie n'emporte pas avec soi plus d'tre que le mot lui-mme; elle exprime une abstraction de l'esprit ; mais, comme le mot, elle est une structure bien dfinie, une figure multiple dans laquelle tous ou presque tous les accidents se trouvent combins. S'il en manque un ou plusieurs, ce n'est point la pleursie, du moins la vraie pleursie (2). La maladie, comme le nom, est prive d'tre, mais, comme le mot, elle est doue d'une configuration. La rduction nominaliste de l'existence libre une vrit constante. C'est pourquoi: 3. Le regard clinique opre sur les phnomnes pathologiques une rduction de type chimique. -Le regard des nosographes, jusqu' la fin du XVIIIe sicle, tait un regard de jardinier; il fallait reconnatre dans la varit des apparences l'essence spcifique. Au dbut du XIXe sicle, un autre modle s'impose: celui de l'opration chimique, qui en isolant les lments composants permet de dfinir la composition, d'tablir les points communs, les ressemblances et les diffrences avec les autres ensembles, et de fonder ainsi une classification qui ne se fonde plus sur des types spcifiques, mais sur des formes de rapports: Au lieu de suivre l'exemple des botanistes, les nosologistes n'auraient-ils pas d prendre plutt pour modle les systmes des chimistes-minralogistes, c'est--dire se contenter de classer les lments des maladies et leurs combinaisons les plus frquentes? (3). La notion d'analyse laquelle nous avons dj (1)Ibid., p. 66. (2) Ibid., p. 66. (3) DEMORCY-DELETTRE, Essai sur l'analyse applique au perfonctionnement de la mdecine, p. 135. |PAGE 121 reconnu, applique la clinique, un sens quasi linguistique et un sens quasi mathmatique (1), va maintenant s'approcher d'une signification chimique: elle aura pour horizon l'isolement des corps purs, et la mise en tableau de leurs combinaisons. On est pass du thme de la combinatoire celui de la syntaxe, enfin celui de la combinaison.
Et, par rciprocit, le regard du clinicien devient l'quivalent fonctionnel du feu des combustions chimiques; c'est par lui que la puret essentielle des phnomnes peut se dgager: il est l'agent sparateur des vrits. Et tout comme les combustions ne disent leur secret que dans la vivacit mme du feu, et qu'il serait vain d'interroger, une fois la flamme teinte, ce qui peut rester de poudres inertes, le caput mortuum, de mme c'est dans l'acte de voix et la vive clart qu'il rpand sur les phnomnes que la vrit se rvle: Ce n'est point le reliquat de la combustion morbide qu'il importe au mdecin de savoir; c'est l'espce de la combustion (2). Le regard clinique est un regard qui brle les choses jusqu' leur extrme vrit. L'attention par laquelle il observe, et le mouvement par lequel il nonce, sont en fin de compte repris dans cet acte paradoxal qui consume. La ralit dont il lit spontanment le discours pour le restituer tel qu'il est, cette ralit n'est pas aussi adquate ellemme qu'on pouvait le supposer: sa vrit se donne dans une dcomposition qui est bien plus qu'une lecture puisqu'il s'agit de la libration d'une structure implicite. On voit ds maintenant que la clinique n'a plus simplement lire le visible; elle a dcouvrir des secrets. 4. L'exprience clinique s'identifie une belle sensibilit. Le regard mdical n'est pas celui d'un oeil intellectuel capable, sous les phnomnes, de percevoir la puret non modifiable des essences. C'est un regard de la sensibilit concrte, un regard qui va de corps en corps, et dont tout le trajet se situe dans l'espace de la manifestation sensible. Toute vrit pour la clinique est vrit sensible; la thorie se tait ou s'vanouit presque toujours au lit des malades pour cder la place l'observation et l'exprience; h ! sur quoi se fondent l'exprience et l'observation si ce n'est sur le rapport de nos sens? Et que seraient l'une et l'autre sans ces guides fidles? (3). Et si cette connaissance, au niveau de l'usage immdiat des sens, n'est pas (1) Cf. supra, chap. VI. (2) AMARD, Association intellectuelle, t. II, p. 389. (3) CORVISART, prface la traduction d'AUENBRUGGER, Nouvelle mthode pour reconnatre les maladies internes de la poitrine (Paris, 1808), p. VII. |PAGE 122 donne d'emble, si elle peut acqurir profondeur et matrise, ce n'est pas par une dnivellation qui lui permettrait d'accder autre chose qu'elle-mme; c'est grce une souverainet tout intrieure son propre domaine; elle ne s'approfondit jamais qu' son niveau, qui
est celui de la sensorialit pure; car le sens ne nat jamais que du sens. Qu'est-ce donc que le coup d'oeil du mdecin qui l'emporte si souvent sur la plus vaste rudition et sur la plus solide instruction, sinon le rsultat du frquent, mthodique et juste exercice des sens, d'o drivent cette facilit dans l'application, cette prestesse dans le rapport, cette sret si rapide quelquefois dans le jugement que tous les actes semblent simultans et dont on comprend l'ensemble sous le nom de tact? (1). Ainsi, cette sensorialit du savoir qui implique pourtant la conjonction d'un domaine hospitalier et d'un domaine pdagogique, la dfinition d'un champ de probabilit et d'une structure linguistique du rel, se resserre en un loge de l'immdiate sensibilit. Toute la dimension de l'analyse se dploie au seul niveau d'une esthtique. Mais cette esthtique ne dfinit pas seulement la forme originaire de toute vrit; elle prescrit en mme temps des rgles d'exercice; et elle devient, un second niveau, esthtique en ce sens qu'elle prescrit les normes d'un art. La vrit sensible est ouverte maintenant, plus qu'aux sens eux-mmes, une belle sensibilit. Toute la structure complexe de la clinique se rsume et s'accomplit en la rapidit prestigieuse d'un art: En mdecine tout ou presque tout dpendant d'un coup d'oeil ou d'un heureux instinct, les certitudes se trouvent plutt dans les sensations mmes de l'artiste que dans les principes de l'art (2). L'armature technique du regard mdical se mtamorphose en conseils de prudence, de got, d 'habilet : il faut une grande sagacit, une grande attention, une grande exactitude, une grande adresse, une grande patience (3). A ce niveau, toutes les rgles sont suspendues ou plutt, celles qui constituaient l'essence du regard clinique, se substituent peu peu et dans un dsordre apparent celles qui vont constituer le coup d'oeil. Et elles sont fort diffrentes. Le regard en effet implique un champ ouvert, et son activit essentielle est de l'ordre successif de la lecture: il enregistre et totalise; il reconstitue peu peu les organisations immanentes; (1) CORVISART, ibid., p. X. (2) CABANIS, Du degr de certitude (3e d., 1819), p. 126. (3) ROUCHER-DERATTE, Leons sur l'art d'observer (Paris, 1807), pp. 87-99. |PAGE 123 il s'tale dans un monde qui est dj le monde du langage, et c'est pourquoi il s'apparente spontanment l'audition et la parole; il forme comme l'articulation privilgie des deux aspects fondamentaux du Dire (ce qui est dit et ce qu'on dit). Le coup d'oeil,
lui, ne survole pas un champ: il frappe en un point, qui a le privilge d'tre le point central ou dcisif; le regard est indfiniment modul, le coup d'oeil va droit: il choisit, et la ligne qu'il trace d'un trait opre, en un instant, le partage de l'essentiel; il va donc au-del de ce qu'il voit; les formes immdiates du sensible ne le trompent pas; car il sait les traverser; il est par essence dmystificateur. S'il frappe en sa rectitude violente, c'est pour briser, c'est pour soulever, c'est pour dcoller l'apparence. Il ne s'embarrasse pas de tous les abus du langage. Le coup d'oeil est muet comme un doigt point, et qui dnonce. Le coup d'oeil est de l'ordre non verbal du contact, contact purement idal sans doute, mais plus percutant au fond parce qu'il traverse mieux et va plus loin sous les choses. L'oeil clinique se dcouvre une parent avec un nouveau sens qui lui prescrit sa norme et sa structure pistmologique ; ce n'est plus l'oreille tendue vers un langage, c'est l'index qui palpe les profondeurs. D'o cette mtaphore du tact par laquelle sans cesse les mdecins vont dfinir ce qu'est leur coup d'oeil (1). Et dans cette nouvelle image qu'elle se donne d'elle-mme, l'exprience clinique s'arme pour explorer un nouvel espace: l'espace tangible du corps, qui est en mme temps cette masse opaque o se cachent des secrets, d'invisibles lsions et le mystre mme des origines. Et la mdecine des symptmes, peu peu, entrera en rgression, pour se dissiper devant celle des organes, du foyer, et des causes, devant une clinique tout entire ordonne l'anatomie pathologique. C'est l'ge de Bichat. (1) CORVISART, texte cit plus haut p. 122. |PAGE 125 CHAPITRE VIII Ouvrez Quelques Cadavres Trs tt, les historiens ont rattach le nouvel esprit mdical la dcouverte de l'anatomie pathologique; elle paraissait le dfinir pour l'essentiel, le porter et le recouvrir, en former la fois l'expression la plus vive et la plus profonde raison; les mthodes de l'analyse, l'examen clinique, et jusqu' la rorganisation des coles et des hpitaux semblaient lui emprunter leur signification. Une poque toute nouvelle pour la mdecine vient de commencer en France... ; l'analyse applique l'tude des phnomnes physiologiques, un got clair pour les crits de l'Antiquit, la runion de la mdecine et de la chirurgie, l'organisation des coles cliniques ont opr cette
tonnante rvolution caractrise par les progrs de l'anatomie pathologique (1). Celle-ci recevait le curieux privilge de venir, au dernier moment du savoir, donner les principes premiers de sa positivit. Pourquoi cette inversion chronologique? Pourquoi le temps aurait-il dpos au terme du parcours ce qui tait contenu au dpart, ouvrant le chemin et le justifiant dj? Pendant 150 ans, on a rpt la mme explication: la mdecine n'a pu trouver accs ce qui la fondait scientifiquement, qu'en faisant, avec lenteur et prudence, le tour d'un obstacle majeur, celui que la religion, la morale et d'obtus prjugs opposaient l'ouverture des cadavres. L'anatomie pathologique n'a vcu que d'une vie de pnombre, aux frontires de l'interdit, et grce ce courage des savoirs clandestins qui endurent la maldiction; on ne dissquait qu' la faveur de douteux crpuscules, dans la grande peur des morts: au point du jour, aux approches de la nuit, Valsalva se (1) P. RAYER, Sommaire d'une histoire abrge de l'anatomie pathologique (Paris, 1818), introd., p. V. |PAGE 126 glissait furtivement dans les cimetires, pour y tudier loisir les progrs de la vie et de la destruction ; on vit son tour Morgagni fouiller la tombe des morts et plonger son scalpel dans des cadavres drobs au cercueil (1). Puis vinrent les Lumires; la mort eut droit la clart et devint pour l'esprit philosophique objet et source de savoir: Lorsque la philosophie introduisit son flambeau au milieu des peuples civiliss, il fut enfin permis de porter un regard scrutateur dans les restes inanims du corps humain, et ces dbris, nagure la vile proie des vers, devinrent la source fconde des vrits les plus utiles (2). Belle transmutation du cadavre: un respect terne le condamnait la pourriture, au travail noir de la destruction; dans la hardiesse du geste qui ne viole que pour mettre jour, le cadavre devient le plus clair moment dans les figures de la vrit. Le savoir file o se formait la larve. Cette reconstitution est historiquement fausse. Morgagni, au milieu du XVIIIe sicle, n'a pas eu de difficult faire ses autopsies; Hunter non plus, quelques annes plus tard; les conflits raconts par son biographe sont de l'ordre de l'anecdote et n'indiquent aucune opposition de principe (3). La clinique de Vienne, depuis 1754, comportait une salle de dissection, comme celle de Pavie que Tissot organise; Desault, l'Htel-Dieu, peut librement dmontrer sur le corps priv de vie les altrations qui avaient rendu l'art inutile (4). Qu'il suffise de rappeler l'article 25 du dcret de Marly: Enjoignons
aux magistrats et aux directeurs des hpitaux de fournir les cadavres aux professeurs pour faire les dmonstrations d'anatomie, et pour enseigner les oprations de chirurgie (5). Donc, point de pnurie de cadavres au XVIIIe sicle, pas de spultures violes ni de messes noires anatomiques; on est dans le plein jour de la dissection. Par une illusion frquente au XIXe sicle, et laquelle Michelet a impos les dimensions d'un mythe, l'histoire la fin de l'Ancien Rgime les couleurs du Moyen Age en ses dernires annes, confondu avec les dchirements de la Renaissance les problmes et les dbats de l'Aufklrung. Dans l'histoire de la mdecine, cette illusion a un sens prcis; elle fonctionne comme justification rtrospective: si les vieilles croyances ont eu, si longtemps, un tel pouvoir d'interdiction, (1) ROSTAN, Trait lmentaire de diagnostic, de pronostic, d'indications thrapeutiques (Paris, 1826), t. I, p. 8. (2) J.-L. ALIBERT, Nosologie naturelle (Paris, 1817), Prliminaire, I, p. LVI. (3) Cf. l'histoire de l'autopsie du gant, in DOTTLEY, Vie de John Hunter, in Oeuvres compltes de J. HUNTER (trad. fr., Paris, 1839), t. I., p. 126. (4) M.-A. PETIT ,Eloge de Desault (1795), in Mdecine du coeur, p. 108. (5) Cf. GILIBERT, loc. cit., p. 100. |PAGE 127 c'est que les mdecins devaient prouver, du fond de leur apptit scientifique, le besoin refoul d'ouvrir des cadavres. L est le point de l'erreur, et la raison silencieuse qui l'a fait, si constamment, commettre: du jour o il fut admis que les lsions expliquaient les symptmes, et que l'anatomie pathologique fondait la clinique, il fallut bien convoquer une histoire transfigure, o l'ouverture des cadavres, au moins titre d'exigence scientifique, prcdait l'observation, enfin positive, des malades; le besoin de connatre le mort devait exister dj quand apparaissait le souci de comprendre le vif. De toutes pices, on a donc imagin une conjuration noire de la dissection, une glise de l'anatomie militante et souffrante, dont l'esprit cach aurait permis la clinique avant de faire surface luimme dans la pratique rgulire, autorise et diurne de l'autopsie. Mais la chronologie n'est pas ployable : Morgagni publie son De sedibus en 1760, et par l'intermdiaire du Sepulchretum de Bonet, se situe dans la grande filiation de Valsalva ; Lieutaud en donne un rsum en 1767. Le cadavre fait partie, sans contestation religieuse ni morale, du champ mdical. Or, Bichat et ses contemporains ont le
sentiment, quarante ans plus tard, de redcouvrir l'anatomie pathologique par-del une zone d'ombre. Un temps de latence spare le texte de Morgagni, comme la dcouverte d'Auenbrugger, de leur utilisation par Bichat et par Corvisart: quarante annes qui sont celles o s'est forme la mthode clinique. C'est l, non dans les vieilles hantises, que gt le point de refoulement: la clinique, regard neutre pos sur les manifestations, les frquences et les chronologies, proccupe dapparenter les symptmes et den saisir le langage, tait, par sa structure, trangre cette investigation des corps muets et intemporels; les causes ou les siges la laissaient indiffrente: histoire, non pas gographie. Anatomie et clinique ne sont pas de mme esprit: aussi trange que cela puisse paratre maintenant quest tablie et enfonce loin dans le temps la cohrence anatomo-clinique, cest une pense clinicienne qui pendant quarante ans a empch la mdecine dentendre la leon de Morgagni. Le conflit nest pas entre un jeune savoir et de vieilles croyances, mais entre deux figures du savoir. Pour que, de lintrieur de la clinique se dessine et simpose le rappel de lanatomie pathologique, il faudra un mutuel amnagement: ici, l'apparition de nouvelles lignes gographiques, et l une nouvelle faon de lire le temps. Aux termes de cette litigieuse structuration, la connaissance de la vive et douteuse maladie pourra s'aligner sur la blanche visibilit des morts. |PAGE 128 Rouvrir Morgagni ne signifiait pas cependant pour Bichat rompre avec l'exprience clinique qu'on venait d'acqurir. Au contraire, la fidlit la mthode des cliniciens demeure l'essentiel, et mme au-del d'elle, le souci, qu'il partage avec Pinel, de donner fondement il une classification nosologique. Paradoxalement le retour aux question du De sedibus se fait partir d'un problme de groupement des symptmes et de mise en ordre des maladies. Comme le Sepulchretum et beaucoup de traits du XVIIe et du XVIIIe sicle, les lettres de Morgagni assuraient la spcification des maladies par une rpartition locale de leurs symptmes ou de leur point d'origine; la dispersion anatomique tait le principe directeur de l'analyse nosologique : la frnsie appartenait, comme l'apoplexie, aux maladies de la tte; asthme, pri pneumonie et hmoptysie formaient des espces proches parce que localises toutes trois dans la poitrine. La parent morbide reposait sur un principe de voisinage organique: l'espace qui la dfinissait tait local. La mdecine des classifications puis la clinique avaient dtach l'analyse pathologique de ce rgionalisme, et constitu pour elle un espace la fois plus
complexe et plus abstrait, o il tait question d'ordre, de successions, de concidences et d'isomorphismes. La dcouverte majeure du Trait des membranes, systmatise ensuite dans l'Anatomie gnrale, c'est un principe de dchiffrement de l'espace corporel qui est la fois intra-organique, inter-organique et trans-organique. L'lment anatomique a cess de dfinir la forme fondamentale de la spatialisation et de commander, par une relation de voisinage, les chemins de la communication physiologique ou pathologique; il n'est plus qu'une forme seconde d'un espace primaire qui, par enroulement, superposition, paississement, le constitue. Cet espace fondamental est tout entier dfini par la minceur du tissu; l'Anatomie gnrale en dnombre 21 : le cellulaire, le nerveux de la vie animale, le nerveux de la vie organique, l'artriel, le veineux, celui des vaisseaux exhalants, celui des absorbants, l'osseux, le mdullaire, le cartilagineux, le fibreux, le fibro-cartilagineux, le musculaire animal, le musculaire, le muqueux, le sreux, le synovial, le glanduleux, le dermode, l'pidermode et le pileux. Les membranes sont des individualits tissulaires qui, malgr leur tnuit souvent extrme, ne se lient que par des rapports |PAGE 129 indirects d'organisation avec les parties voisines (1) ; un regard global les confond souvent avec l'organe qu'elles enveloppent ou dfinissent; on a fait l'anatomie du coeur sans distinguer le pricarde, celle du poumon sans isoler la plvre; on a confondu le pritoine et les organes gastriques (2). Mais on peut et on doit faire l'analyse de ces volumes organiques en surfaces tissulaires si on veut comprendre la complexit du fonctionnement et des altrations: les organes creux sont garnis de membranes muqueuses, couvertes d'un fluide qui en humecte habituellement la surface libre et que fournissent des petites glandes inhrentes leur structure ; le pricarde, la plvre, le pritoine, l'arachnode sont des membranes sreuses caractrises par le fluide lymphatique qui les lubrifie sans cesse et qui est spar par exhalation de la masse de sang ; le prioste, la dure-mre, les aponvroses sont forms partir de membranes qu'aucun fluide n'humecte et que compose une fibre blanche analogue aux tendons (3). A partir des seuls tissus, la nature travaille avec une extrme simplicit de matriaux. Ils sont les lments des organes, mais ils les traversent, les apparentent, et, au-dessus d'eux, constituent de vastes sytmes o le corps humain trouve les formes concrtes de son unit. Il y aura autant de systmes que de tissus: en eux l'individualit complexe, inpuisable des organes, se dissout, et, d'un
coup, se simplifie. Ainsi la nature se montre uniforme partout dans ses procds, variable seulement dans leurs rsultats, avare des moyens qu'elle emploie, prodigue des effets qu'elle obtient, modifiant de mille manires quelques principes gnraux (4). Entre les tissus et les systmes, les organes apparaissent comme de simples replis fonctionnels, entirement relatifs, dans leur rle ou dans leurs troubles, aux lments dont ils sont constitus et aux ensembles dans lesquels ils sont pris. Il faut analyser leur paisseur et la projeter sur deux surfaces: celle, particulire, de leurs membranes, et celle gnrale des systmes. Et, au principe de diversification selon les organes qui commandait l'anatomie de Morgagni et de ses prdcesseurs, Bichat substitue un principe d'isomorphisme des tissus fond sur l'identit simultane de la conformation extrieure, de la structure, des proprits vitales et des fonctions (5). (1) X. BICHAT, Trait des membranes (d. de 1827, avec notes de MAGENDIE), p. 6. (2) Ibid., p. 1. (3) Ibid., pp. 6-8. (4) Ibid., p. 2. (5) Ibid., p. 5. |PAGE 130 Deux perceptions structuralement trs diffrentes: Morgagni veut percevoir sous la surface corporelle les paisseurs des organes dont les figures varies spcifient la maladie; Bichat veut rduire les volumes organiques de grandes surfaces tissulaires homognes, des plages d'identit o les modifications secondaires trouveront leurs parents fondamentales. Bichat impose, dans le Trait des membranes, une lecture diagonale du corps qui se fait selon des nappes de ressemblances anatomiques, qui traversent les organes, les enveloppent, les divisent, les composent et les dcomposent, les analysent et en mme temps les lient. Il s'agit bien du mme mode de perception que celui emprunt par la clinique la philosophie de Condillac: la mise jour d'un lmentaire qui est en mme temps un universel, et une lecture mthodique qui, en parcourant les formes de la dcomposition, dcrit les lois de la composition. Bichat est, au sens strict, un analyste: la rduction du volume organique l'espace tissulaire est probablement, de toutes les applications de l'Analyse, la plus proche du modle mathmatique qu'elle s'tait donn. L 'oeil de Bichat est un oeil de clinicien parce qu'il donne un privilge pistmologique absolu au regard de surface. Le prestige trs tt acquis par le Trait des membranes tient paradoxalement ce qui le spare, pour l'essentiel, de Morgagni, et
le situe dans le droit fil de l'analyse clinique: analyse laquelle il apporte cependant un alourdissement de sens. Regard de surface, celui de Bichat ne l'est pas exactement au sens o l'tait l'exprience clinique. La plage tissulaire n'est plus du tout ce tableau taxinomique o viennent se ranger les vnements pathologiques offerts la perception; elle est un segment d'espace lui-mme perceptible auquel on peut rapporter les phnomnes de la maladie. La superficialit prend corps dsormais grce Bichat dans les surfaces relles des membranes. Les nappes tissulaires forment le corrlat perceptif de ce regard de surface qui dfinissait la clinique. La surface, structure du regardant, est devenue figure du regard, par un dcalage raliste o le positivisme mdical va trouver son origine. D'o l'allure que prit son dpart l'anatomie pathologique: celle d'un fondement enfin objectif, rel et indubitable d'une description des maladies: Une nosographie fonde sur l'affection |PAGE 131 des organes sera ncessairement invariable (1). En effet, l'analyse tissulaire permet d'tablir, au-dessus des rpartitions gographiques de Morgagni, des formes pathologiques gnrales; on verra se dessiner travers l'espace organique de grandes familles de maladies, ayant les mmes symptmes majeurs et le mme type d'volution. Toutes les inflammations des membranes sreuses se reconnaissant leur paississement, la disparition de leur transparence, leur couleur blanchtre, leurs altrations granuleuses, aux adhrences qu'elles forment avec les tissus adjacents. Et de mme que les nosologies traditionnelles commenaient par une dfinition des classes les plus gnrales, l'anatomie pathologique dbutera par une histoire des altrations communes chaque systme quels que soient l'organe ou la rgion affects (2). A l'intrieur de chaque systme, il faudra ensuite restituer l'allure que prennent selon le tissu les phnomnes pathologiques. L'inflammation, qui a la mme structure dans toutes les membranes sreuses, ne les attaque pas toutes avec la mme facilit et ne s'y dveloppe pas selon la mme vitesse: par ordre dcroissant de susceptibilit, on a la plvre, le pritoine, le pricarde, la tunique vaginale et enfin l'arachnode (3). La prsence de tissus de mme texture travers l'organisme permet de lire de maladie maladie des ressemblances, des parents, bref tout un systme de communications qui est inscrit dans la configuration profonde du corps. Cette configuration, non locale, est faite d'un embotement de gnralits concrtes, de tout un systme organis d'implications. Elle a, au fond, la mme armature logique que la pense nosologique.
Et par-del la clinique dont il part et qu'il veut fonder, Bichat retrouve non la gographie des organes, mais l'ordre des classifications. L'anatomie pathologique a t ordinale avant d'tre localisatrice. Elle donnait pourtant l'Analyse une valeur nouvelle et dcisive, montrant, l'inverse des cliniciens, que la maladie n'est l'objet passif et confus auquel il faut l'appliquer que dans la mesure o elle est dj et par elle-mme le sujet actif qui l'exerce impitoyablement sur l'organisme. Si la maladie est analyser, c'est qu'elle est elle-mme analyse; et la dcomposition idologique ne peut tre que la rptition dans la conscience du mdecin de celle qui svit dans le corps du malade. Bien que (1) Anatomie pathologique (Paris, 1825), p. 3. (2) Anatomie gnrale (Paris, 1801), t. I, avant-propos, p. XCVII. (3) Anatomie pathologique, p. 39. |PAGE 132 Van Horne, dans la seconde moiti du XVIIe sicle, les ait distingues, beaucoup d'auteurs, comme Lieutaud, confondaient encore arachnode et pie-mre. L'altration les spare clairement; sous l'effet de l'inflammation, la pie-mre rougit, montrant qu'elle est toute tissue de vaisseaux; elle est alors plus dure et plus sche; l'arachnode devient d'un blanc plus dense, et se couvre d'une exsudation visqueuse; elle seule peut contracter des hydropisies (1). Dans la totalit organique du poumon, la pleursie n'attaque que la plvre; la pripneumonie, le parenchyme; les toux catarrhales, les membranes muqueuses (2). Dupuytren a montr que l'effet des ligatures n'est pas homogne dans toute l'paisseur du canal artriel: ds qu'on serre, les tuniques moyennes et internes cdent et se divisent; seule rsiste la tunique celluleuse, la plus extrieure pourtant, parce que sa structure est plus serre (3). Le principe de l'homognit tissulaire qui assure les types pathologiques gnraux a pour corrlatif un principe de division relle des organes sous l'effet des altrations morbides. L'anatomie de Bichat fait bien plus que de donner un champ d'application objective aux mthodes de l'analyse; il fait de l'analyse un moment essentiel du processus pathologique. Il la ralise l'intrieur de la maladie, dans la trame de son histoire. Rien, en un sens, n'est plus loign du nominalisme implicite de la mthode clinique, o l'analyse portait sinon sur des mots, du moins sur des segments de perception toujours susceptibles d'tre transcrits dans un langage; il s'agit maintenant d'une analyse engage dans une srie de phnomnes rels et jouant de manire dissocier la complexit fonctionnelle en simplicits anatomiques; elle libre des
lments qui pour avoir t isols par abstraction n'en sont pas moins rels et concrets; dans le, coeur, elle fait apparatre le pricarde, dans le cerveau l'arachnode, dans l'appareil intestinal les muqueuses. L'anatomie n'a pu devenir pathologique que dans la mesure o le pathologique anatomise spontanment. La maladie, autopsie dans la nuit du corps, dissection sur le vif. L'enthousiasme que Bichat et ses disciples ont tout de suite ressenti pour la dcouverte de l'anatomie pathologique prend l son sens: ils ne retrouvaient pas Morgagni par-del Pinel ou Cabanis; ils retrouvaient l'analyse dans le corps lui-mme; (1) Traite des membranes, pp. 213-264. (2) Anatomie pathologique, p. 12. (3) Cit in LALLEMAND, Recherches anatomo-pathologiques sur l'encphale (Paris, 1820), t. I, p. 88. |PAGE 133 ils mettaient jour, dans la profondeur des choses, l'ordre des surfaces; ils dfinissaient pour la maladie un systme de classes analytiques o l'lment de la dcomposition pathologique tait principe de gnralisation des espces morbides. On passait d'une perception analytique la perception des analyses relles. Et tout naturellement Bichat a reconnu dans sa dcouverte un vnement symtrique celle de Lavoisier: La chimie a ses corps simples qui forment par les combinaisons diverses dont ils sont susceptibles les corps composs... De mme, l'anatomie a ses tissus simples qui... par leurs combinaisons forment les organes (1). La mthode de la nouvelle anatomie est bien, comme celle de la chimie, l'analyse: mais une analyse dtache de son support linguistique, et dfinissant la divisibilit spatiale des choses plus que la syntaxe verbale des vnements et des phnomnes. D'o la ractivation paradoxale de la pense classificatrice au dbut du XIXe sicle. Loin que l'anatomie pathologique, qui allait en avoir raison quelques annes plus tard, dissipe le vieux projet nosologique, elle lui donne une vigueur nouvelle, dans la mesure o elle semble lui apporter un fondement solide: l'analyse relle selon des surfaces perceptibles. On s'est tonn souvent que Bichat ait cit, au principe de sa dcouverte, un texte de Pinel -Pinel qui jusqu' la fin de sa vie devait rester sourd aux leons essentielles de l'anatomie pathologique. Dans la premire dition de la Nosographie, Bichat avait pu lire cette phrase qui fut pour lui comme un clair: Qu'importe que l'arachnode, la plvre, le pritoine rsident dans diffrentes rgions du corps puisque ces membranes ont des conformits gnrales de
structure? N'prouvent-elles pas des lsions analogues dans l'tat de phlegmasie? (2). C'tait l en effet une des premires dfinitions du principe d'analogie appliqu la pathologie tissulaire; mais la dette de Bichat l'gard de Pinel est plus grande encore, puisqu'il trouvait formules, mais non remplies dans la Nosographie, les exigences auxquelles devait rpondre ce principe d'isomorphisme: celle d'une analyse valeur classificatrice qui permette une mise en ordre gnrale du tableau nosologique. Dans l'ordonnance des maladies, Bichat fait place d'abord aux altrations communes chaque systme, quels que soient l'organe ou la rgion affects; mais il n'accorde cette forme gnrale (1) Anatomie gnrale, t. I, p. LXXIX. (2) PINEL, Nosographie philosophique, I, p. XXVIII. |PAGE 134 qu'aux inflammations et aux squirres; les autres altrations sont rgionales, et doivent tre tudies organe par organe (1). La localisation organique n'intervient qu' titre de mthode rsiduelle l o ne peut jouer la rgle de l'isomorphisme tissulaire; Morgagni n'est rutilis qu' dfaut d'une lecture plus adquate des phnomnes pathologiques. Lannec estime que cette meilleure lecture deviendra possible avec le temps: On pourra prouver un jour que presque tous les modes de lsion peuvent exister dans toutes les parties du corps humain et qu'ils ne prsentent dans chacune d'elles que de lgres modifications (2). Bichat lui-mme n'a peut-tre pas eu assez confiance dans sa dcouverte destine cependant changer la face de l'anatomie pathologique ; il a rserv, pense Lannec, une part trop belle la gographie des organes laquelle il suffit d'avoir recours pour analyser les troubles de forme et de position (luxations, hernies), et les troubles de nutrition, les atrophies et hypertrophies; peut-tre mme un jour pourra-t-on considrer comme de mme famille pathologique les hypertrophies du coeur et celles de l'encphale. En revanche Lannec analyse, sans limites rgionales, les corps trangers et surtout les altrations de texture, qui ont la mme typologie dans tous les ensembles tissulaires: ce sont toujours soit des solutions de continuit (plaies, fractures), soit des accumulations ou extravasations de liquides naturels (tumeurs graisseuses ou apoplexie), soit des inflammations comme dans la pneumonie ou la gastrite, soit enfin des dveloppements accidentels de tissus qui n'existaient pas avant la maladie. C'est le cas des squirres et des tubercules (3). A l'poque de Lannec, Alibert, sur le modle des chimistes, tente d'tablir une nomenclature mdicale: les terminaisons en ose dsignent les formes gnrales de l'altration
(gastroses, leucoses, entroses), celles en ite dsignent les irritations des tissus, celle en rhe, les panchements, etc. Et dans ce seul projet de fixer un vocabulaire mticuleux et analytique, il confond sans scandale (parce que c'tait encore conceptuellement possible) les thmes d'une nosologie de type botanique, ceux de la localisation la manire de Morgagni, ceux de la description clinique et ceux de l'anatomie pathologique: Je me sers de la mthode des botanistes dj propose par Sauvages... mthode qui consiste rapprocher des objets qui ont de l'affinit et dposer ceux (1) Anatomie gnrale, t. I, p. XCVII-XCVIII. (2) R. LANNEC, Dictionnaire des Sciences mdicales, article Anatomie pathologique (II, p. 49). (3) Ibid., 450-452. |PAGE 135 qui n'ont aucune analogie. Pour arriver ce classement philosophique, pour lui donner des bases fixes et invariables, j'ai group les maladies d'aprs les organes qui en sont le sige spcial. On verra que c'tait l'unique moyen de trouver les caractres qui ont le plus de valeur pour le mdecin clinique (1). Mais comment est-il possible d'ajuster la perception anatomique la lecture des symptmes? Comment un ensemble simultan de phnomnes spatiaux pourrait-il fonder la cohrence d'une srie temporelle qui lui est, par dfinition, tout entire antrieure? Depuis Sauvages jusqu' Double, l'ide mme d'un fondement anatomique de la pathologie a eu ses adversaires, tous convaincus que les lsions visibles du cadavre ne pouvaient pas dsigner l'essence de l'invisible maladie. Comment, dans un ensemble lsionnel complexe, distinguer l'ordre essentiel de la srie des effets? Les adhrences du poumon sur le corps d'un pleurtique sont-elles un des phnomnes de la maladie elle-mme, ou une consquence mcanique de l'irritation (2)? Mme difficult situer le primitif et le driv: dans un squirre du pylore, on trouve des lments squirreux dans l'piploon et le msentre; o situer le fait pathologique premier? Enfin, les signes anatomiques indiquent mal l'intensit du processus morbide: il y a des altrations organiques trs fortes qui n'amnent que de lgers drangements dans l'conomie; mais on ne supposerait pas qu'une minuscule tumeur du cerveau puisse entraner la mort (3). Ne relatant jamais que le visible, et dans la forme simple, finale et abstraite de sa coexistence spatiale, l'anatomie ne peut pas dire ce qui est enchanement, processus et texte lisible dans l'ordre du temps. Une clinique des symptmes cherche le corps vivant de la maladie; l'anatomie ne lui en offre que le cadavre.
Cadavre doublement trompeur puisqu'aux phnomnes que la mort interrompt s'ajoutent ceux qu'elle provoque et dpose sur les organes selon un temps qui lui est propre. Il y a bien entendu les phnomnes de dcomposition, difficiles dissocier (1) J.-L. ALIBERT, Nosologie naturelle (Paris, 1817), avertissement, p. II, cf. d'autres classifications fondes sur l'anatomie pathologique chez Marandel (Essai sur les irritations, Paris, 1807) ou chez Andral. (2) F.-J. DOUBLE, Smiologie gnrale, t. I, pp. 56-57. (3) Ibid., pp. 64-67. |PAGE 136 de ceux qui appartiennent au tableau clinique de la gangrne ou de la fivre putride; il y a en revanche des phnomnes de rcession ou d'effacement: la rougeur des irritations disparat trs vite aprs l'arrt de la circulation; cette interruption des mouvements naturels (pulsations du coeur, panchement de la lymphe, respiration) dtermine elle-mme des effets dont il n'est pas facile de faire le dpart avec les lments morbides: l'engorgement du cerveau et le ramollissement rapide qui s'ensuit sont-ils l'effet d'une congestion pathologique, ou d'une circulation interrompue par la mort? Enfin, il faut peut-tre tenir compte de ce que Hunter a appel le stimulus de la mort, et qui dclenche l'arrt de la vie sans appartenir la maladie dont pourtant il dpend (1). En tout cas, les phnomnes d'puisement qui se produisent au terme d'une maladie chronique (flaccidit musculaire, diminution de la sensibilit et de la conductibilit) relvent plus d'un certain rapport de la vie la mort que d'une structure pathologique dfinie. Deux sries de questions se posent une anatomie pathologique qui veut fonder une nosologie: l'une concernant la jointure d'un ensemble temporel de symptmes et d'une coexistence spatiale de tissus; l'autre concernant la mort et la dfinition rigoureuse de son rapport la vie et la maladie. Dans son effort pour rsoudre ces problmes, l'anatomie de Bichat fait basculer toutes ses significations primitives. Pour tourner la premire srie d'objections, il a sembl qu'il n'tait pas besoin de modifier la structure mme du regard clinique: ne suffit-il pas de regarder les morts comme on regarde les vivants? Et d'appliquer aux cadavres le principe diacritique de l'observation mdicale: il n'y a de (ait pathologique que compar. Dans l'usage de ce principe, Bichat et ses successeurs retrouvent non seulement Cabanis et Pinel, mais Morgagni, mais Bonet et Valsalva. Les premiers anatomistes savaient bien qu'il fallait tre exerc la dissection des corps sains si on voulait dchiffrer, sur un cadavre, une maladie: de quelle manire, autrement, distinguer une maladie
intestinale, de ces concrtions polypeuses que produit la mort, ou qu'apportent parfois les saisons (1) J. HUNTER, Oeuvres compltes (Paris, 1839), t. I, p. 262. |PAGE 137 chez les bien-portants (1) ? Il faut aussi comparer les sujets morts de la mme maladie, en admettant le vieux principe que formulait dj le Sepulchretum ; les altrations releves sur tous les corps dfinissent sinon la cause, du moins le sige de la maladie, et peuttre sa nature; celles qui diffrent d'une autopsie l'autre sont de l'ordre de l'effet, de la sympathie ou de la complication (2). Confrontation enfin entre ce qu'on voit d'un organe altr et ce qu'on sait de son fonctionnement normal: il faut comparer constamment ces phnomnes sensibles et propres de la vie de la sant de chaque organe avec les drangements que chacun d'eux prsente dans sa lsion (3). Mais le propre de l'exprience anatomo-clinique est d'avoir appliqu le principe diacritique une dimension beaucoup plus complexe et problmatique: celle o viennent s'articuler les formes reconnaissables de l'histoire pathologique et les lments visibles qu'elle laisse apparatre une fois acheve. Corvisart rve de substituer au vieux trait de 1760 un texte, livre premier et absolu de l'anatomie pathologique, qui aurait pour titre: De sedibus et causis morborum per signa diagnostica investigatis et per anatomen confirmatis (4). Et cette cohrence anatomo-clinique que Corvisart peroit dans le sens d'une confirmation de la nosologie par l'autopsie, Lannec la dfinit en direction inverse: une remonte de la lsion aux symptmes qu'elle a provoqus: L'anatomie pathologique est une science qui a pour but la connaissance des altrations visibles que l'tat de maladie produit sur les organes du corps humain. L'ouverture des cadavres est le moyen d'acqurir cette connaissance; mais pour qu'elle devienne d'une utilit directe... il faut y joindre l'observation des symptmes ou des altrations de fonctions qui concident avec chaque espce d'altrations d'organes (5). Il faut donc que le regard mdical parcoure un chemin qui ne lui avait pas t jusqu'alors ouvert: voie verticale allant de la surface symptomatique la superficie tissulaire, voie en profondeur qui s'enfonce du manifeste vers le cach, voie qu'il faut parcourir dans les deux sens et continment si on veut, d'un terme l'autre, (1) MORGAGNI, Recherches anatomiques (d. de l'Encyclopdie des Sciences mdicales, 7e section, t. VII), p. 17. (2) Th. BON ET, Sepulchretum (Prface) ; ce principe est rappel par
MORGAGNI (ibid., p. 18). (3) CORVISART, Essai sur les maladies et les lsions organiques, du coeur et des gros vaisseaux (Paris, 3e d., 1818), Discours prliminaire, p. XII. (4) CORVISART, loc. cit., p. v. (5) LANNEC, article. Anatomie pathologique, Dictionnaire des Sciences mdicales, t. II, p. 47. |PAGE 138 dfinir le rseau des ncessits essentielles. Le regard mdical dont nous avons vu qu'il se posait sur les plages deux dimensions des tissus et des symptmes devra, pour les ajuster, se dplacer luimme le long d'une troisime dimension. Ainsi sera dfini le volume anatomo-clinique. Le regard s'enfonce dans l'espace qu'il s'est donn pour tche de parcourir. La lecture clinique sous sa forme premire impliquait un sujet extrieur et dchiffrant qui, partir et au-del de ce qu'il pelait, mettait en ordre et dfinissait les parents. Dans l'exprience anatomo-clinique, l'oeil mdical doit voir le mal s'taler et s'tager devant lui mesure qu'il pntre lui-mme dans le corps, qu'il s'avance parmi ses volumes, qu'il en contourne ou qu'il en soulve les masses, qu'il descend dans ses profondeurs. La maladie n'est plus un faisceau de caractres dissmins ici et l la surface du corps et lis entre eux par des concomitances et des successions statistiquement observables; elle est un ensemble de formes et de dformations, de figures, d'accidents, d'lments dplacs, dtruits ou modifis qui s'enchanent les uns aux autres selon une gographie qu'on peut suivre pas pas. Ce n'est plus une espce pathologique s'insrant dans le corps, l o c'est possible; c'est le corps lui-mme devenant malade. En premire approche, on pourrait croire qu'il ne s'agit l que d'une rduction de la distance entre le sujet connaissant et l'objet de connaissance. Le mdecin du XVIIe et du XVIIIe sicle ne restait-il pas distance de son malade? Ne le regardait-il pas de loin, n'observant que les marques superficielles et immdiatement visibles, guettant les phnomnes, sans contact, ni palpation, ni auscultation, devinant l'intrieur par les seules notations externes? Le changement dans le savoir mdical la fin du XVIIIe sicle ne tient-il pas essentiellement ceci que le mdecin s'est rapproch du malade, qu'il a tendu les doigts, et appliqu l'oreille, que changeant ainsi d'chelle, il s'est mis percevoir ce qu'il y avait immdiatement derrire la surface visible, et qu'il a t ainsi amen peu peu passer de l'autre ct, et reprer la maladie dans la profondeur
secrte du corps? Il s'agit l d'une interprtation minimale du changement. Mais sa discrtion thorique ne doit pas tromper. Elle emporte avec soi un certain nombre de rquisits, ou de rfrences qui demeurent assez peu labores: progrs de l'observation, souci de dvelopper et d'largir l'exprience, fidlit de plus en plus grande ce que peuvent rvler les donnes sensibles, abandon des thories et des systmes au profit d'un empirisme plus |PAGE 139 rellement scientifique. Et derrire tout cela, on suppose que le sujet et l'objet de connaissance restent ce qu'ils sont: leur proximit plus grande et leur meilleur ajustement ont seulement 'permis que l'objet dvoile avec davantage de clart ou de dtail les secrets qui sont les siens et que le sujet dpouille les illusions qui font obstacle la vrit. Constitus une fois pour toutes et dfinitivement mis en face l'un de l'autre, ils ne peuvent, au cours d'une transformation historique quelconque, que s'approcher, rduire leur distance, abolir les obstacles qui les sparent et trouver la forme d'un ajustement rciproque. Mais c'est l sans doute projet sur l'histoire une vieille thorie de la connaissance dont on connat depuis bien longtemps les effets et les mfaits. Une analyse historique un peu prcise rvle au-del de ces ajustements un tout autre principe de transformation: il porte solidairement sur le type d'objets connatre, sur le quadrillage qui le fait apparatre, l'isole et dcoupe les lments pertinents pour un savoir possible, sur la position que le sujet doit occuper pour les reprer, sur les mdiations instrumentales qui lui permettent de s'en saisir, sur les modalits d'enregistrement et de mmoire qu'il doit mettre en oeuvre, sur les formes de conceptualisation qu'il doit pratiquer et qui le qualifient comme sujet d'une connaissance lgitime. Ce qui est modifi donnant lieu la mdecine anatomoclinique, ce n'est donc pas la simple surface de contact entre le sujet connaissant et l'objet connu; c'est la disposition plus gnrale du savoir qui dtermine les positions rciproques et le jeu mutuel de celui qui doit connatre et de ce qui est connatre. L'accs du regard mdical l'intrieur du corps malade n'est pas la continuation d'un mouvement d'approche qui se serait dvelopp plus ou moins rgulirement depuis le jour o le regard, peine savant, du premier mdecin s'est port de loin sur le corps du premier patient; c'est le rsultat d'une refonte au niveau du savoir lui-mme, et non pas au niveau des connaissances accumules, affines, approfondies, ajustes.
Qu'il s'agisse d'un vnement qui atteint la disposition du savoir, la preuve s'en trouve dans le fait que les connaissances dans l'ordre de la mdecine anatomo-clinique ne se forment pas sur le mme mode et selon les mmes rgles que dans la pure et simple clinique. Il ne s'agit pas du mme jeu, un peu plus perfectionn, mais d'un autre jeu. Voici quelques-unes de ces rgles nouvelles. L'anatomo-clinique substitue la mthode des identits symptomatiques une analyse qu'on pourrait dire en damier ou |PAGE 140 en strates. Les rptitions manifestes laissent souvent mles des formes morbides dont l'anatomie seule peut montrer la diversit. La sensation d'touffement, les palpitations soudaines, surtout aprs un effort, la respiration courte et gne, les rveils en sursaut, une pleur cachectique, un sentiment de pression ou de constriction dans la rgion prcordiale, de lourdeur et d'engourdissement dans le bras gauche signifient d'une faon massive des maladies de coeur, dans lesquelles seule l'anatomie peut distinguer la pricardite (qui atteint les enveloppes membraneuses), l'anvrisme (affectant la substance musculaire), les rtrcissements et les endurcissements (o le coeur est affect dans ses parties tendineuses ou fibreuses) (1). La concidence ou du moins la succession rgulire du catarrhe et de la phtisie ne prouve pas malgr les nosographes leur identit, puisque l'autopsie montre dans un cas une atteinte de la membrane muqueuse, dans l'autre, une altration du parenchyme pouvant aller jusqu' l'ulcration (2). Mais inversement, il faut runir comme appartenant la mme cellule locale la tuberculose et l'hmoptysie entre lesquelles une symptomatologie comme celle de Sauvages ne trouvait pas un lien de frquence suffisant pour les runir. La concidence qui dfinit l'idendit pathologique n'aura de valeur que pour une perception localement cloisonne. C'est dire que l'exprience mdicale va substituer, l'enregistrement des frquences, le reprage du point fixe. Le cours symptomatique de la phtisie pulmonaire donne: la toux, la difficult de respirer, le marasme, la fivre hectique, et parfois des expectorations purulentes; mais aucune de ces modifications visibles n'est, absolument indispensable (il y a des tuberculeux qui ne toussent pas) ; et leur ordre d'entre en scne n'est pas rigoureux (la fivre peut apparatre tt ou ne se dclencher qu'au terme de l'volution). Un seul phnomne constant, condition ncessaire et suffisante pour qu'il y ait phtisie: la lsion du parenchyme pulmonaire qui, l'autopsie, se rvle parsem de plus ou moins de foyers purulents. Dans certains cas, ils sont si nombreux que le poumon ne semble plus
tre qu'un tissu alvolaire qui les contient. Ces foyers sont traverss par un grand nombre de brides; dans les parties voisines on trouve un endurcissement plus ou moins grand (3). Au-dessus de ce point fixe les symptmes glissent et disparaissent; l'indice de probabilit dont la clinique les affectait s'efface au profit d'une (1) CORVISART, loc. cit. (2) G.-L. BAYLE, -Recherches sur la phthisie pulmonaire (Paris, 1810). (3) X. BICHAT, Anatomie pathologique, p. 174. |PAGE 141 seule implication ncessaire qui est de l'ordre non de la frquence temporelle, mais de la constance locale: Il faut regarder comme phthisiques des individus qui n'ont ni fivre ni maigreur, ni expectoration purulente; il suffit que les poumons soient affects d'une lsion qui tend les dsorganiser et les ulcrer; la phthisie est cette lsion mme (1). Rattache ce point fixe, la srie chronologique des symptmes s'ordonne, sous la forme de phnomnes seconds, a la ramification de l'espace lsionnel et la ncessit qui lui est propre. Etudiant la marche bizarre et inexplicable de certaines fivres, Petit confronte systmatiquement les tableaux d'observation relevs au cours de la maladie et le rsultat des autopsies: la succession de signes intestinaux, gastriques, fivreux, glandulaires et mme encphaliques, doit tre primitivement rattache en sa totalit des altrations parfaitement semblables du tube intestinal. Il s'agit toujours de la rgion de la valvule ilo-caecale; elle est couverte de taches vineuses, boursoufles vers l'intrieur; et les glandes du segment msentrique qui lui correspondent sont enfles, d'un rouge sombre et bleutre, profondment injectes et engorges. Si la maladie a dur longtemps, il y a ulcration et destruction du tissu intestinal. On peut donc admettre qu'on est en prsence d'une action dltre sur le canal digestif dont les fonctions sont les premires altres; cet agent est transmis par absorption aux glandes du msentre, au systme lymphatique (d'o le trouble vgtatif), de l 11 l'universalit du systme, et singulirement ses lments encphaliques et nerveux, ce qui explique la somnolence, l'assoupissement des fonctions sensorielles, le dlire et les phases d'tat comateux (2). La succession des formes et des symptmes apparat alors comme l'image simplement chronologique d'un rseau plus complexe: un buissonnement spatio-temporel partir d'une attaque primitive et travers toute la vie organique. L'analyse de la perception anatomo-clinique met donc jour trois rfrences (celles de localisation, de foyer et de primitivit) qui
modifient la lecture essentiellement temporelle de la clinique. Le quadrillage organique qui permet de dterminer des points fixes mais arborescents n'abolit pas l'paisseur de l'histoire pathologique au profit de la pure surface anatomique; elle (1) G.-L. BAYLE, loc. cit., pp. 8-9. (2) M.-A. PETIT, Trait de la fivre entro-msentrique (Paris, 1813), surtout pp. XIX, XXX et pp. 132-141. |PAGE 142 l'introduit dans le volume spcifi du corps, faisant concider, pour la premire fois dans la pense mdicale, le temps morbide et le parcours reprable des masses organiques. Alors, mais alors seulement, l'anatomie pathologique retrouve les thmes de Morgagni, et, au-del, de Bonet : un espace organique autonome, avec ses dimensions, ses chemins, ses articulations propres vient doubler l'espace naturel ou significatif de la nosologie et exige qu'il lui soit, pour l'essentiel, rapport. Ne-du souci clinique de dfinir les structures de la parent pathologique (cf. le Trait des membranes) la nouvelle perception mdicale se donne finalement pour tche de reprer les figures de la localisation (cf. les recherches de Corvisart ou de G.-L. Bayle). La notion de sige est substitue dfinitivement celle de classe:Qu'est l'observation, demandait dj Bichat, si on ignore le sige du mal? (1). Et Bouillaud devait rpondre: S'il est un axiome en mdecine, c'est bien cette proposition, qu'il n'existe point de maladie sans sige. Si l'on admettait l'opinion contraire, il faudrait admettre aussi qu'il existe des fonctions sans organes, ce qui est une palpable absurdit. La dtermination du sige des maladies ou leur localisation est une des plus belles conqutes de la mdecine moderne (2). L'analyse tissulaire dont le sens d'origine tait gnrique a pris trs vite la valeur d'une rgle de localisation. Morgagni pourtant n'tait pas retrouv sans une modification majeure. Il avait associ la notion de sige pathologique celle de cause: De sedibus et causis...; dans la nouvelle anatomie pathologique, la dtermination du sige ne vaut pas assignation de causalit: trouver dans des fivres adynamiques des lsions ilocaecales n'est pas en noncer la cause dterminante; Petit pensera un agent dltre, Broussais une irritation. Peu importe: localiser, c'est fixer seulement un point de dpart spatial et temporel. Pour Morgagni, le sige, c'tait le point d'insertion dans l'organisme de la chane des causalits; il s'identifiait son maillon ultime. Pour Bichat et ses successeurs, la notion de sige est libre de la problmatique causale (et en ceci ils sont hritiers des cliniciens) ; elle est tourne vers l'avenir de la maladie plutt que vers son pass; le sige, c'est le
point d'o rayonne l'organisation pathologique. Non pas cause dernire, mais foyer primitif. C'est en ce sens que la fixation sur un cadavre d'un segment d'espace immobile peut rsoudre les problmes poss par les dveloppements temporels d'une maladie. (1) X. BICHAT, Anatomie gnrale, t. I, p. XCIX. (2) BOUILLAUD, Philosophie mdicale, p. 259. |PAGE 143 Dans la pense mdicale du XVIIIe sicle, la mort tait la fois le fait absolu et le plus relatif des phnomnes. Elle tait le terme de la vie, et celui galement de la maladie s'il tait de sa nature d'tre fatale; partir d'elle, la limite tait atteinte, la vrit accomplie et par l mme franchie: dans la mort, la maladie parvenue bout de course se taisait et devenait chose de mmoire. Mais s'il arrivait aux traces de la maladie de mordre sur le cadavre, alors aucune vidence ne pouvait absolument distinguer ce qui tait d'elle et ce qui tait de la mort; leurs signes s'entrecroisaient dans un indchiffrable dsordre. Si bien que la mort tait ce fait partir duquel il n'y a plus ni vie ni maladie, mais ses dsorganisations taient de mme nature que tous les phnomnes morbides. L'exprience clinique sous sa forme premire ne remettait pas en question ce concept ambigu de la mort. Technique du cadavre, l'anatomie pathologique doit donner cette notion un statut plus rigoureux, c'est--dire plus instrumental. Cette matrise conceptuelle de la mort a pu d'abord tre acquise, un niveau trs lmentaire, par l'organisation des cliniques. La possibilit d'ouvrir immdiatement les corps en diminuant le plus possible le temps de latence entre le dcs et l'autopsie a permis de faire concider, ou presque, le dernier moment du temps pathologique et le premier du temps cadavrique. Les effets de la dcomposition organique sont peu prs supprims, du moins sous leur forme la plus manifeste et la plus troublante; si bien que l'instant du dcs peut jouer le rle d'un repre sans paisseur qui retrouve le temps nosographique, comme le scalpel l'espace organique. La mort n'est plus que la ligne verticale et absolument mince qui spare mais permet de rapporter l'une l'autre la srie des symptmes et celle des lsions. D'autre part, Bichat, reprenant diverses indications de Hunter, s'efforce de distinguer deux ordres de phnomnes que l'anatomie de Morgagni avait confondus: les manifestations contemporaines de la maladie et celles antcdentes de la mort. En effet, il n'est pas ncessaire qu'une altration renvoie la maladie et la structure pathologique; elle peut renvoyer un processus diffrent, en partie autonome et en partie dpendant, qui annonce le cheminement de la
mort. Ainsi la flaccidit musculaire fait partie de la smiologie de certaines paralysies d'origine encphalique, ou d'une affection vitale comme la |PAGE 144 fivre asthnique; mais on peut la rencontrer aussi dans n'importe quelle maladie chronique, ou mme dans un pisode aigu pourvu qu'ils soient l'un et l'autre d'assez longue dure; on en voit des exemples dans des inflammations de l'arachnode, ou dans les dernires phases de la phtisie. Le phnomne, qui n'aurait pas eu lieu sans la maladie, n'est pas pourtant la maladie elle-mme: elle double sa dure d'une volution qui n'indique pas une figure du pathologique, mais une proximit de la mort; elle dsigne, sous le processus morbide, celui, associ mais diffrent, de la mortification. Ces phnomnes, sans doute, ne manquent pas d'analogie de contenu avec les signes fatals ou favorables, si souvent analyss depuis Hippocrate. Par leur fonction, cependant, et leur valeur smantique, ils en sont trs diffrents: le signe renvoyait une issue, en anticipant sur le temps; et il indiquait soit la gravit essentielle de la maladie, soit sa gravit accidentelle (qu'elle soit due une complication ou une faute thrapeutique). Les phnomnes de mort partielle ou progressive ne prjugent aucun avenir: ils montrent un processus en cours d'accomplissement; aprs une apoplexie, la plupart des fonctions animales sont naturellement suspendues, et par consquent la mort a dj commenc pour elles, alors que les fonctions organiques poursuivent leur vie propre (1). De plus, les paliers de cette mort mouvante ne suivent pas seulement ni tellement les formes nosologiques, mais plutt les lignes de facilitation propres l'organisme; ces processus n'indiquent que d'une manire accessoire la fatalit mortelle de la maladie; ce dont ils parlent, c'est de la permabilit de la vie la mort: quand un tat pathologique se prolonge, les premiers tissus atteints par la mortification sont toujours ceux o la nutrition est la plus active (les muqueuses) ; puis vient le parenchyme des organes et dans la phase dernire, les tendons et les aponvroses (2). La mort est donc multiple et disperse dans le temps: elle n'est pas ce point absolu et privilgi, partir duquel les temps s'arrtent pour se renverser, elle a comme la maladie elle-mme une prsence fourmillante que l'analyse peut rpartir dans le temps et l'espace; peu peu, ici ou l, chacun des noeuds vient se rompre, jusqu' ce que cesse la vie organique, au moins dans ses formes majeures, puisque longtemps encore aprs la mort de
(1) X. BICHAT, Recherches physiologiques sur la vie et la mort (d. MAGENDIE), p. 251. (2) X. BICHAT, Anatomie pathologique, p. 7. |PAGE 145 l'individu, des morts minuscules et partielles viendront leur tour dissocier les lots de vie qui s'obstinent (1). Dans la mort naturelle, la vie animale s'teint la premire: extinction sensorielle d'abord, assoupissement du cerveau, affaiblissement de la locomotion, rigidit des muscles, diminution de leur contractilit, quasi-paralysie des intestins et finalement immobilisation du coeur (2). A ce tableau chronologique des morts successives, il faut ajouter celui, spatial, des interactions qui dclenchent, d'un point l'autre de l'organisme, des morts en chane; elles ont trois relais essentiels: coeur, poumons et cerveau. On peut tablir que la mort du coeur n'entrane pas celle du cerveau par la voie nerveuse, mais par le rseau artriel (arrt du mouvement qui entretient la vie crbrale) ou par le rseau vasculaire (arrt du mouvement, ou au contraire, reflux de sang noir qui embarrasse le cerveau, le comprime, et l'empche d'agir). On peut montrer aussi comment la mort du poumon entrane celle du coeur: soit parce que le sang a trouv dans le poumon un obstacle mcanique la circulation; soit parce que le poumon cessant d'agir, les ractions chimiques n'ont plus d'aliment et la contraction du coeur s'interrompt (3). Les processus de la mort qui ne s'identifient ni ceux de 'la vie ni ceux de la maladie sont de nature pourtant clairer les phnomnes organiques et leurs perturbations. La mort lente et naturelle du vieillard reprend en sens inverse le dveloppement de la vie chez l'enfant, chez l'embryon, peut-tre mme chez la plante: L'tat de l'animal que la mort naturelle va anantir se rapproche de celui o il se trouvait dans le sein de sa mre, et mme de celui du vgtal qui ne vit qu'au-dedans, et pour qui toute la nature est en silence (4). Les enveloppes successives de la vie se dtachent naturellement, nonant leur autonomie et leur vrit dans cela mme qui les nie. Le systme des dpendances fonctionnelles et des interactions normales ou pathologiques s'claire aussi de l'analyse de ces morts en dtail: on peut reconnatre que, s'il y a action directe du poumon sur le coeur, celui-ci ne subit qu'indirectement l'influence du cerveau: l'apoplexie, l'pilepsie, le narcotisme, les commotions crbrales ne provoquent aucune modification immdiate et correspondante du coeur; seuls des effets secondaires pourront se produire par l'intermdiaire de la paralysie musculaire, de l'interruption (1) x. BICHAT, Recherches physiologiques, p. 242.
(2) Ibid., pp. 234, 238. (3) Ibid., pp. 253 et 538. (4) Ibid., p. 238. |PAGE 146 de la respiration ou des troubles circulatoires (1). Ainsi fixe dans ses mcanismes propres, la mort avec son rseau organique ne peut plus tre confondue avec la maladie ou ses traces; elle peut au contraire servir de point de vue sur le pathologique et permettre d'en fixer les formes ou les tapes. En tudiant les causes de la phtisie, G.-L. Bayle ne considre plus la mort comme un cran (fonctionnel et temporel) qui le sparerait de la maladie, mais comme une situation exprimentale spontane qui ouvre l'accs la vrit mme de la maladie et ses diffrentes phases chronologiques. La mort peut, en effet, se produire tout au long du calendrier pathologique, soit sous l'effet de la maladie elle-mme, soit Cause d'une affection surajoute, soit enfin raison d'un accident. Une fois connus et matriss les phnomnes invariants et les manifestations variables de la mort, on peut reconstituer, grce cette ouverture sur le temps, l'volution de toute une srie morbide. Pour la phtisie, ce sont d'abord des tubercules fermes, homognes, blanchtres; puis des formations plus molles, comportant au centre un noyau de matire purulente qui en altre la couleur; enfin un tat de suppuration qui provoque des ulcres et une destruction du parenchyme pulmonaire (2). Systmatisant la mme mthode, Lannec a pu montrer, contre Bayle lui-mme, que la mlanose ne formait pas un type pathologique distinct, mais une phase possible de l'volution. Le temps de la mort peut glisser tout au long de l'volution morbide; et comme cette mort a perdu son caractre opaque, elle devient, paradoxalement et par son effet d'interruption temporelle, l'instrument qui permet d'intgrer la dure de la maladie l'espace immobile d'un corps dcoup. La vie, la maladie et la mort constituent maintenant une trinit technique et conceptuelle. La vieille continuit des hantises millnaires qui plaaient dans la vie la menace de la maladie, et dans la maladie la prsence approche de la mort est rompue: sa place, une figure triangulaire s'articule, dont le sommet suprieur est dfini par la mort. C'est du haut de la mort qu'on peut voir et analyser les dpendances organiques et les squences pathologiques. Au lieu d'tre ce qu'elle avait t si longtemps, cette nuit o la vie s'efface, o la maladie mme se brouille, elle est doue dsormais de ce grand pouvoir d'clairement qui domine et met jour la fois l'espace de l'organisme et le temps de la maladie... Le privilge de son
intemporalit, qui est aussi (1) Ibid., p. 480, 500. (2) G.-L. BAYLE, Recherches sur la phthisie pulmonaire, pp. 21-24. |PAGE 147 vieux sans doute que la conscience de son imminence, est pour la premire fois retourn en instrument technique qui donne prise sur la vrit de la vie et la nature de son mal. La mort, c'est la grande analyste, qui montre les connexions en les dpliant, et fait clater les merveilles de la gense dans la rigueur de la dcomposition: et il faut laisser le mot de dcomposition trbucher dans la lourdeur de son sens. L'Analyse, philosophie des lments et de leurs lois, trouve dans la mort ce qu'en vain elle avait cherch dans les mathmatiques, dans la chimie, dans le langage mme: un indpassable modle, et prescrit par la nature; sur ce grand exemple, le regard mdical va dsormais s'appuyer. Il n'est plus celui d'un oeil vivant; mais le regard d'un oeil qui a vu la mort. Grand oeil blanc qui dnoue la vie. Il y aurait beaucoup dire sur le vitalisme de Bichat. Il est vrai qu'en essayant de cerner le caractre singulier du phnomne vivant, Bichat liait sa spcificit le risque de la maladie : un corps simplement physique ne peut pas dvier de son type naturel (1). Mais ceci n'empche que l'analyse de la maladie ne peut se faire que du point de vue de la mort -de cette mort laquelle la vie rsiste par dfinition. Bichat a relativis le concept de mort, le faisant dchoir de cet absolu o il apparaissait comme un vnement inscable, dcisif et irrcuprable : il l'a volatilis et rparti dans la vie, sous la forme de morts en dtail, morts partielles, progressives et si lentes s'achever par-del la mort mme. Mais de ce fait, il en formait une structure essentielle de la pense et de la perception mdicales; ce quoi s'oppose la vie et ce quoi elle s'expose; ce par rapport quoi elle est vivante opposition, donc vie; ce par rapport quoi elle est analytiquement expose, donc vraie. Magendie et avant lui dj Buisson allaient au fond du problme, mais en biologistes, lorsqu'ils critiquaient la dfinition de la vie par quoi s'ouvrent les Recherches physiologiques: Ide fausse puisque mourir signifie dans toutes les langues cesser de vivre et que ds lors la prtendue dfinition se rduit ce cercle vicieux: la vie est l'ensemble des fonctions qui rsistent l'absence de vie (2). Mais c'tait d'une exprience premire d'anatomo-pathologiste qu'tait parti Bichat, celle qu'il avait constitue lui-mme: exprience dans laquelle la mort tait la seule possibilit de donner la vie une vrit positive. L'irrductibilit du vivant
(1) Cf. G. CANGUILHEM, La connaissance de la vie (Paris, 1952), p. 195. (2) F.-R. BUISSON, De la division la plus naturelle des phnomnes physiologiques (Paris, 1802), p. 57. Cf. aussi MAGENDIE, n. 1 de la p. 2 de son dition des Recherches physiologiques. |PAGE 148 au mcanique ou au chimique n'est que seconde par rapport ce lien fondamental de la vie et de la mort. Le vitalisme apparat sur fond de ce mortalisme. Le chemin parcouru est immense depuis le moment, proche pourtant, o Cabanis assignait au savoir de la vie la mme origine et le mme fondement qu' la vie elle-mme: La nature a voulu que la source de nos connaissances ft la mme que celle de la vie. Il faut recevoir des impressions pour vivre; il faut recevoir des impressions pour connatre; et comme la ncessit d'tudier est toujours en raison directe de leur action sur nous, il s'ensuit que nos moyens d'instruction sont toujours proportionns nos besoins (1). Pour Cabanis comme pour le XVIIIe sicle et pour toute une tradition qui tait familire dj la Renaissance, la connaissance de la vie s'appuyait de plein droit sur l'essence du vivant, puisqu'elle n'en tait, elle aussi, qu'une manifestation. C'est pourquoi on ne cherchait jamais penser la maladie qu' partir du vivant, ou de ses modles (mcaniques) et de ses constituants (humoraux, chimiques) ; le vitalisme et l'antivitalisme naissaient l'un et l'autre de cette antriorit fondamentale de la vie dans l'exprience de la maladie. Avec Bichat, la connaissance de la vie trouve son origine dans la destruction de la vie, et dans son extrme oppos; c'est la mort que la maladie et la vie disent leur vrit: vrit spcifique, irrductible, protge de toutes les assimilations l'inorganique par le cercle de la mort qui les dsigne pour ce qu'elles sont. Cabanis, qui enfonait si loin la vie dans la profondeur des origines, tait tout naturellement plus mcanicien que Bichat qui ne la pensait que dans son rapport la mort. Du fond de la Renaissance jusqu' la fin du XVIIIe sicle, le savoir de la vie tait pris dans le cercle de la vie qui se replie sur ellemme et se mire; partir de Bichat il est dcal par rapport la vie, et spar d'elle par l'infranchissable limite de la mort, au miroir de laquelle il la regarde. Sans doute tait-ce une tche bien difficile et paradoxale pour le regard mdical que d'oprer une telle conversion. Une pente immmoriale aussi vieille que la peur des hommes tournait les yeux des mdecins vers l'limination de la maladie, vers la
(1) CABANIS, Du degr de certitude de la mdecine (3e d., Paris, 1819), pp. 76-77. |PAGE 149 gurison, vers la vie: il ne pouvait s'agir que de la restaurer. La mort restait, dans le dos du mdecin, la grande menace sombre o s'abolissaient son savoir et son habilet; elle tait le risque non seulement de la vie et de la maladie mais du savoir qui les interrogeait. Avec Bichat, le regard mdical pivote sur lui-mme et demande la mort compte de la vie et de la maladie, son immobilit dfinitive de leur temps et de leurs mouvements. Ne fallait-il pas que la mdecine contourne son plus vieux souci pour lire, dans ce qui tmoignait de son chec, ce qui devait fonder sa vrit? Mais Bichat a fait plus que de librer la mdecine de la peur de la mort. Il a intgr cette mort il un ensemble technique et conceptuel o elle prend ses caractres spcifiques et sa valeur fondamentale d'exprience. Si bien que la grande coupure dans l'histoire de la mdecine occidentale date prcisment du moment o l'exprience clinique est devenue le regard anatomo-clinique. La Mdecine clinique de Pinel date de 1802 ; Les Rvolutions de la Mdecine paraissent en 1804; les rgles de l'analyse semblent triompher dans le pur dchiffrement des ensembles symptomatiques. Mais une anne auparavant Bichat les avait dj relgus dans l'histoire: Vous auriez pendant vingt ans pris du matin au soir des notes au lit des malades sur les affections du coeur, des poumons, du viscre gastrique, que tout ne sera pour vous que confusion dans les symptmes qui, ne se ralliant rien, vous offriront une suite de phnomnes incohrents. Ouvrez quelques cadavres: vous verrez aussitt disparatre l'obscurit que la seule observation n'avait pu dissiper (1). La nuit vivante se dissipe la clart de la mort. (1) X. BICHAT, Anatomie gnrale, avant-propos, p. XCIX. |PAGE 151 CHAPITRE IX L'Invisible Visible Vue de la mort, la maladie a une terre, une reprable patrie, un lieu souterrain mais solide, o se nouent ses parents et ses consquences; les valeurs locales dfinissent ses formes. A partir du cadavre on la peroit paradoxalement vivre. D'une vie qui n'est plus celle des vieilles sympathies ni des lois combinatoires des
complications, mais qui a ses figures et ses lois propres. 1. Principe de la communication tissulaire Dj, Roederer et Wagler avaient dfini le morbus mucosus comme une inflammation susceptible d'atteindre la face interne et externe du canal alimentaire sur toute son tendue (1); observation que gnralise Bichat: un phnomne pathologique suit dans l'organisme le chemin privilgi que prescrit l'identit tissulaire. Chaque type de membrane a des modalits pathologiques qui lui sont propres: Puisque les maladies ne sont que des altrations des proprits vitales, et que chaque tissu diffre des autres dans le rapport de ces proprits, il est vident qu'il doit en diffrer aussi par ses maladies (2). L'arachnode peut tre atteinte des mmes formes d'hydropisie que la plvre du poumon ou le pritoine, puisqu'il s'agit ici et l de membranes sreuses. Le rseau des sympathies qui n'tait fix que sur des ressemblances sans systme, des constatations empiriques, ou une assignation conjecturale du rseau nerveux, repose maintenant sur une stricte analogie de structure: quand les enveloppes du (1) ROEDERER et WAGLER, Tractatus de morbo mucoso (Gttingen, 1783). (2) X. BICHAT, Anatomie gnrale, avant-propos, t. I, p. LXXXV. |PAGE 152 cerveau sont enflammes, la sensibilit de l'oeil et de l'oreille est exacerbe; dans l'opration de l'hydrocle par injection, l'irritation de la tunique vaginale provoque des douleurs dans la rgion lombaire; une inflammation de la plvre intestinale peut provoquer par une sympathie de tonicit une affection crbrale (1). Le cheminement pathologique a maintenant ses voies obliges. 2. Principe de l'impermabilit tissulaire C'est le corrlatif du prcdent. S'tendant par nappes, le processus morbide suit horizontalement un tissu sans pntrer verticalement dans les autres. Le vomissement sympathique concerne le tissu fibreux, non la membrane muqueuse de l'estomac; les maladies du prioste sont trangres l'os, et quand il y a catarrhe dans les bronches, la plvre reste intacte. L'unit fonctionnelle d'un organe ne suffit pas forcer la communication d'un fait pathologique d'un tissu un autre. Dans l'hydrocle, le testicule reste intact au milieu de l'inflammation de la tunique qui l'enveloppe (2) ; alors que les atteintes de la pulpe crbrale sont rares, celles de l'arachnode sont frquentes, et d'un type trs diffrent de celles qui, d'autre part, atteignent la pie-mre. Chaque strate tissulaire dtient et conserve ses caractres pathologiques individuels. La diffusion morbide est affaire de surfaces isomorphes non de voisinage ni de superposition.
3. Principe de la pntration en vrille Sans les remettre en question, ce principe limite les deux prcdents. Il compense la rgle de l'homologie par celles des influences rgionales, et celle de l'impermabilit en admettant des formes de pntration par couches. Il peut arriver qu'une affection dure assez pour imprgner les tissus sous-jacents ou voisins: c'est ce qui se produit dans des maladies chroniques comme le cancer, o tous les tissus d'un organe sont successivement atteints et finissent confondus en une masse commune (3). Il se produit aussi des passages moins facilement assignables : non par imprgnation ni contact mais par un double mouvement (1) X. BICHAT, Trait des membranes (d. MAGENDIE), pp. 122-123. (2) Ibid., p. 101. (3) X. BICHAT, Anatomie gnrale, t. I, avant-propos, p. XCI. |PAGE 153 allant d'un tissu l'autre, et d'une structure un fonctionnement; l'altration d'une membrane peut, sans gagner la voisine, empcher d'une faon plus ou moins complte l'accomplissement de ses fonctions: les scrtions muqueuses de l'estomac peuvent tre gnes par l'inflammation de ses tissus fibreux; et les fonctions intellectuelles peuvent tre empches par des lsions de l'arachnode (1). Les formes de pntration intertissulaires peuvent tre plus complexes encore: la pricardite en atteignant les enveloppes membraneuses du coeur provoque un trouble de fonctionnement qui entrane l'hypertrophie de l'organe, et par consquent une modification de sa substance musculaire (2). La pleursie ne concerne, en son origine, que la plvre du poumon; mais celle-ci, sous l'effet de la maladie, scrte un liquide albumineux qui, dans les cas de chronicit, recouvre tout le poumon; celui-ci s'atrophie, son activit diminue jusqu' un arrt presque total du fonctionnement, et il est alors si rduit en surface et en volume qu'on peut croire une destruction de la majeure partie de ses tissus (3). 4. Principe de la spcificit du mode d'attaque des tissus Les altrations dont la trajectoire et le travail sont dtermins par les principes prcdents relvent d'une typologie qui ne dpend pas seulement du point qu'elles attaquent, mais d'une nature qui leur est propre. Bichat n'avait pas t trs loin dans la description de ces divers modes, puisqu'il n'avait distingu que les inflammations et les squirres. Lannec, nous l'avons vu (4), a tent une typologie gnrale des altrations (de texture, de forme, de nutrition, de position, celles enfin qui sont dues la prsence de corps trangers). Mais la notion mme d'altration de texture est insuffisante pour dcrire les
diverses manires dont un tissu peut tre attaqu dans sa constitution interne. Dupuytren propose de distinguer les transformations d'un tissu dans un autre et les productions de tissus nouveaux. Dans un cas, l'organisme produit un tissu qui existe rgulirement, mais qu'on ne trouve d'ordinaire que selon une autre localisation: ainsi les ossifications contre nature; on peut dnombrer des productions (1) Ibid., p. XCII. (2) CORVISART, Essai sur les maladies et les lsions organiques du coeur et des gros vaisseaux. (3) G.-L. BAYLE, Recherches sur la phthisie pulmonaire, pp. 13-14. (4) Cf. supra, p. 134. |PAGE 154 cellulaires, adipeuses, fibreuses, cartilagineuses, osseuses, sreuses, synoviales, muqueuses; il s'agit l d'aberrations des lois de la vie, non d'altrations. Dans le cas au contraire o un tissu nouveau est cr, c'est que les lois de l'organisation sont perturbes fondamentalement; le tissu lsionnel s'carte de tout tissu existant dans la nature: ainsi l'inflammation, les tubercules, les squirres, le cancer. Enfin, articulant cette typologie sur les principes de localisation tissulaire, Dupuytren note que chaque membrane a un type privilgi d'altration: les polypes par exemple pour les muqueuses, et l'hydropisie pour les membranes sreuses (1). C'est en appliquant ce principe que Bayle a pu suivre de bout en bout l'volution de la phtisie, reconnatre l'unit de ses processus, spcifier ses formes, et la distinguer d'affections dont la symptomatologie peut tre semblable, mais qui rpondent un type d'altration absolument diffrent. La phtisie est caractrise par une dsorganisation progressive du poumon, qui peut prendre une forme tuberculeuse, ulcreuse, calculeuse, granuleuse, avec mlanose, ou cancreuse ; et on ne doit la confondre ni avec l'irritation des muqueuses (catarrhe) ni avec l'altration des scrtions sreuses (pleursie), ni surtout avec une modification qui attaque elle aussi le poumon lui-mme, mais sur le mode de l'inflammation: la pripneumonie chronique (2). 5. Principe de l'altration de l'altration La rgle prcdente exclut d'une faon gnrale les affections diagonales qui croisent divers modes d'attaques et les utilisent tour tour. Il y a pourtant des effets de facilitation qui enchanent les uns aux autres des troubles diffrents: l'inflammation des poumons et le catarrhe ne constituent pas la tuberculose; ils en favorisent pourtant le dveloppement (3). La chronicit, ou du moins l'talement dans le
temps d'une attaque, autorise parfois la relve d'une affection par une autre. La congestion crbrale sous la forme instantane d'une fluxion brusque provoque une distension des vaisseaux (d'o les vertiges, les blouissements, les illusions d'optique, les tintements d'oreille) ou, si elle est concentre en un point, une rupture des vaisseaux avec hmorragie et paralysie immdiate. Mais si la congestion se (1) Article Anatomie pathologique, in Bulletin de l'Ecole de Mdecine de Paris, an XIII, Ire anne, pp. 16-18. (2) G.-L. BAYLE, Recherches sur la phthisie pulmonaire, p. 12. (3) Ibid., pp. 423-424. |PAGE 155 fait par invasion lente, il y a d'abord une infiltration sanguine dans la matire crbrale (accompagne de convulsions et de douleurs), un ramollissement corrlatif de cette substance, qui, par mlange avec le sang, s'altre en profondeur, s'agglutine pour former des lots inertes (d'o les paralysies); finalement il se produit une dsorganisation complte du systme artrioveineux dans le parenchyme crbral et souvent mme dans l'arachnode. Ds les premires formes de ramollissement, on peut constater des panchements sreux, puis une infiltration de pus qui parfois se recueille en abcs; en fin de compte la suppuration et le ramollissement extrme des vaisseaux remplacent l'irritation due leur congestion et leur trop forte tension (1). Ces principes dfinissent les rgles du cursus pathologique et dcrivent par avance les chemins possibles qu'il doit suivre. Ils fixent le rseau de son espace et de son dveloppement, faisant apparatre en transparence les nervures de la maladie. Celle-ci prend la figure d'une grande vgtation organique, qui a ses formes de pousse, son enracinement et ses rgions privilgies de croissance. Spatialiss dans l'organisme selon des lignes et des plages qui leur sont propres, les phnomnes pathologiques prennent l'allure de processus vivants. De l deux consquences: la maladie est branche sur la vie ellemme, se nourrissant d'elle, et participant il ce commerce rciproque d'action o tout se succde, s'enchane et se lie (2). Elle n'est plus un vnement ou une nature importe de l'extrieur; elle est la vie se modifiant dans un fonctionnement inflchi: Tout phnomne physiologique se rapporte en dernire analyse aux proprits des corps vivants considrs dans leur tat naturel; tout phnomne pathologique drive de leur augmentation, de leur diminution et de leur altration (3). La maladie est une dviation intrieure de la vie. De plus, chaque ensemble morbide s'organise sur
le modle d'une individualit vivante: il y a une vie des tubercules et des cancers ; il Y a une vie de l'inflammation; le vieux rectangle qui la qualifiait (tumeur, rougeur, chaleur, douleur) est insuffisant restituer son dveloppement au long des diverses stratifications organiques: dans les capillaires sanguins, elle passe par la rsolution, la gangrne, l'induration, la suppuration et l'abcs; dans les capillaires blancs, la courbe va de la rsolution la suppuration blanche et tuberculeuse, et de l aux ulcres rongeants, (1) F. LALLEMAND, Recherches anatomo-pathologiques sur l'encphale et ses dpendances, l, p. 98-99. (2) X. BICHAT, Anatomie gnrale, t. IV, p. 591. (3) Ibid., I, avant-propos, p. VII. |PAGE 156 incurables (1). Il faut donc substituer, l'ide d'une maladie qui attaquerait la vie, la notion beaucoup plus serre de vie pathologique. Les phnomnes morbides sont comprendre partir du texte mme de la vie, et non d'une essence nosologique: On a considr les maladies comme un dsordre; on n'y a point vu une srie de phnomnes dpendant tous les uns des autres et tendant le plus souvent une fin dtermine: on a compltement nglig la vie pathologique. Dveloppement non chaotique, enfin sage de la maladie? Mais c'tait chose acquise et depuis longtemps; la rgularit botanique, la constance des formes cliniques avaient mis ordre, bien avant la nouvelle anatomie, dans le monde du mal. Le fait de l'ordonnance n'est pas nouveau, mais son mode et son fondement. Depuis Sydenham et jusqu' Pinel, la maladie prenait source et visage dans une structure gnrale de rationalit o il tait question de la nature et de l'ordre des choses. A partir de Bichat, le phnomne pathologique est peru sur le fond de la vie, se trouvant li ainsi aux formes concrtes et obliges qu'elle prend dans une individualit organique. La vie, avec ses marges finies et dfinies de variation, va jouer dans l'anatomie pathologique le rle qu'assurait, dans la nosologie, la notion large de nature: elle est le fond inpuisable mais clos o la maladie trouve les ressources ordonnes de ses dsordres. Changement lointain, thorique, qui modifie, et longue chance, un horizon philosophique; mais peut-on dire qu'il pse tout de suite sur un monde de perception et ce regard qu'un mdecin pose sur un malade? D'un poids trs lourd et dcisif sans doute. Les phnomnes de la maladie trouvent l leur nouveau statut pistmologique. Paradoxalement le nominalisme clinique laissait flotter la limite
du regard mdical, aux frontires grises du visible et de l'invisible, quelque chose qui tait la fois le tout des phnomnes et leur loi, leur point de recollection, mais aussi la rgle stricte de leur cohrence; la maladie n'avait de vrit que dans les symptmes, mais elle tait les symptmes donns en vrit. La dcouverte des processus vitaux comme contenu de la maladie (1) F.-J. BROUSSAIS, Histoire des phlegmasies chroniques (Paris, 1808), t. I, pp. 54-55. |PAGE 157 permet de lui donner un fondement qui n'est pourtant ni lointain ni abstrait: un fondement aussi proche que possible de ce qui est manifeste; la maladie ne sera plus que la forme pathologique de la vie. Les grandes essences nosologiques, qui planaient au-dessus de l'ordre de la vie et le menaaient, sont maintenant, par lui, contournes: la vie est l'immdiat, le prsent et le perceptible au-del de la maladie; et celle-ci, son tour, rejoint ses phnomnes dans la forme morbide de la vie. Ractivation d'une philosophie vitaliste ? Il est vrai que la pense de Bordeu ou de Barthez tait familire Bichat. Mais si le vitalisme est un schma d'interprtation spcifique des phnomnes sains ou morbides de l'organisme, c'est un concept un peu trop mince pour rendre compte de l'vnement que fut la dcouverte de l'anatomie pathologique. Bichat n'a repris le thme de la spcificit du vivant que pour situer la vie un niveau pistmologique plus profond et plus dterminant : elle est pour lui non pas un ensemble de caractres qui se distinguent de l'inorganique, mais le fond partir duquel l'opposition de l'organisme au non-vivant peut tre peru, situ et charg de toutes les valeurs positives d'un conflit. La vie n'est pas la forme de l'organisme, mais l'organisme la forme visible de la vie dans sa rsistance ce qui ne vit pas et s'oppose elle. Une discussion entre le vitalisme et le mcanisme, comme entre l'humorisme et le solidisme, n'avait de sens que dans la mesure o la nature, fondement ontologique trop large, laissait place au jeu de ces modles interprtatifs: le fonctionnement normal ou anormal ne pouvait tre expliqu que par rfrence soit une forme prexistante, soit un type spcifique. Mais partir du moment o la vie n'explique pas seulement une srie de figures naturelles, mais reprend son compte le rle d'lment gnral pour les phnomnes physiologiques et pathologiques, l'ide mme d'un vitalisme perdait sa signification et l'essentiel de son contenu. En donnant la vie, et la vie pathologique, un statut aussi fondamental, Bichat a affranchi la mdecine de la discussion vitaliste et de celles qui lui taient
connexes. D'o ce sentiment, qui a port la rflexion thorique de la plupart des mdecins au dbut du XIXe sicle, qu'ils taient enfin librs des systmes et des spculations. Les cliniciens, Caganis, Pinel, prouvaient leur mthode comme la philosophie ralise (1) ; les anatomo-pathologistes (1) Cf. par exemple PINEL, Nosographie philosophique, introduction p. XI ; ou C.-L. DUMAS, Recueil de discours prononcs la Facult de Mdecine de Montpellier (Montpellier, 1820), pp. 22-23. |PAGE 158 dcouvrent dans la leur une non-philosophie, une philosophie abolie, qu'ils auraient vaincue en apprenant enfin percevoir : il s'agissait seulement d'un dcalage dans le fondement pistmologique sur quoi ils appuyaient leur perception. Situe ce niveau pistmologique, la vie est lie la mort, comme ce qui menace positivement et risque de dtruire sa force vive. Au XVIIIe sicle, la maladie tait la fois de la nature et de la contrenature, puisqu'elle avait une essence ordonne mais qu'il tait de son essence de compromettre la vie naturelle. A partir de Bichat, la maladie va jouer le mme rle de mixte, mais entre la vie et la mort. Entendons-nous bien: on connaissait, et bien avant l'anatomie pathologique, le chemin qui va de la sant la maladie, et d'elle la mort. Mais ce rapport, jamais, n'avait t scientifiquement pens, ni structur dans une perception mdicale; il acquiert au dbut du XIXe sicle une figure qu'on peut analyser deux niveaux. Celui que nous connaissons dj: la mort comme point de vue absolu sur la vie, et ouverture (dans tous les sens du mot, jusqu'au plus technique) sur sa vrit. Mais la mort est aussi ce contre quoi la vie, dans son exercice quotidien, vient buter; en elle, le vivant se rsout naturellement: et la maladie perd son vieux statut d'accident pour entrer dans la dimension intrieure, constante et mobile du rapport de la vie la mort. Ce n'est pas parce qu'il est tomb malade que l'homme meurt; c'est fondamentalement parce qu'il peut mourir qu'il arrive l'homme d'tre malade. Et sous le rapport chronologique vie-maladie-mort, une autre figure, antrieure et plus profonde est trace, celle qui lie la vie et la mort, pour librer en surplus les signes de la maladie. Plus haut, la mort tait apparue comme la condition de ce regard qui recueille, en une lecture des surfaces, le temps des vnements pathologiques; elle permettait la maladie rie s'articuler enfin dans un discours vrai. Maintenant elle apparat comme la source de la maladie dans son tre mme, cette possibilit intrieure la vie mais plus forte qu'elle, qui la fait s'user, dvier, et enfin disparatre. La mort, c'est la maladie rendue possible dans la vie. Et s'il est vrai que
pour Bichat le phnomne pathologique est branch sur le processus physiologique et en drive, cette drivation, dans l'cart qu'elle constitue et qui dnonce le fait morbide, se fonde sur la mort. La dviation dans la vie est de l'ordre de la vie, mais d'une vie qui va la mort. D'o l'importance prise ds l'apparition de l'anatomie pathologique par le concept de dgnration. Notion ancienne dj: Buffon l'appliquait aux individus ou sries d'individus qui s'cartent |PAGE 159 de leur type spcifique (1) ; les mdecins lutilisaient aussi pour dsigner cet affaiblissement de la robuste humanit naturelle, que la vie en socit, la civilisation, les lois et le langage condamnent peu peu il une vie d'artifices et de maladies; dgnrer, c'tait dcrire un mouvement de chute partir d'un statut d'origine, figurant par droit de nature au sommet de la hirarchie des perfections et des temps; en cette notion se recueillait tout ce que l'historique, l'atypique et le contre-nature pouvaient comporter de ngatif. Appuye, partir de Bichat, sur une perception de la mort enfin conceptualise, la dgnration recevra peu peu un contenu positif. A la frontire des deux significations, Corvisart dfinit la maladie organique par le fait qu' un organe, ou un solide vivant quelconque, est dans son tout ou dans une de ses parties assez dgnr de sa condition naturelle pour que son action facile, rgulire et constante en soit lse ou drange d'une manire sensible et permanente (2). Dfinition large qui enveloppe toute forme possible d'altration anatomique et fonctionnelle; dfinition ngative encore puisque la dgnration n'est qu'une distance prise par rapport un tat de nature: dfinition qui cependant autorise dj le premier mouvement d'une analyse positive, puisque Corvisart en spcifie les formes en altrations de contexture, modifications de symtrie et changements dans la manire d'tre physique et chimique (3). La dgnration ainsi comprise, c'est la courbe extrieure dans laquelle viennent se loger, pour la soutenir et la dessiner, les pointes singulires des phnomnes pathologiques; c'est en mme temps le principe de lecture de leur structure fine. A l'intrieur d'un cadre aussi gnral, le point d'application du concept a t controvers. Dans un mmoire sur les maladies organiques, Martin (4) oppose aux formations tissulaires (d'un type connu ou nouveau) les dgnrations proprement dites qui modifient seulement la forme ou la structure interne du tissu. Cruveilhier, critiquant lui aussi un usage trop flou du terme de dgnration, veut le rserver en revanche cette activit drgle de l'organisme qui
cre des tissus sans analogue dans l'tat de sant; ces tissus qui prsentent en gnral une (1) BUFFON, Histoire naturelle, Oeuvres compltes (Paris, 1848), t. III, p. 311. (2) CORVISART, Essai sur les maladies et lsions organiques du coeur, pp. 636-637. (3) Ibid., p. 636, n. 1. (4) Cf. Bulletin des Sciences mdicales, t. 5 (1810). |PAGE 160 texture lardace, gristre, se trouvent dans les tumeurs, dans les masses Irrgulires formes aux dpens des organes, dans les ulcres ou les fistules (1). Pour Lannec, on peut parler de dgnration dans deux cas prcis : lorsqu'un tissu s'altre en un autre qui existe avec une forme et une localisation diffrentes dans l'organisme (dgnration osseuse des cartilages, graisseuse du foie) ; et lorsqu'un tissu prend une texture et une configuration sans modle prexistant (dgnration tuberculeuse des glandes lymphatiques ou du parenchyme pulmonaire; dgnration squirreuse des ovaires ou des testicules) (2). Mais de toute faon, on ne peut pas parler de dgnration propos d'une superposition pathologique de tissus. Un paississement apparent de la dure-mre n'est pas toujours une ossification; l'examen anatomique, il est possible de dtacher d'une part la lame de l'arachnode et de l'autre la dure-mre: apparat alors un tissu qui s'est. dpos entre les membranes, mais ce n'est pas l'volution dgnre de l'une d'elles. On ne parlera de dgnration qu' propos d'un processus qui se droule l'intrieur de la texture tissulaire; elle est la dimension pathologique de son volution propre. Un tissu dgnre quand il est malade en tant que tissu. On peut caractriser par trois indices cette maladie tissulaire. Elle n'est pas simple chute, ni dviation libre: elle obit des lois: La nature est astreinte des rgles constantes dans la construction comme dans la destruction des tres (3). La lgalit organique n'est donc pas seulement un processus prcaire et fragile; c'est une structure rversible dont les moments tracent un chemin oblig: les phnomnes de la vie suivent des lois jusque dans leurs altrations (4). Chemin jalonn par des figures dont le niveau d'organisation est de plus en plus faible; la morphologie, la premire, s'estompe (ossifications irrgulires) ; puis les diffrenciations intra-organiques (cirrhoses, hpatisation du poumon) ; enfin la cohsion interne du tissu disparat: quand elle est enflamme, la gaine cellulaire des artres se laisse diviser comme du lard (5), et le tissu du foie peut
tre dchir sans effort. A la limite, la dsorganisation devient autodestruction, comme (1) J. CRUVEILHIER, Anatomie pathologique (Paris, 1816), t. I, pp. 7576. (2) R. LANNEC, article Dgnration du Dictionnaire des Sciences mdicales (1814), t. VIII, pp. 201-207. (3) R. LANNEC, Introduction et premier chapitre du Trait indit d'anatomie pathologique (p. 52). (4) DUPUYTREN, Dissertation inaugurale sur quelques points d'anatomie (Paris, an XII), p. 21. (5) LALLEMAND, Recherches anatomo-pathologiques sur l'encphale, I, pp. 88-89. |PAGE 161 dans le cas de la dgnrescence tuberculeuse, o l'ulcration des noyaux provoque non seulement la destruction du parenchyme, mais celle des tubercules eux-mmes. La dgnration n'est donc pas un retour l'inorganique; ou plutt elle n'est ce retour que dans la mesure o elle est infailliblement oriente vers la mort. La dsorganisation qui la caractrise n'est pas celle du non-organique, c'est celle du non-vivant, de la vie en train de s'abolir: On doit nommer phthisie pulmonaire toute lsion du poumon qui, livre elle-mme, produit une dsorganisation progressive de ce viscre il la suite de laquelle surviennent son altration et enfin la mort (1). C'est pourquoi il y a une forme de dgnration qui fait l'accompagnement constant de la vie et dfinit sur toute sa longueur sa confrontation avec la mort: C'est une ide laquelle le plus grand nombre des auteurs n'a pas daign s'arrter que celle de l'altration et de la lsion des parties de nos organes par le fait mme de leur action (2). L'usure est une dimension temporelle ineffaable de l'activit organique: elle mesure le travail sourd qui dsorganise les tissus par le seul fait qu'ils assurent leurs fonctions, et qu'ils rencontrent une foule d'agents extrieurs capables de l' emporter sur leurs rsistances. La mort, peu peu, ds le premier moment de l'action et dans la premire confrontation avec l'extrieur, commence dessiner son imminence: elle ne s'insinue pas seulement sous la forme de l'accident possible; elle forme avec la vie, ses mouvements et son temps, la trame unique qui tout la fois la constitue et la dtruit. La dgnration, c'est au principe mme de la vie la ncessit de la mort qui en est indissociable, et la possibilit la plus gnrale de la maladie. Concept dont le lien avec la mthode anatomo-pathologique apparat maintenant en toute clart. Dans la perception anatomique,
la mort est le point de vue du haut duquel la maladie s'ouvrait sur la vrit; la trinit vie-maladie-mort s'articule en un triangle dont le sommet culmine dans la mort; la perception ne peut saisir en une unit la vie et la maladie que dans la mesure o elle investit la mort dans son propre regard. Et dans les structures perues, on peut retrouver la mme configuration, mais inverse au miroir: la vie avec sa dure relle, la maladie comme possibilit de dviation trouvent leur origine dans le point profondment enfoui de la mort; (1) BAYLE, Recherches sur la phthisie pulmonaire, p. 5. (2) CORVISART, Essai sur les maladies et les lsions organiques du coeur et des gros vaisseaux, Disc. prl., XVII. |PAGE 162 elle commande, d'en dessous, leur existence. La mort, qui, dans le regard anatomique, dit rtroactivement la vrit de la maladie, rend possible par anticipation sa forme relle. Pendant des sicles, la mdecine avait cherch quel mode d'articulation pourrait dfinir les rapports de la maladie et de la vie. Seule l'intervention d'un troisime terme a pu donner leur rencontre, leur coexistence, leurs interfrences, une forme qui ft fonde la fois en possibilit conceptuelle et dans la plnitude perue; ce troisime terme, c'est la mort. A partir d'elle, la maladie prend corps dans un espace qui concide avec celui de l'organisme; elle en suit les lignes et la dcoupe; elle s'organise selon sa gomtrie gnrale; elle s'inflchit aussi bien vers ses singularits. A partir du moment o la mort a t prise dans un organon technique et conceptuel, la maladie a pu tre la fois spatialise et individualise. Espace et individu, deux structures associes, qui drivent ncessairement d'une perception porteuse de mort. En ses mouvements profonds, la maladie suit les obscurs mais ncessaires chemins des ractions tissulaires. Mais que devient maintenant son corps visible, cet ensemble de phnomnes sans secret qui la rendaient pour le regard des cliniciens entirement lisible: c'est--dire reconnaissable par ses signes, mais dchiffrable aussi dans les symptmes dont la totalit dfinissait sans rsidu son essence? Tout ce langage ne risque-t-il pas d'tre allg de son poids spcifique, et rduit une srie d'vnements de surface, sans structure grammaticale ni ncessit smantique? En assignant la maladie de sourds chemins dans le monde clos des corps, l'anatomie pathologique attnue l'importance des symptmes cliniques et substitue, une mthodologie du visible, une exprience plus complexe o la vrit ne sort de son inaccessible rserve que par le passage l'inerte, la violence du cadavre dcoup et par l des
formes o la signification vivante s'efface au profit d'une gomtrie massive. Nouveau renversement des rapports entre signes et symptmes. Dans la mdecine clinique, sous sa forme premire, le signe n'tait pas par nature diffrent des symptmes (1). Toute manifestation de la maladie pouvait sans modification essentielle prendre valeur de signe, condition qu'une lecture mdicale (1) Cf. supra, p. 92. |PAGE 163 informe ft capable de la situer dans la totalit chronologique du mal. Tout symptme tait signe en puissance, et le signe n'tait pas autre chose qu'un symptme lu. Or, dans une perception anatomoclinique, le symptme peut parfaitement rester muet, et le noyau significatif, dont on le croyait arm, se rvler inexistant. Quel symptme visible peut indiquer certainement la phtisie pulmonaire? Ni la difficult de respirer qu'on peut trouver dans un cas de catarrhe chronique, et ne pas trouver chez un tuberculeux; ni la toux qui appartient aussi la pripneumonie, mais pas toujours la phtisie; ni la fivre hectique, frquente dans la pleursie mais qui se dclare souvent de faon tardive chez les phtisiques (1). Le mutisme des symptmes peut tre contourn, mais non pas vaincu. Le signe joue prcisment ce rle de dtour: il n'est plus le symptme parlant, mais ce qui se substitue l'absence fondamentale de parole dans le symptme. Bayle en 1810 avait t contraint de rcuser successivement toutes les indications smiologiques de la phtisie: aucune n'tait vidente ni certaine. Neuf ans plus tard Lannec auscultant une malade qu'il croyait atteinte d'un catarrhe pulmonaire doubl d'une fivre bilieuse a l'impression d'entendre la voix sortir directement de la poitrine, et ceci sur une petite surface d'un pouce carr environ. Peut-tre tait-ce l l'effet d'une lsion pulmonaire, d'une sorte d'ouverture dans le corps du poumon. Il retrouve le mme phnomne chez une vingtaine de phtisiques; puis il le distingue d'un phnomne assez voisin qu'on peut constater chez les pleurtiques : la voix semble galement sortir de la poitrine, mais elle est plus aigu qu'au naturel; elle semble argentine et chevrotante (2). Lannec pose ainsi la pectoriloquie comme seul signe pathognomonique certain de la phtisie pulmonaire, et l'gophonie, comme signe de l'panchement pleurtique. On voit que, dans l'exprience anatomoclinique, le signe a une structure entirement diffrente de celle que lui avait prte, peine quelques annes auparavant, la mthode clinique. Dans la perception de Zimmermann ou de Pinel, le signe
tait d'autant plus loquent, et d'autant plus certain qu'il avait plus de surface dans les manifestations de la maladie: ainsi la fivre tait le symptme majeur et par consquent le signe le plus certain et le plus proche de l'essentiel par lequel on pouvait reconnatre cette srie de maladies, qui portaient justement le nom de fivre. Pour Lannec, la valeur du (1) G.-L. BAYLE, Recherches sur la phthisie pulmonaire, pp. 5-14. (2) LANNEC, Trait de l'auscultation mdiate (Paris, 1819), t. I. |PAGE 164 signe n'a plus de rapport avec l'extension symptomatique; son caractre marginal, restreint, presque imperceptible, lui permet de traverser, comme de biais, le corps visible de la maladie (compos d'lments gnraux et incertains) et d'en atteindre d'un trait la nature. Par le fait mme, il se dpouille de la structure statistique qu'il avait dans la perception clinique pure: pour qu'il pt produire une certitude, un signe devait faire partie d'une srie convergente, et c'tait la configuration alatoire rie l'ensemble qui portait la vrit; le signe, maintenant, parle seul, et ce qu'il prononce est apodictique: la toux, la fivre chronique, l'affaiblissement, les expectorations, l'hmoptysie rendent de plus en plus probable, mais, au bout du compte, jamais tout fait certaine la phtisie; la pectoriloquie, elle seule, la dsigne sans erreur possible. Enfin le signe clinique renvoyait la maladie elle-mme; le signe anatomo-clinique la lsion; et si certaines altrations des tissus sont communes plusieurs maladies, le signe qui les aura mises en vidence ne pourra rien dire sur la nature du trouble: on peut constater une hpatisation du poumon, mais le signe qui l'indique ne dira pas quelle maladie elle est due (1). Le signe ne peut donc que renvoyer une actualit lsionnelle, et jamais une essence pathologique. La perception significative est donc pistmologiquement diffrente dans le monde de la clinique telle qu'elle a exist sous sa premire forme, et telle qu'elle a t modifie par la mthode anatomique. Cette diffrence est sensible jusque dans la manire dont on a pris le pouls avant et aprs Bichat. Pour Menuret le pouls est signe parce qu'il est symptme, c'est--dire dans la mesure o il est manifestation naturelle de la maladie, et o il communique de plein droit avec son essence. Ainsi un pouls plein, fort, rebondissant indique plthore de sang, vigueur des pulsations, encombrement du systme vasculaire, laissant prvoir une hmorragie violente. Le pouls tient par ses causes la constitution de la machine, la plus importante et la plus tendue de ses fonctions; par ses caractres habilement saisis et dvelopps, il met dcouvert tout l'intrieur de l'homme ; grce
lui le mdecin participe la science de l'tre suprme (2). En distinguant les pulsations capitales, pectorales et ventrales, Bordeu ne modifie pas la forme de perception du pouls. Il s'agit toujours de lire un certain tat pathologique (1) A.-F. CHOMEL, Elments de pathologie gnrale (Paris, 1817), pp. 522 523. (2) MENURET, Nouveau trait du pouls (Amsterdam, 1768), pp. IX-X. |PAGE 165 dans le cours de son volution et de prvoir son dveloppement avec la meilleure des probabilits; ainsi le pouls pectoral simple est mou, plein, dilat; les pulsations sont gales mais ondulantes, formant une sorte de double vague avec une aisance, une mollesse et une douce force d'oscillation qui ne permettent pas de confondre cette espce de pouls avec les autres (1). C'est l'annonce d'une vacuation dans la rgion de la poitrine. Corvisart au contraire prenant le pouls de son malade, ce n'est pas le symptme d'une affection qu'il interroge, mais le signe d'une lsion. Le pouls n'a plus de valeur expressive dans ses qualits de mollesse ou de plnitude; mais l'exprience anatomo-clinique a permis d'tablir le tableau des correspondances biunivoques entre l'allure des pulsations et chaque type lsionnel: le pouls est fort, dur, vibrant, frquent dans les anvrismes actifs sans complication; mou, lent, rgulier, facile touffer dans les anvrismes passifs simples; irrgulier, ingal, ondulant dans les rtrcissements permanents; intermittent, irrgulier par intervalles dans les rtrcissements momentans; faible et peine sensible dans les endurcissements, les ossifications, le ramollissement; rapide, frquent, drgl et comme convulsif en cas de rupture d'un ou plusieurs faisceaux charnus (2). Il ne s'agit plus l d'une science analogue celle de l'Etre Suprme, et conforme aux lois des mouvements naturels, mais de la formulation d'un certain nombre de perceptions signaltiques. Le signe ne parle plus le langage naturel de la maladie; il ne prend forme et valeur qu' l'intrieur des interrogations poses par l'investigation mdicale. Rien n'empche donc qu'il soit sollicit et presque fabriqu par elle. Il n'est plus ce qui, de la maladie, s'nonce spontanment; mais le point de rencontre provoqu entre les gestes de la recherche et l'organisme malade. Ainsi s'explique que Corvisart ait pu ractiver, sans problme thorique majeur, la dcouverte relativement ancienne et oublie d'Auenbrugger. Cette dcouverte reposait sur des connaissances pathologiques bien acquises: la diminution du volume d'air contenu par la cavit thoracique dans beaucoup d'affections pulmonaires; elle s'expliquait aussi par une
donne de l'exprience simple: la percussion d'un tonneau, lorsque le son devient mat, indique quelle hauteur il est rempli; enfin, elle se justifiait par une exprimentation sur le cadavre: Si (1) BORDEU, Recherches sur le pouls (Paris, 1771), t. I, pp. 30-31. (2) CORVISART, Essai sur les maladies et les lsions organiques du Coeur, pp. 397.398. |PAGE 166 dans un corps quelconque la cavit sonore du thorax est remplie d'un liquide par le moyen d'une injection, alors le son, du ct de la poitrine qui aura t rempli, deviendra obscur la hauteur qu'atteindra le liquide inject (1). Il tait normal que la mdecine clinique la fin du XVIIIe sicle laisse dans l'ombre cette technique qui faisait artificieusement surgir un signe l o il n'y avait pas de symptme, et sollicitait une rponse quand la maladie ne parlait pas d'elle-mme: clinique aussi expectante dans sa lecture que dans sa thrapeutique. Mais partir du moment o l'anatomie pathologique prescrit la clinique d'interroger le corps dans son paisseur organique, et de faire affleurer la surface ce qui n'tait donn qu'en couches profondes, l'ide d'un artifice technique capable de surprendre la lsion redevient une ide scientifiquement fonde. Le retour Auenbrugger s'explique dans la mme rorganisation des structures que le retour Morgagni. La percussion ne se justifie pas si la maladie n'est faite que d'une trame de symptmes; elle devient ncessaire si le malade n'est gure autre chose qu'un cadavre inject, tonneau moiti plein. Etablir ces signes, artificiels ou naturels, c'est jeter sur le corps vivant tout un rseau de reprages anatomo-pathologiques : dessiner en pointill l'autopsie future. Le problme est donc de faire affleurer en surface ce qui s'tage en profondeur; la smiologie ne sera plus une lecture, mais cet ensemble de techniques qui permet de constituer une anatomie pathologique projective. Le regard du clinicien se portait sur une suite et sur une plage d'vnements pathologiques; il devait tre synchronique et diachronique la fois, mais de toute faon il tait plac dans une obdience temporelle; il analysait une srie. Le regard de l'anatomo-clinicien devra reprer un volume; il aura affaire la complexit de donnes spatiales qui pour la premire fois en mdecine sont tridimensionnelles. Alors que l'exprience clinique impliquait la constitution d'une trame mixte du visible et du lisible, la nouvelle smiologie exige une sorte de triangulation sensorielle laquelle doivent collaborer des atlas divers, et jusqu'alors exclus des techniques mdicales: l'oreille et le toucher viennent s'ajouter la vue.
Depuis des dizaines de sicles, les mdecins, aprs tout, gotaient les urines. Trs tard, ils se sont mis toucher, frapper, couter. Interdits moraux, enfin levs par les progrs des (1) AUENBRUGGER, Nouvelle mthode pour reconnatre les maladies internes de la poitrine (trad. CORVISART, Paris, 1808), p. 70. |PAGE 167 Lumires? On comprendrait mal, si telle tait l'explication, que Corvisart, sous l'Empire, ait r invent la percussion, et que Lannec, sous la Restauration, ait pench l'oreille, pour la premire fois, vers la poitrine des femmes. L'obstacle moral n'a t prouv qu'une fois constitu le besoin pistmologique; la ncessit scientifique a mis au jour l'interdit comme tel: le savoir invente le secret. Zimmermann dj souhaitait pour connatre la force de la circulation que les mdecins eussent la libert de faire leurs observations cet gard en portant immdiatement la main sur le coeur ; mais il constatait que nos moeurs dlicates nous en empchent, surtout chez les femmes (1). Double, en 1811, critique cette fausse modestie, et cette excessive retenue non qu'il estime permise une pareille pratique sans rserve aucune; mais cette exploration qui se fait trs exactement au-dessus de la chemise peut avoir lieu avec toute la dcence possible (2). L'cran moral, dont la ncessit est reconnue, va devenir mdiation technique. La libido sciendi, toute renforce de l'interdit qu'elle a suscite et dcouvert, le tourne en le rendant plus imprieux; elle lui donne des justifications scientifiques et sociales, l'inscrit dans la ncessit pour mieux feindre de l'effacer de l'thique et btit sur lui la structure qui le traverse en le maintenant. Ce n'est plus la pudeur qui empche le contact, mais la salet et la misre; non plus l'innocence, mais la disgrce des corps. Immdiate, l'auscultation est aussi incommode pour le mdecin que pour le malade; le dgot seul la rend peu prs impraticable dans les hpitaux; elle est peine proposable chez la plupart des femmes, et chez quelques-unes mme, le volume des mamelles est un obstacle physique ce qu'on puisse l'employer. Le stthoscope mesure un interdit transform en dgot, et un empchement matriel: Je fus consult en 1816 par une jeune personne qui prsentait des symptmes de maladie de coeur, et chez laquelle l'application de la main et la percussion donnaient peu de rsultats raison de l'embonpoint. L'ge et le sexe de la malade m'interdisant l'espce d'examen dont je viens de parler (l'application de l'oreille la rgion prcordiale), je vins me rappeler un phnomne d'acoustique fort connu: si l'on applique l'oreille l'extrmit d'une poutre, on entend trs distinctement un coup d'pingle donn l'autre bout (3). Le
stthoscope, distance solidifie, transmet des vnements (1) ZIMMERMANN, Trait de l'exprience mdicale, II, p. 8. (2) F .-J. DOUBLE, Smiologie gnrale. (3) R. LANNEC, Trait de l'auscultation mdiate, t. I, pp. 7-8. |PAGE 168 profonds et invisibles le long d'un axe mi-tactile, mi-auditif. La mdiation instrumentale l'extrieur du corps autorise un recul qui en mesure une distance morale; l'interdiction d'un contact physique permet de fixer l'image virtuelle de ce qui se passe loin en dessous de la plage visible. Le lointain de la pudeur est, pour le cach, un cran de projection. Ce qu'on ne peut pas voir se montre dans la distance de ce qu'on ne doit pas voir. Le regard mdical, ainsi arm, enveloppe plus que ne le dit le seul mot de regard. Il serre en une structure unique des champs sensoriels diffrents. La trinit vue-toucher-audition dfinit une configuration perceptive o le mal inaccessible est traqu par des repres, jaug en profondeur, tir la surface et projet virtuellement sur les organes disperss du cadavre. Le coup d'oeil est devenu une organisation complexe aux fins d'assignation spatiale de l'invisible. Chaque organe des sens reoit une fonction instrumentale partielle. Et l'oeil n'a certainement pas la plus importante; la vue, que peut-elle couvrir d'autre que le tissu de la peau et le commencement des membranes ? Le toucher, lui, permet de reprer les tumeurs viscrales, les masses squirreuses, les gonflements de l'ovaire, les dilatations du coeur; quant l'oreille, elle peroit la crpitation des fragments osseux, les bruissements de l'anvrisme, les sons plus ou moins clairs du thorax et de l'abdomen quand on les percute (1) ; le regard mdical est dou dsormais d'une structure plurisensorielle. Regard qui touche, entend et, de surcrot, non par essence ou ncessit, voit. Une fois n'est pas coutume; je citerai un historien de la mdecine: Aussitt qu'avec l'oreille ou avec le doigt, on peut reconnatre sur le vivant ce que rvlait la dissection sur le cadavre, la description des maladies et par consquent la thrapeutique entrrent dans une voie toute nouvelle (2). Il ne faut pas laisser chapper l'essentiel. Les dimensions tactile et auditive ne sont pas venues s'ajouter purement et simplement au domaine de la vision. La triangulation sensorielle indispensable la perception anatomo-clinique demeure sous le signe dominant du visible: d'abord, parce que cette perception multisensorielle n'est qu'une manire d'anticiper sur ce triomphe (1) A.-F. CHOMEL, Elments de pathologie gnrale (Paris, 1817), pp.
30-31. (2) Ch. DAREMBERG, Histoire des sciences mdicales (Paris, 1870), II, p. 1066. |PAGE 169 du regard que sera l'autopsie; l'oreille et la main ne sont que des organes provisoires de remplacement en attendant que la mort rende la vrit la prsence lumineuse du visible; il s'agit d'un reprage dans la vie, c'est--dire dans la nuit, pour indiquer ce que seraient les choses dans la clart blanche de la mort. Et surtout, les altrations dcouvertes par l'anatomie concernent la forme, la grandeur, la position et la direction des organes ou de leurs tissus (1) : c'est-dire des donnes spatiales qui relvent par droit d'origine du regard. Quand Lannec parle des altrations de structure, il ne s'agit jamais de ce qui est au-del du visible, ni mme de ce qui serait sensible un toucher dli, mais de solutions de continuit, d'accumulations de liquides, d'accroissements anormaux, ou d'inflammations signales par le gonflement du tissu et leur rougeur (2). De toute faon, la limite absolue, le fond de l'exploration perceptive sont dessins toujours par le plan clair d'une visibilit au moins virtuelle. C'est une image qu'ils se peignent, dit Bichat en parlant des anatomistes,plutt que des choses qu'ils apprennent. Ils doivent plus voir que mditer (3). Lorsque Corvisart entend un coeur qui fonctionne mal, Lannec une voix aigu qui tremble, c'est une hypertrophie, c'est un panchement qu'ils voient, de ce regard qui hante secrtement leur audition et au-del d'elle l'anime. Ainsi le regard mdical, depuis la dcouverte de l'anatomie pathologique, se trouve ddoubl: il y a un regard local et circonscrit, le regard limitrophe du toucher et de l'audition, qui ne recouvre que l'un des champs sensoriels, et n'effleure gure que les surfaces visibles. Mais il y a un regard absolu, absolument intgrant, qui domine et fonde toutes les expriences perceptives. C'est lui qui structure en une unit souveraine ce qui relve un plus bas niveau de l'oeil, de l'oreille et du tact. Quand le mdecin observe, tous ses sens ouverts, un autre oeil est pos sur la fondamentale visibilit des choses et, travers la donne transparente de la vie avec laquelle les sens particuliers sont contraints de biaiser, il s'adresse sans ruse ni dtour la claire solidit de la mort. La structure la fois perceptive et pistmologique qui commande l'anatomie clinique et toute la mdecine drivant d'elle, c'est celle de l'invisible visibilit. La vrit qui, par droit (1) X. BICHAT, Essai sur Desault, in Oeuvres chirurgicales de Desault (1798), I, pp. 10 et 11.
(2) LANNEC, Dictionnaire des Sciences mdicales, t. II, article Anatomie pathologique, p. 52. (3) X. BICHAT, Essai Sur Desault, in Oeuvres chirurgicales de Desault, I, p. 11. |PAGE 170 de nature, est faite pour l'oeil, lui est drobe, mais subrepticement aussitt rvle par ce qui tente de l'esquiver. Le savoir se dveloppe selon tout un jeu d'enveloppes; l'lment cach prend la forme et le rythme du contenu cach, ce qui fait qu'il est de la nature mme du voile d'tre transparent (1) : le but des anatomistes est atteint lorsque les opaques enveloppes qui couvrent nos parties ne sont plus leurs yeux exercs qu'un voile transparent qui laisse dcouvert l'ensemble et les rapports (2). Les sens particuliers guettent travers ces enveloppes, tentent de les contourner ou de les soulever; leur allgre curiosit invente mille moyens, jusqu' se servir impudemment (tmoin le stthoscope) de la pudeur. Mais l'oeil absolu du savoir a dj confisqu et repris dans sa gomtrie de lignes, de surfaces et de volumes, les voix rauques ou aigus, les sifflements, les palpitations, les peaux rches et tendres, les cris. Suzerainet du visible. Et d'autant plus imprieuse qu'elle y associe le pouvoir de la mort. Ce qui cache et enveloppe, le rideau de nuit sur la vrit, c'est paradoxalement la vie; et la mort, au contraire, ouvre la lumire du jour le noir coffre des corps: obscure vie, mort limpide, les plus vieilles valeurs imaginaires du monde occidental se croisent l en trange contresens qui est le sens mme de l'anatomie pathologique, si on convient de la traiter comme un fait de civilisation du mme ordre, et pourquoi pas, que la transformation d'une culture incinrante en culture inhumante. La mdecine du XIXe sicle a t hante par cet oeil absolu qui cadavrise la vie et retrouve dans le cadavre la frle nervure rompue de la vie. Jadis les mdecins communiquaient avec la mort par le grand mythe de l'immortalit ou du moins des limites de l'existence peu peu recules (3), Maintenant, ces hommes qui veillent sur la vie des hommes communiquent avec leur mort sous la forme menue et rigoureuse du regard. Cette projection du mal sur le plan de l'absolue visibilit donne cependant l'exprience mdicale un fond opaque au-del duquel il ne lui est plus possible de se prolonger. Ce qui n'est pas l'chelle du regard tombe hors du domaine du savoir possible. D'o Je rejet d'un certain nombre de techniques scientifiques (1) Cette structure ne date pas, il s'en faut, du dbut du XIXe sicle; dans sa silhouette gnrale, elle domine les formes du savoir et de
l'rotisme en Europe depuis le milieu du XVIIIe sicle, et elle prvaut jusqu' la fin du XIXe sicle. Nous essaierons de l'tudier plus tard. (2) X. BICHAT, Essai sur Desault, in Oeuvres chirurgicales de Desault, I, p. 11. (3) Cf. encore la fin du XVIIIe sicle un texte comme celui de HUFELAND, .Makrobiotik oder der Kunst das Leben zu verlngern (Ina, 1796). |PAGE 171 que pourtant les mdecins utilisaient au cours des annes prcdentes. Bichat refuse mme l'usage du microscope: Quand on regarde dans l'obscurit chacun voit sa manire (1). Le seul type de visibilit reconnu par l'anatomie pathologique, c'est celui qui est dfini par le regard quotidien: une visibilit de droit qui enveloppe dans une invisibilit provisoire une opaque transparence, et non pas (comme dans l'investigation microscopique) une invisibilit de nature que force, pour un temps, une technique du regard artificiellement multipli. D'une manire qui nous parat trange, mais qui est structurale ment ncessaire, l'analyse des tissus pathologiques se passa, pendant des annes, des instruments mme les plus anciens de l'optique. Plus significatif encore le refus de la chimie. L'analyse, la manire de Lavoisier, a servi de modle pistmologique la nouvelle anatomie (2), mais elle n'a pas fonctionn comme prolongement technique de son regard. Dans la mdecine du XVIIIe sicle, les ides exprimentales taient nombreuses; quand on voulait savoir en quoi consistait la fivre inflammatoire, on faisait des analyses de sang: on comparait le poids moyen de la masse coagule et celui de la lymphe qui s'en spare ; on faisait des distillations et on mesurait les masses de sel fixe et volatil, d'huile et de terre trouves chez un malade et chez un sujet sain (3). Au dbut du XIXe sicle cet appareil exprimental disparat, et le seul problme technique qui se pose est de savoir si l'ouverture du cadavre le malade atteint de fivre inflammatoire portera ou non des altrations visibles. Pour caractriser une lsion morbifique, explique Lannec, il suffit ordinairement de dcrire ses caractres physiques ou sensibles et d'indiquer la marche qu'elle suit dans son dveloppement et ses terminaisons ; tout au plus a-t-on loisir d'utiliser certains ractifs chimiques condition qu'ils soient trs simples et destins seulement faire ressortir quelques caractres physiques : ainsi on peut chauffer un foie, ou verser un acide sur une dgnrescence dont on ignore si elle est graisseuse ou albumineuse (4). Le regard, lui seul, domine tout le champ du savoir possible;
l'intervention des techniques qui posent des problmes de mesure, de substance, de composition, au niveau des structures invisibles (1) X. BICHAT, Trait des membranes (Paris, an VIII), p. 321. (2) Cf. supra, chap. VIII. (3) Expriences de Langrish et de Tabor cites par SAUVAGES, Nosologie mthodique, t. II, pp. 331-333. (4) R. LANNEC, Introduction et chapitre I du Trait indit d'anatomie pathologique (publi par V. CORNIL, Paris, 1884), pp. 16-17. |PAGE 172 est mise hors circuit. L'analyse ne se fait pas dans le sens d'un approfondissement indfini vers les configurations les plus fines, et jusqu' celles de l'inorganique; dans cette direction, elle se heurte trs tt l'absolue limite que lui prescrit le regard, et de l, prenant la perpendiculaire, elle glisse latralement vers la diffrenciation des qualits individuelles. Sur la ligne o le visible est prt se rsoudre dans l'invisible, sur cette crte de son vanouissement, les singularits viennent jouer. Un discours sur l'individu est nouveau possible, ou plutt ncessaire, parce qu'il est la seule manire pour le regard de ne pas renoncer lui-mme, de ne pas s'abolir dans des figures d'exprience o il serait dsarm. Le principe de la visibilit a pour corrlatif celui de la lecture diffrentielle des cas. Lecture dont le processus est trs diffrent de l'exprience clinique sous sa forme premire. La mthode analytique considrait le cas dans sa seule fonction de support smantique; les formes de la coexistence ou de la srie dans lesquelles il tait pris permettaient d'annuler en lui ce qu'il pouvait comporter d'accidentel ou de variable; sa structure lisible n'apparaissait que dans la neutralisation de ce qui n'tait pas l'essentiel. La clinique tait science des cas dans la mesure o elle procdait initialement au feutrage des individualits. Dans la mthode anatomique, la perception individuelle est donne au terme d'un quadrillage spatial dont elle constitue la structure la plus fine, la plus diffrencie, et paradoxalement, la plus ouverte l'accidentel tout en tant la plus explicative. Lannec observe une femme qui prsente les symptmes caractristiques d'une affection cardiaque: face ple et bouffie, lvres violettes, extrmits infrieures infiltres, respiration courte, acclre, haletante, quintes de toux, coucher en supination impossible. L'ouverture du cadavre montre une phtisie pulmonaire avec cavits concrteuses et tubercules jauntres au centre, gris et transparents la circonfrence. Le coeur tait dans un tat peu prs naturel ( l'exception de l'oreillette droite fortement distendue). Mais le poumon gauche adhrait la plvre par une bride celluleuse
et offrait cet endroit des stries irrgulires et convergentes; le sommet du poumon prsentait des lames assez larges et entrecroises (1). Cette modalit particulire de la lsion tuberculeuse rendait compte de la respiration gne, un peu suffocante, des altrations circulatoires, qui donnaient au tableau clinique une allure nettement cardiaque. La mthode (1) R. LANNEC, De l'auscultation mdiate, t. I, pp. 72-76. |PAGE 173 anatomo-clinique intgre la structure de la maladie la constante possibilit d'une modulation individuelle. Cette possibilit existait, certes, dans la mdecine antrieure: mais elle n'tait pense que sous la forme abstraite du temprament du sujet, ou des influences dues au milieu, ou des interventions thrapeutiques, charges de modifier de l'extrieur un type pathologique. Dans la perception anatomique, la maladie n'est jamais donne qu'avec un certain boug; elle a, d'entre de jeu, une latitude d'insertion, de cheminement, d'intensit, d'acclration qui dessine sa figure individuelle. Celle-ci n'est pas une dviation surajoute la dviation pathologique; la maladie est elle-mme perptuelle dviation l'intrieur de sa nature essentiellement dviante. Il n'y a de maladie qu'individuelle: non parce que l'individu ragit sur sa propre maladie, mais parce que l'action de la maladie se droule, de plein droit, dans la forme de l'individualit. De l, la flexion nouvelle donne au langage mdical. Il ne s'agit plus, par une mise en correspondance biunivoque, de promouvoir le visible en lisible, et de le faire passer au significatif par l'universalit d'un langage codifi; mais d'ouvrir au contraire les mots sur un certain raffinement qualitatif, toujours plus concret, plus individuel, plus model; importance de la couleur, de la consistance, du grain, prfrence accorde la mtaphore sur la mesure (gros comme..., de la taille de...) ; apprciation de l'aisance ou de la difficult dans des oprations simples (dchirer, craser, presser) ; valeur des qualits intersensorielles (lisse, onctueux, bossel) ; comparaisons empiriques et rfrences au quotidien ou au normal (plus fonc qu' l'tat naturel, sensation intermdiaire entre celle d'une vessie humide demi pleine d'air que l'on presse entre les doigts et la crpitation naturelle d'un tissu pulmonaire l'tat sain) (1). Il ne s'agit plus de mettre en corrlation un secteur perceptif et un lment smantique, mais de retourner entirement le langage vers cette rgion o le peru, en sa singularit, risque d'chapper la forme du mot et de devenir finalement imperceptible force de ne pouvoir tre dit. Si
bien que dcouvrir ne sera plus lire enfin, sous un dsordre, une cohrence essentielle, mais pousser un peu plus loin la ligne d'cume du langage, la faire mordre sur cette rgion de sable qui est encore ouverte la clart de la perception, mais ne l'est plus dj la parole familire. Introduire le langage dans cette pnombre o le regard n'a plus de mots. (1) Ibid., p. 249. |PAGE 174 Travail dur et tnu ; travail qui fait voir, comme Lannec fit voir distinctement, hors de la masse confuse des squirres, le premier foie cirrhotique dans l'histoire de la perception mdicale. L'extraordinaire beaut formelle du texte lie, en un seul mouvement, le labeur intrieur d'un langage qui pourchasse la perception de toute la force de sa recherche stylistique et la conqute d'une individualit pathologique jusqu'alors inaperue: Le foie rduit au tiers de son volume se trouvait pour ainsi dire cach dans la rgion qu'il occupe; sa surface externe, lgrement mamelonne et vide, offrait une teinte grise jauntre; incis, il paraissait entirement compos d'une multitude de petits grains de forme ronde ou ovode, dont la grosseur variait depuis celle d'un grain de millet jusqu' celle d'un grain de chnevis. Ces grains, faciles sparer les uns des autres, ne laissaient entre eux presque aucun intervalle dans lequel on pt distinguer encore quelque reste de tissu propre du foie; leur couleur tait fauve ou d'un jaune roux tirant par endroits sur le verdtre; leur tissu, assez humide, opaque, tait flasque au toucher plutt que mou, et en pressant les grains entre les doigts, on n'en crasait qu'une petite partie, le reste offrait au tact la sensation d'Un morceau de cuir mou (1). La figure de l'invisible visible organise la perception anatomopathologique. Mais, on le voit, selon une structure rversible. Il s'agit du visible que l'individualit vivante, le croisement des symptmes, la profondeur organique rendent invisible en fait et pour un temps, avant la reprise souveraine du regard anatomique. Mais il s'agit aussi bien de cet invisible des modulations individuelles, dont le dbrouillage paraissait impossible mme un clinicien comme Cabanis (2), et que l'effort d'un langage incisif, patient et rongeur, offre enfin la clart commune de ce qui est pour tous visible. Le langage et la mort ont jou chaque niveau de cette exprience, et selon toute son paisseur, pour offrir enfin une perception scientifique ce qui pour elle tait rest si longtemps l'invisible visible -interdit et imminent secret: le savoir de l'individu.
L'individu, ce n'est pas la forme initiale et la plus aigu en laquelle se prsente la vie. Il n'est donn enfin au savoir qu'au terme d'un long mouvement de spatialisation dont les instruments (1) Ibid., p. 368. (2) Cf. supra. |PAGE 175 dcisifs ont t un certain usage du langage et une conceptualisation difficile de la mort. Bergson est strictement contresens quand il cherche dans le temps et contre l'espace, dans une saisie de l'intrieur et muette, dans une chevauche folle vers l'immortalit, les conditions auxquelles il est possible de penser l'individualit vivante. Bichat, un sicle auparavant, donnait une leon plus svre. La vieille loi aristotlicienne, qui interdisait sur l'individu le discours scientifique, a t leve lorsque, dans le langage, la mort a trouv le lieu de son concept: l'espace alors a ouvert au regard la forme diffrencie de l'individu. Selon l'ordre des correspondances historiques, cette introduction de la mort dans le savoir se prolonge loin: la fin du XVIIIe sicle remet jour un thme qui, depuis la Renaissance, tait rest dans l'ombre. Voir dans la vie la mort, dans son changement l'immobilit, et, au terme de son temps, le dbut d'un temps renvers qui grouille de vies innombrables, c'est le jeu d'une exprience dont le sicle pass atteste la rapparition, quatre cents ans aprs les fresques du Campo Santo. Bichat, en somme, n'est-il pas le contemporain de celui qui fit entrer d'un coup, dans le plus discursif des langages, l'rotisme et son invitable pointe, la mort? Une fois de plus, le savoir et l'rotisme dnoncent, dans cette concidence, leur profonde parent. Dans les toutes dernires annes du XVIIIe sicle, cette appartenance ouvre la mort la tche et aux recommencements infinis du langage. Le XIXe sicle parlera avec obstination de la mort: mort sauvage et chtre de Goya, mort visible, muscle, sculpturale chez Gricault, mort voluptueuse des incendies chez Delacroix, mort lamartinienne des effusions aquatiques, mort de Baudelaire. Connatre la vie n'est donn qu' un savoir cruel, rducteur et dj infernal qui la dsire seulement morte. Le regard qui enveloppe, caresse, dtaille, anatomise la chair la plus individuelle et relve ses secrtes morsures, c'est ce regard fixe, attentif, un peu dilat, qui, du haut de la mort, a dj condamn la vie. Mais la perception de la mort dans la vie n'a pas la mme fonction au XIXe sicle qu' la Renaissance. Elle portait alors des significations rductrices: la diffrence de destin, de la fortune, des conditions tait efface par son geste universel; elle tirait irrvocablement chacun
vers tous; les danses des squelettes figuraient, l'envers de la vie, des sortes de saturnales galitaires ; la mort, infailliblement, compensait le sort. Maintenant elle est constitutive au contraire de singularit; c'est en elle |PAGE 176 que l'individu se rejoint, chappant aux vies monotones et leur nivellement; dans l'approche lente, moiti souterraine, mais visible dj de la mort, la sourde vie commune devient enfin individualit; un cerne noir l'isole et lui donne le style de sa vrit. De l, l'importance du Morbide. Le Macabre impliquait une perception homogne de la mort, une fois son seuil franchi. Le Morbide autorise une perception subtile de la manire dont la vie trouve dans la mort sa figure la plus diffrencie. Le morbide, c'est la forme rarfie de la vie; en ce sens que l'existence s'puise, s'extnue dans le vide de la mort; mais en cet autre sens galement, qu'elle y prend son volume trange, irrductible aux conformits et aux habitudes, aux ncessits reues; un volume singulier, que dfinit son absolue raret. Privilge du phtisique: jadis on contractait la lpre sur fond des grands chtiments collectifs; l'homme du XIXe sicle devient pulmonaire en accomplissant, dans cette fivre qui hte les choses et les trahit, son incommunicable secret. C'est pourquoi les maladies de poitrine sont de mme nature exactement que celles de l'amour: elles sont la passion, vie qui la mort donne un visage qui ne s'change pas. La mort a quitt son vieux ciel tragique; la voil devenue le noyau lyrique de l'homme: son invisible vrit, son visible secret. |PAGE 177 CHAPITRE X La Crise des Fivres Chapitre o il sera question du dernier processus par lequel la perception anatomo-clinique trouve la forme de son quilibre. Chapitre qui serait long si on se laissait gagner par le dtail des vnements: pendant prs de vingt-cinq ans (de 1808, date o parait l' Histoire des phlegmasies chroniques, jusqu'en 1832 o les discussions sur le cholra prennent la relve) la thorie des fivres essentielles et sa critique par Broussais occupent une surface considrable dans la recherche mdicale; plus considrable, sans doute, que n'aurait d l'autoriser un problme assez vite rgl au niveau de l'observation; mais tant de polmiques, une telle difficult s'entendre quand on tait d'accord sur les faits, un usage si ample
d'arguments trangers au domaine de la pathologie, tout cela indique un affrontement essentiel, le dernier des conflits (le plus violent et le plus embrouill) entre deux types incompatibles d'exprience mdicale. La mthode constitue par Bichat et ses premiers successeurs laissait ouvertes deux sries de problmes. Les premiers concernaient l'tre mme de la maladie et son rapport aux phnomnes lsionnels. Quand on constate un panchement sreux, un foie dgnr, un poumon lacunaire, est-ce bien la pleursie, la cirrhose, la phtisie que l'on voit elles-mmes et jusque dans leur fond pathologique? La lsion est-elle la forme originaire et tridimensionnelle de la maladie dont l'tre serait ainsi de nature spatiale -ou bien doit-on la situer aussitt au-del, dans la rgion des causes prochaines, ou immdiatement en de, comme la premire manifestation visible d'un processus qui resterait cach? On voit clairement -mais aprs coup quelle rponse prescrit la logique de la perception anatomo|PAGE 178 clinique: pour ceux qui s'exeraient cette perception pour la premire fois dans l'histoire de la mdecine, les choses n'taient pas si claires. M.-A. Petit, qui fondait toute sa conception de la fivre entro-msentrique sur des observations d'anatomie pathologique, pense n'avoir pas dcouvert, dans les lsions intestinales accompagnant certaines fivres dites adynamiques ou ataxiques, l'essence mme de la maladie, ni son indpassable vrit; il s'agit l seulement de son sige, et cette dtermination gographique est moins importante pour la connaissance mdicale que l'ensemble gnral des symptmes qui distinguent les maladies les unes des autres et en font connatre le vritable caractre : ce point que la thrapeutique s'gare quand elle s'attaque aux lsions intestinales, au lieu de suivre les indications de la symptomatologie qui rclame des toniques (1). Le sige n'est que l'insertion spatiale de la maladie; ce sont les autres manifestations morbides qui dsignent son essence. Celle-ci reste le grand pralable qui fait le lien entre causes et symptmes, repoussant ainsi la lsion dans le domaine de l'accidentel; l'attaque tissulaire ou organique ne marque que le point d'abordage de la maladie, la rgion d'o va se dvelopper son entreprise de colonisation: Entre l'hpatisation du poumon et les causes qui la provoquent, il se passe quelque chose qui nous chappe; il en est de mme de toutes les lsions qu'on rencontre l'ouverture des corps; loin d'tre la cause premire de tous les phnomnes qu'on a observs, elles sont elles-mmes l'effet d'un
trouble particulier dans l'action intime de nos organes; or cette action ultime se soustrait tous nos moyens d'investigation (2). A mesure que l'anatomie pathologique en situe mieux le sige, il semble que la maladie se retire plus profondment dans l'intimit d'un processus inaccessible. Il y a une autre srie de questions: toutes les maladies ont elles leur corrlatif lsionnel? La possibilit de leur assigner un sige est-elle un principe gnral de la pathologie, ou ne concerne-t-elle qu'un groupe bien particulier de phnomnes morbides? Et dans ce cas ne peut-on commencer l'tude des maladies par une classification de type nosographique (troubles organiques -troubles non organiques) avant d'entrer dans le domaine de l'anatomie pathologique? Bichat avait fait place aux maladies sans lsion -mais il ne les traitait gure que par prtrition: (1) M.-A. PETIT, Trait de la fivre entro-msentrique (,Paris, 1812), pp. 147-148. (2) A.-F. CHOMEL, Elments de pathologie gnrale (Paris, 1817), p. 523. |PAGE 179 tez certains genres de fivres et d'affections nerveuses: tout est presque alors du domaine de celte science (l'anatomie pathologique) (1). D'entre de jeu, Lannec admet la division des maladies en deux grandes classes: celles qui sont accompagnes d'une lsion vidente dans un ou plusieurs organes: ce sont celles que l'on dsigne depuis plusieurs annes sous le nom de maladies organiques; celles qui ne laissent dans aucune partie du corps une altration constante et laquelle on puisse apporter leur origine: ce sont celles que l'on appelle communment maladies nerveuses (2). A l'poque o Lannec rdige ce texte (1812), il n'a pas encore pris dfinitivement parti propos des fivres: il est proche encore des localisateurs dont il se sparera bientt. Bayle, au mme moment, distingue l'organique, non du nerveux, mais du vital, et oppose aux lsions organiques, vices des solides (tumfactions par exemple), les dsordres vitaux, altrations des proprits vitales ou des fonctions (douleur, chaleur, acclration du pouls) ; les unes et les autres peuvent se superposer comme dans la phtisie (3). C'est cette classification que reprendra bientt Cruveilhier, sous une forme un peu plus complexe: lsions organiques, simples et mcaniques (fractures), lsions primitivement organiques et secondairement vitales (hmorragies); affections primitivement vitales doubles de lsions organiques, soit profondes (phlegmasies chroniques), soit superficielles (phlegmasies aigus) ; enfin maladies vitales sans
aucune lsion (nvroses et fivres) (4). On avait beau dire que le domaine tout entier de la nosologie demeurait sous le contrle de l'anatomie pathologique, et qu'une maladie vitale ne pouvait tre prouve comme telle que ngativement, et par l'chec dans la recherche des lsions, il n'en restait pas moins que mme par ce dtour on retrouvait une forme d'analyse classificatrice. Son espce -non pas son sige, ni sa cause -dterminait la nature de la maladie; et le fait mme d'avoir ou non un foyer localisable tait prescrit par les formes pralables de cette dtermination. La lsion n'tait pas la maladie, mais seulement la premire des manifestations par lesquelles apparaissait ce caractre gnrique qui l'opposait aux affections sans support. Paradoxalement, le souci des anatomo-pathologistes (1) BICHAT, Anatomie gnrale, t. l, p. XCVIII. (2) LANNEC, article Anatomie pathologique du Dictionnaire des Sciences mdicales, t. II, p. 47. (3) BAYLE, 2e article. Anatomie pathologique (ibid., p. 62). (4) J. CRUVEILHIER, Essai sur l'anatomie pathologique (Paris, 1816), I, pp. 21-24. |PAGE 180 redonnait vigueur l'ide classificatrice. C'est l que l'oeuvre de Pinel prend son sens et son curieux prestige. Forme Montpellier et Paris dans la tradition de Sauvages et sous l'influence plus rcente de Cullen, la pense de Pinel est de structure classificatrice; mais elle a eu l'infortune et la chance la fois de se dvelopper l'poque o le thme clinique puis la mthode anatomo-clinique privaient la nosologie de son contenu rel, mais non sans des effets, provisoires d'ailleurs, de renforce ment rciproque: nous avons vu comment l'ide de classe tait corrlative d'une certaine observation neutre des symptmes (1), comment le dchiffrement clinique impliquait une lecture d'essences (2) ; nous voyons maintenant comment l'anatomie pathologique s'ordonne spontanment une certaine forme de nosographie. Or, toute l'oeuvre de Pinel doit sa vigueur chacun de ses renforcements: sa mthode ne requiert que secondairement la clinique ou l'anatomie des lsions; fondamentalement il s'agit de l'organisation, selon une cohrence relle mais abstraite, des structures transitoires par lesquelles le regard clinique ou la perception anatomo-pathologique ont cherch, dans la nosologie dj existante, leur support ou leur quilibre d'un instant. Nul parmi les mdecins de la vieille cole ne fut plus sensible que Pinel et plus accueillant aux formes nouvelles de l'exprience mdicale; il fut
volontiers professeur de clinique, et, sans trop de rticence, il faisait pratiquer des autopsies; mais il ne percevait que des effets de rcurrence, ne suivant, dans la naissance des structures nouvelles, que les lignes d'appui qu'elles prenaient sur les anciennes (3) : si bien que la nosologie chaque instant se trouvait confirme, et l'exprience nouvelle par avance embote. Bichat fut peut-tre le seul comprendre ds le dbut l'incompatibilit de sa mthode avec celle des nosographes : Nous dcouvrons comme nous le pouvons les procds de la nature... N'attachons point une importance exagre telle ou telle classification : jamais aucune d'entre elles ne nous donnera un tableau prcis de la marche de la nature (4). Lannec en revanche admet sans problme l'enveloppement de l'exprience anatomo-clinique dans l'espace de la rpartition nosologique : ouvrir les (1) Cf. supra, chap. I, p. 13. (2) Cf. supra, chap. VII, p. 118. (3) P. A. PROST raconte qu'il fit voir aux Prs Corvisart et Pinel des inflammations et des altrations de la membrane interne des intestins dont ils se doutaient si peu que des cadavres o il les leur montra taient sortis de leurs mains sans quils eussent ouvert les intestins (Trait de cholera-morbus, 1832, p. 30). (4) X. BICHAT, Anatomie descriptive, t. I, p. 19. |PAGE 181 cadavres, trouver les lsions, c'est mettre jour ce qu'il y a de plus fixe, de plus positif, et de moins variable dans les maladies locales; c'est donc isoler ce qui doit les caractriser ou les spcifier ; c'est en fin de compte servir la cause de la nosologie en lui offrant de plus certains critres (1). Dans cet esprit, la Socit d'mulation, qui groupait la jeune gnration et reprsentait fidlement la nouvelle cole, posait au concours de 1809 l'interrogation fameuse: Quelles sont les maladies que l'on doit spcialement regarder comme organiques? (2). Certes, ce qui tait en question, c'tait la notion de fivre essentielle et leur non-organicit laquelle Pinel tait rest attach, mais propos de ce point prcis, le problme pos tait encore un problme d'espce et de classe. Pinel tait discut; sa mdecine n'tait pas rvalue de fond en comble. Ce que fera Broussais en 1816 seulement, dans l'Examen de la Doctrine gnralement admise, o il rend radicales les critiques qu'il avait dj formules en publiant huit ans auparavant l'Histoire des phlegmasies chroniques. D'une manire inattendue, il faudra cette mdecine explicitement physiologique, cette thorie si facile et si lche des sympathies, l'usage gnral du concept d'irritation, et le
retour par l un certain monisme pathologique proche parent de celui de Brown, pour que l'anatomie pathologique soit rellement affranchie de la tutelle des nosographes, et que la problmatique des essences morbides cesse de doubler l'analyse perceptive des lsions organiques. Le temps passant, on oubliera vite que la structure de l'exprience anatomo-clinique n'a pu tre quilibre que grce Broussais; on gardera seulement la mmoire des attaques forcenes contre Pinel, dont Lannec en revanche supportait si bien l'impalpable contrle; on ne se souviendra que de l'intemprant physiologiste et de ses htives gnralisations. Et rcemment, le bon Mondor retrouvait sous la bnignit de sa plume la verdeur d'injures adolescentes jeter aux mnes de Broussais (3). L'imprudent n'avait pas lu les textes, ni bien compris les choses. Les voici. (1) LANNEC, Trait de l'auscultation, prface, p. XX. (2) Dans un mmoire qui fut couronn, MARTIN critique l'usage trop simple qui est fait du terme de maladie qu'il voudrait rserver aux affections dues un vice de nutrition des tissus, cf. Bulletin des Sciences mdicales, t. 5 (1810), pp. 167-188. (3) H. MONDOR, Vie de Dupuytren (Paris, 1945), p. 176: mdecin ivre de trteau... vaniteux et bruyant charlatan... ses astuces, son impudence, sa verbeuse combativit, ses erreurs dclamatoires, ...son aplomb d'illusionniste . |PAGE 182 Nvroses et fivres essentielles taient considres, d'un accord assez gnral, la fin du XVIIIe sicle et au dbut du XIXe, comme des maladies sans lsion organique. Les maladies de l'esprit et des nerfs ont reu, et par le fait de Pinel, un statut assez particulier pour que leur histoire, au moins jusqu' la dcouverte de A.-L. Bayle, en 1821-1824,- ne recoupe pas les discussions sur l'organicit des maladies. Les fivres, elles, sont pendant plus de quinze ans au centre mme du problme. Retraons d'abord quelques-unes des lignes gnrales du concept de fivre au XVIIIe sicle. On entend d'abord par ce mot une raction finalise de l'organisme qui se dfend contre une attaque ou une substance pathognes; la fivre manifeste au cours de la maladie va contresens et tente d'en remonter le courant; elle est un signe non de la maladie, mais de la rsistance la maladie, une affection de la vie qui s'efforce d'carter la mort (1). Elle a donc, et au sens strict du terme, une valeur salutaire: elle montre que l'organisme morbiferam aliquam materiam sive praeoccupare sive removere intendit (2). La fivre est un mouvement d'excrtion intention
purificatrice; et Stahl rappelle une tymologie: februare, c'est--dire chasser rituellement d'une maison les ombres des dfunts (3). Sur ce fond de finalit, le mouvement de la fivre et son mcanisme s'analysent facilement. La succession des symptmes en indique les diffrentes phases: le frisson et l'impression premire de froid dnoncent un spasme priphrique et une rarfaction du sang dans les capillaires voisins de la peau. La frquence du pouls indique que le coeur ragit en faisant refluer de plus de sang possible vers les membres: la chaleur montre qu'en effet le sang circule plus rapidement et que toutes les fonctions sont par l mme acclres; les forces motrices dcroissent proportionnellement : d'o l'impression de langueur et l'atonie des muscles. Enfin la sueur indique le succs de cette raction fbrile qui parvient expurger la substance morbifique ; mais lorsque celle-ci parvient se reformer temps, on a des fivres intermittentes (4). (1) BOERHAAVE, Aphorisme. (2) STAHL, cit in DAGOUMER, Prcis historique de la fivre (Paris, 1831), p. 9. (3) Cit ibid. (4) A quelques vairantes prs, ce schma se retrouve chez BOERHAAVE (Aphorismes 563, 570, 581), chez HOFFMANN (Fundamenta Medica), chez STOLL (Aphorismes sur la connaissance et la curation des fivres), chez HUXHAM (Essai sur les fivres), chez BOISSIER DE SAUVAGES (Nosologie mthodique, t. II). |PAGE 183 Cette interprtation simple, qui liait jusqu' l'vidence les symptmes manifestes leurs corrlatifs organiques, a t dans l'histoire de la mdecine d'une triple importance. D'une part, l'analyse de la fivre, sous sa forme gnrale, recouvre exactement le mcanisme des inflammations locales; ici et l il Y a fixation de sang, contraction provoquant une stase plus ou moins prolonge, puis effort du systme pour rtablir la circulation, et cet effet mouvement violent du sang; on verra que des globules rouges viennent passer dans les artres lymphatiques, ce qui provoque, sous une forme locale, l'injection de la conjonctive par exemple, sous une forme gnrale, la chaleur et l'agitation de tout l'organisme; si le mouvement s'acclre, les parties les plus tnues du sang se spareront des plus lourdes, qui demeureront dans les capillaires o la lymphe se convertira en une espce de gele : d'o les suppuration qui se font dans le systme respiratoire ou intestinal en cas d'inflammation gnralise, ou sous forme d'abcs s'il s'agit d'une fivre locale (1). Mais s'il y a identit fonctionnelle entre inflammation et fivre, c'est
que le systme circulatoire est l'lment essentiel du processus. Il s'agit d'un double dcalage dans les fonctions normales: ralentissement d'abord, exagration ensuite; phnomne irritant d'abord, phnomne d'irritation ensuite. Tous ces phnomnes doivent tre dduits de l'irritabilit du coeur et des artres augmente et stimule, enfin de l'action d'un stimulus quelconque et de la rsistance de la vie ainsi irrite au stimulus nuisible (2). Ainsi la fivre, dont le mcanisme intrinsque peut aussi bien tre gnral que local, trouve dans le sang le support organique et isolable qui peut la rendre locale ou gnrale, ou encore gnrale aprs avoir t locale. Toujours par cette irritation diffuse du systme sanguin, une fivre peut tre le symptme gnral d'une maladie qui reste locale tout au long de son dveloppement: sans que rien ne soit modifi son mode d'action, elle pourra donc aussi bien tre essentielle que sympathique. Dans un schma comme celui-ci, le problme de l'existence des fivres essentielles sans lsions assignables ne pouvait pas tre pos: quelle que soit sa forme, son point de dpart ou sa surface de manifestation, la fivre avait toujours le mme type de support organique. Enfin le phnomne de la chaleur est loin de constituer (1) HUXHAM, Essai sur les fivres (trad. fr., Paris, 1752), p. 339. (2) STOLL, Aphorisme sur la connaissance et la curation des fivres (in Encyclopdie des Sciences mdicales, 7e division, t. 5, p. 347). |PAGE 184 l'essentiel du mouvement fbrile; il n'en forme que l'aboutissement le plus superficiel et le plus transitoire, alors que le mouvement du sang, les impurets dont il se charge ou celles qu'il expurge, les engorgements ou les exsudations qui se produisent indiquent ce qu'est la fivre dans sa nature profonde. Grimaud met en garde contre les instruments physiques qui ne peuvent srement nous faire connatre que les degrs de l'intensit de la chaleur; et ces diffrences sont les moins importantes pour la pratique; ...le mdecin doit s'appliquer surtout distinguer dans la chaleur fbrile des qualits qui ne peuvent tre aperues que par un tact fort exerc, et qui chappent et se drobent tous les moyens que la physique peut fournir. Telle cette qualit cre et irritante de la chaleur fbrile qui donne la mme impression que la fume dans les yeux et qui annonce une fivre putride (1). Au-dessous du phnomne homogne de la chaleur, la fivre a donc des qualits propres, une sorte de solidit substantielle et diffrencie, qui permet de la rpartir selon des formes spcifiques. On passe donc, naturellement et sans problme, de la fivre aux fivres. Le glissement de sens et de niveau
conceptuel, qui nous saute aux yeux (2), entre la dsignation d'un symptme commun et la dtermination de maladies spcifiques, ne peut tre peru par la mdecine du XVIIIe sicle, tant donn la forme d'analyse par laquelle elle dchiffrait le mcanisme fbrile. Le XVIIIe sicle accueillera donc, au nom d'une conception trs homogne et cohrente de la fivre, un nombre considrable de fivres. Stoll en reconnat douze, auxquelles il ajoute les fivres nouvelles et inconnues. On les spcifie tantt par le mcanisme circulatoire qui les explique (fivre inflammatoire analyse par J .-P. Franck et dsigne traditionnellement comme la synoque) , tantt par le symptme non fbrile le plus important qui les accompagne (fivre bilieuse de Stahl, de Selle, de Stoll), tantt d'aprs les organes sur lesquels porte l'inflammation (fivre msentrique de Baglivi), tantt enfin d'aprs la qualit des excrtions qu'elle provoque (fivre putride de Haller, de Tissot, de Stoll), tantt enfin d'aprs la varit des formes qu'elle prend et l'volution qu'elle rserve (fivre maligne ou fivre ataxique de Selle). Ce rseau, nos yeux embrouill, n'est devenu confus que du jour o le regard mdical a chang de support pistmologique. (1) GRIMAUD, Trait des fivres (Montpellier, 1791), t. I, p. 89. (2) BOUILLAUD l'analyse avec clart dans le Trait des fivres dites essentielles (Paris, 1826), p. 8. |PAGE 185 Il y eut une premire rencontre entre l'anatomie et l'analyse symptomatique des fivres, bien avant Bichat, bien avant les premires observations de Prost. Rencontre purement ngative puisque la mthode anatomique se dessaisissait de ses droits, et renonait assigner un sige certaines maladies fbriles. Dans la 49e lettre de son Trait, Morgagni disait n'avoir trouv l'ouverture de malades morts de fivres violentes vix quidquam... quod earum gravitati aut impetui responderet ; usque adeo id saepe latet per quod faber interficiunt (1). Une analyse des fivres d'aprs leurs seuls symptmes et sans effort de localisation tait rendue possible, et mme ncessaire: pour donner structure aux diffrentes formes de la fivre, il fallait bien substituer au volume organique un espace de rpartition o n'entreraient que des signes et ce qu'ils signifient. La remise en ordre opre par Pinel n'tait pas seulement dans la ligne de sa propre mthode de dchiffrement nosologique ; elle s'embotait exactement dans la rpartition dfinie par cette premire forme d'anatomie pathologique: les fivres sans lsion sont essentielles; les fivres lsion locale sont sympathiques. Ces formes
idiopathiques, caractrises par leurs manifestations extrieures, laissent apparatre des proprits communes comme de suspendre l'apptit et la digestion, d'altrer la circulation, d'interrompre certaines scrtions, d'empcher le sommeil, d'exciter ou de diminuer l'activit de l'entendement, de porter atteinte certaines fonctions des sens ou mme de les suspendre, d'entraver chacune sa manire le mouvement musculaire (2). Mais la diversit des symptmes permet aussi la lecture d'espces diffrentes: une forme inflammatoire ou angiotonique marque au-dehors par des signes d'irritation, ou de tension des vaisseaux sanguins (elle est frquente la pubert, au dbut de la grossesse, aprs des excs alcooliques) ; une formemningo-gastriqueavec des symptmes nerveux, mais d'autres, plus primitifs, qui paraissent correspondre la rgion pigastrique, et qui suivent en tout cas des troubles de l'estomac; une forme adno-mninge dont les symptmes indiquent une irritation des membranes muqueuses du conduit intestinal ; on la rencontre surtout chez les sujets temprament lymphatique, chez les femmes et les (1) MORGAGNI, De sedibus et causis moborum, Epist. 49, art. 5. (2) Ph. PINEL, Nosographie philosophique (5e d., 1813), I, p. 320. |PAGE 186 vieillards; une forme adynamique qui se manifeste surtout l'extrieur par les signes d'une dbilit extrme et d'une atonie gnrale des muscles ; elle est due probablement l'humidit, la malpropret, la frquentation des hpitaux, des prisons et des amphithtres, la mauvaise nourriture et l'abus des plaisirs vnriens; enfin, la fivre ataxique ou maligne se caractrise par des alternatives d'excitation et d'affaiblissement avec des anomalies nerveuses les plus singulires : on lui trouve peu prs les mmes antcdents qu' la fivre adynamique (1). C'est dans le principe mme de cette spcification que rside le paradoxe. Sous sa forme gnrale, la fivre n'est caractrise que par ses effets; on l'a coupe de tout substrat organique; et Pinel ne mentionne mme pas la chaleur comme signe essentiel ou symptme majeur de la classe des fivres; mais lorsqu'il s'agit de diviser cette essence, la fonction de rpartition est assure par un principe qui relve non de la configuration logique des espces, mais de la spatialit organique du corps: les vaisseaux sanguins, l'estomac, la muqueuse intestinale, le systme musculaire ou nerveux sont tour tour appels pour servir de point de cohrence la diversit informe des symptmes. Et s'ils peuvent s'organiser de manire former des
espces, ce n'est pas parce qu'ils sont des expressions essentielles, c'est parce qu'ils sont des signes locaux. Le principe de l'essentialit des fivres n'a pour contenu concret et spcifi que la possibilit de les localiser. De la Nosologie de Sauvages la Nosographie de Pinel, la configuration a t renverse: dans la premire, les manifestations locales portaient toujours une gnralit possible; dans la seconde, la structure gnrale enveloppe la ncessit d'une localisation. On comprend dans ces conditions que Pinel ait cru pouvoir intgrer dans son analyse symptomatologique des fivres les dcouvertes de Roederer et de Wagler : en 1783 ils avaient montr que la fivre muqueuse tait toujours accompagne de traces d'inflammation interne et externe dans le canal alimentaire (2). On comprend aussi qu'il ait accept les rsultats des autopsies de Prost qui manifestaient des lsions intestinales videntes; mais on comprend aussi pourquoi il ne les voyait pas de lui-mme (3) : la localisation lsionnelle venait pour lui se placer d'elle-mme, mais titre de phnomne secondaire, (1) Ibid., pp. 9-10 et pp. 323-324. (2) ROEDERER et WAGLER, De morbo mucoso (Gttingen, 1783). (3) Cf. supra, p. 180, n. 3. |PAGE 187 l'intrieur d'une symptomatologie o les signes locaux ne renvoyaient pas au sige des maladies, mais leur essence. On comprend enfin pourquoi les apologistes de Pinel ont pu voir en lui le premier des localisateurs : II ne se borna point classer les objets : matrialisant en quelque sorte la science jusque-l trop mtaphysique, il s'effora de localiser si l'on peut dire chaque maladie ou de lui attribuer un sige spcial, c'est--dire de dterminer le lieu de son existence primitive. Cette ide se montre videmment dans les nouvelles dnominations imposes aux fivres qu'il continuait d'appeler essentielles comme pour rendre un dernier hommage aux ides jusque-l dominantes, mais assignant chacune un sige particulier, faisant consister, par exemple, les fivres bilieuses et pituiteuses des autres dans l'irritation spciale de certaines parties du tube intestinal (1). En fait, ce que Pinel localisait, ce n'taient pas les maladies, mais les signes: et la valeur locale dont ils taient affects n'indiquait pas une origine rgionale, un lieu primitif d'o la maladie aurait tir la fois sa naissance et sa forme; elle permettait seulement de reconnatre une maladie qui se donnait ce signal comme symptme caractristique de son essence. Dans ces conditions, la chane causale et temporelle tablir n'allait pas de la lsion la maladie, mais de la maladie la
lsion comme sa consquence et son expression peut-tre privilgie. Chomel en 1820 restera fidle encore la Nosographie lorsqu'il analysera les ulcrations intestinales perues par Broussais comme l'effet et non la cause de l'affection fbrile : ne se produisent-elles pas relativement tard (au dixime jour de la maladie seulement, quand le mtorisme, la sensibilit abdominale droite et les excrtions sanieuses dnoncent leur existence)? N'apparaissentelles pas dans cette partie du canal intestinal o les matires dj irrites par la maladie sjournent le plus longtemps (fin de l'ilon, caecum, et colon ascendant), et dans les segments dclives de l'intestin beaucoup plus frquemment que dans les portions verticales et ascendantes (2) ? Ainsi la maladie se dpose dans l'organisme, y ancre des signes locaux, se rpartit d'elle-mme dans l'espace secondaire du corps; mais sa structure essentielle reste pralable. L'espace organique lest muni de rfrences cette structure; il la signale, ne l'ordonne pas. (1) RICHERAND, Histoire de la chirurgie (Paris, 1825), p. 250. (2) A.-F. CHOMEL, De l'existence des fivres essentielles (Paris, 1820), pp. 10-12. |PAGE 188 L'Examen de 1816 a t jusqu'au fond de la doctrine de Pinel pour en dnoncer, et avec une tonnante lucidit thorique, les postulats. Mais ds l'Histoire des phlegmasies se trouvait pos sous forme de dilemme ce qu'on avait cru jusqu'alors parfaitement compatible: ou une fivre est idiopathique ou elle est localisable; et toute localisation russie fera dchoir la fivre de son statut d'essentialit. Sans doute cette incompatibilit qui s'inscrivait logiquement l'intrieur de l'exprience anatomo-clinique avait-elle t formule bas bruit ou du moins souponne par Prost quand il avait montr les fivres diffrentes les unes des autres selon l'organe dont l'affection leur donne lieu, ou selon le mode d'altration des tissus (1) ; par Rcamier aussi et ses lves lorsqu'ils avaient tudi ces maladies promises la fortune: les mningites, indiquant que les fivres de cet ordre sont rarement des maladies essentielles, qu'elles dpendent peut-tre mme toujours d'une affection du cerveau telle qu'une phlegmasie, une collection sreuse (2). Mais ce qui permit Broussais de transformer ces premires approches en forme systmatique d'interprtation de toutes les fivres, c'est, sans aucun doute, la diversit et en mme temps la cohrence des champs d'exprience mdicale qu'il avait traverss. Form aussitt avant la Rvolution la mdecine du XVIIIe sicle, ayant connu comme officier de sant dans la marine les problmes
propres la mdecine hospitalire et la pratique chirurgicale, lve, par la suite, de Pinel et des cliniciens de la nouvelle Ecole de Sant, ayant suivi les cours de Bichat et les cliniques de Corvisart qui l'initirent l'anatomie pathologique, il reprit le mtier militaire et suivit l'arme d'Utrecht Mayence et de Bohme en Dalmatie, s'exerant comme son matre Desgenettes la nosographie mdicale compare, et pratiquant une grande chelle la mthode des autopsies. Toutes les formes d'exprience mdicale qui se croisent la fin du XVIIIe sicle lui sont familires; il n'est pas tonnant qu'il ait pu, de leur ensemble et de leurs lignes de recoupements, tirer la leon radicale qui devait chacune donner sens et conclusion. Broussais n'est (1) PROST, La mdecine des corps claire par l'ouverture et l'observation (Paris, an XII), t. I, pp. XXII et XXIII. (2) P.-A. Dan DE LA VAUTRIE, Dissertation sur l'apoplexie considre spcialement comme l'effet d'une phlegmasie de la substance crbrale (Paris, 1807). |PAGE 189 que le point de convergence de toutes ces expriences, la forme individuellement modele de leur configuration d'ensemble. Il le savait d'ailleurs, et qu'en lui parlait ce mdecin observateur qui ne ddaignera pas l'exprience des autres, mais qui voudra la sanctionner par la sienne... Nos Ecoles de Mdecine qui ont su s'affranchir du joug des anciens systmes et se prserver de la contagion des nouveaux ont form depuis quelques annes des sujets capables de raffermir la marche encore une fois chancelante de l'art de gurir. Rpandus parmi leurs concitoyens ou dissmins au loin dans nos armes, ils observent, ils mditent... Un jour sans doute, ils feront entendre leur voix (1). En revenant de Dalmatie en 1808, Broussais publie son Histoire des phlegmasies chroniques. C'est le soudain retour l'ide prclinique que fivre et inflammation relvent du mme processus pathologique. Mais alors qu'au XVIIIe sicle cette identit rendait secondaire la distinction du gnral et du local, elle est chez Broussais la consquence naturelle du principe tissulaire de Bichat, c'est--dire de l'obligation de trouver la surface d'attaque organique. Chaque tissu aura son mode propre d'altration: c'est donc par l'analyse des formes particulires d'inflammation au niveau des plages de l'organisme qu'il faut commencer l'tude de ce qu'on appelle les fivres. Il y aura les inflammations dans les tissus chargs de capillaires sanguins (comme la pie-mre ou les lobes pulmonaires), qui provoquent une forte pousse thermique, l'altration des fonctions nerveuses, le drangement des scrtions,
et ventuellement des troubles musculaires (agitation, contractions) ; les tissus peu fournis en capillaires rouges (membranes minces) donnent des troubles semblables mais attnus; enfin, l'inflammation des vaisseaux lymphatiques provoque des drangements dans la nutrition et dans les scrtions sreuses (2). Sur fond de cette spcification tout fait globale et dont le style est fort proche des analyses de Bichat, le monde des fivres se simplifie singulirement. On ne retrouvera plus dans le poumon que les phlegmasies correspondant au premier type d'inflammation (catarrhe et pripneumonie), celles qui drivent du second type (pleursie), celles enfin dont l'origine est une inflammation des vaisseaux lymphatiques (phtisie tuberculeuse). Pour le systme digestif, la membrane muqueuse peut tre atteinte soit la hauteur de l'estomac (gastrite), soit dans l'intestin (entrite, (1) F.-.J.-V. BROUSSAIS, Histoire des phlegmasies chroniques, t. II, pp. 3-4. (2) Ibid., t. I, pp. 55-56. |PAGE 190 pritonite). Quant leur volution, elle est convergente, selon la logique de la propagation tissulaire: une inflammation sanguine, lorsqu'elle dure, gagne toujours les vaisseaux lymphatiques; c'est pourquoi les phlegmasies du systme respiratoire aboutissent toutes la phtisie pulmonaire (1) ; quant aux inflammations intestinales elles tendent rgulirement aux ulcrations de la pritonite. Homognes par leur origine et convergentes dans leurs formes terminales, les phlegmasies ne prolifrent en symptmes multiples que dans cet entre-deux. Elles gagnent par voie de sympathie des rgions et des tissus nouveaux: tantt il s'agit d'une progression le long des relais de la vie organique (ainsi, l'inflammation de la muqueuse intestinale peut altrer les scrtions bilieuses, urinaires, faire apparatre des taches sur la peau ou le saburre dans la bouche) ; tantt elles s'attaquent successivement aux fonctions de relation (cphale, douleur musculaire, vertiges, assoupissement, dlire). Ainsi toutes les varits symptomatologiques peuvent natre partir de cette gnralisation. L rside la grande conversion conceptuelle que la mthode de Bichat avait autorise mais pas encore mise au clair: c'est la maladie locale qui en se gnralisant donne les symptmes particuliers de chaque espce; mais prise en sa forme gographique premire, la fivre n'est rien d'autre qu'un phnomne localement individualis structure pathologique gnrale. Autrement dit, le symptme particulier (nerveux ou hpatique) n'est pas un signe local; c'est au
contraire un indice de gnralisation ; seul le symptme gnral d'inflammation porte en lui l'exigence d'un point d'attaque bien localis. Bichat tait rest proccup par le souci de fonder organiquement les maladies gnrales: d'o sa recherche des universalits organiques. Broussais dissocie les doublets, symptme particulier -lsion locale, symptme gnral -altration d'ensemble, en croise les lments et montre l'altration d'ensemble sous le symptme particulier, et la lsion gographique sous le symptme gnral. Dsormais l'espace organique de la localisation est rellement indpendant de l'espace de la configuration nosologique : celui-ci glisse sur le premier, dcale par rapport lui ses valeurs, et n'y renvoie qu'au prix d'une projection inverse. Mais qu'est-ce que l'inflammation, processus de structure gnrale mais point d'attaque toujours localis? La vieille analyse symptomatique la caractrise par la tumeur, la rougeur, (1) Ibid., t. I, prface, p. XIV. |PAGE 191 la chaleur, la douleur; ce qui ne correspond pas aux formes qu'elle prend dans les tissus; l'inflammation d'une membrane ne prsente ni douleur, ni chaleur, ni plus forte raison rougeur. L'inflammation n'est pas une constellation de signes: elle est un processus qui se dveloppe l'intrieur d'un tissu: toute exaltation locale des mouvements organiques, assez considrable pour troubler l'harmonie des fonctions et pour dsorganiser le tissu o elle est fixe, doit tre considre comme inflammation (1). Il s'agit donc d'un phnomne qui comporte deux couches pathologiques de niveau et de chronologie diffrents: d'abord une attaque fonctionnelle, puis une attaque de la texture. L'inflammation a une ralit physiologique qui peut anticiper sur la dsorganisation anatomique, qui la rend sensible aux yeux. D'o la ncessit d'une mdecine physiologique,observant la vie, non la vie abstraite, mais la vie des organes et dans les organes, en rapport avec tous les agents qui peuvent exercer sur eux quelque influence (2) ; l'anatomie pathologique conue comme simple examen des corps sans vie est elle-mme sa propre limite tant que le rle et les sympathies de tous les organes sont loin d'tre parfaitement connus (3). Pour dtecter ce trouble fonctionnel premier et fondamental, le regard doit savoir se dtacher du foyer lsionnel, car il n'est pas donn d'entre de jeu, bien que la maladie soit, dans son enracinement d'origine, toujours localisable ; il lui faut reprer justement cette racine organique avant la lsion, grce aux troubles
fonctionnels et leurs symptmes. C'est ici que la symptomatologie retrouve son rle, mais un rle entirement fond sur le caractre local de l'attaque pathologique: en remontant le chemin des sympathies et des influences organiques, elle doit, sous le rseau indfiniment tendu des symptmes, induire ou dduire (Broussais utilise les deux mots dans le mme sens) le point initial de la perturbation physiologique. Etudier les organes altrs sans faire mention des symptmes des maladies, c'est faire comme si l'on considrait l'estomac indpendamment de la digestion (4). Ainsi au lieu d'exalter, comme on le faitsans mesure, dans les crits du jour, les avantages de la description, tout en dprciant l'induction sous les noms de thorie hypothtique, de systme a priori de vaines (1) Ibid., t. I, p. 6. (2) BROUSSAIS, Sur l'influence que les travaux des mdecins physiologistes ont exerce sur l'tat de la mdecine (Paris, 1832), pp. 19-20. (3) BROUSSAIS, Examen des doctrines (2e d., Paris, 1821), t. II, p. 647. (4)Ibid., p. 671. |PAGE 192 conjectures (1), on fera parler l'observa lion des symptmes le langage mme de l'anatomie pathologique. Nouvelle organisa lion du regard mdical par rapport Bichat: depuis le Trait des membranes, le principe de la visibilit tait une rgle absolue, et la localisation n'en formait que la consquence. Avec Broussais l'ordre s'inverse; c'est parce que la maladie, dans sa nature, est locale qu'elle est, d'une manire seconde, visible. Broussais, surtout dans l'Histoire des phlegmasies, admet (et en ceci mme, il va plus loin que Bichat pour qui les maladies vitales peuvent ne pas laisser de traces) que toute affection pathologique implique une modification particulire au phnomne qui restitue nos corps aux lois de la matire inorganique : par consquent, si les cadavres nous ont quelquefois paru muets, c'est que nous ignorions l'art de les interroger (2). Mais ces altrations, quand l'attaque est de forme surtout physiologique, peuvent tre peine perceptibles; ou encore elles peuvent, comme les taches sur la peau dans les fivres intestinales, disparatre avec la mort; elles peuvent tre, en tout cas, dans leur extension et leur importance perceptive, Sans commune mesure avec le trouble qu'elles provoquent: ce qui est important, en effet, ce n'est pas ce qui, de ces altrations, s'offre la vue, mais ce qui, en elles, est dtermin par le lieu o elles se dveloppent. En
abattant la cloison nosologique maintenue par Bichat entre le trouble vital ou fonctionnel, et l'altration organique, Broussais, en vertu d'une ncessit structurale vidente, fait passer l'axiome de localisation avant le principe de visibilit. La maladie est de l'espace avant d'tre pour la vue. La disparition des deux dernires grandes classes a priori de la nosologie a ouvert la mdecine un champ d'investigation entirement spatial, et dtermin de bout en bout par ces valeurs locales. Il est curieux de constater que cette spatialisation absolue de l'exprience mdicale n'est pas due l'intgration dfinitive de l'anatomie normale et pathologique, mais au premier effort pour dfinir une physiologie du phnomne morbide. Mais il faut remonter plus loin encore dans les lments constituants de cette nouvelle mdecine et poser la question de l'origine de l'inflammation. Celle-ci tant une exaltation locale des mouvements organiques, elle suppose dans les tissus une certaine aptitude se mouvoir et, au contact de ces tissus, (1) BROUSSAIS, Mmoire sur la philosophie de la mdecine (Paris, 1832), pp. 14-15. (2) BROUSSAIS, Histoire des phlegmasies, I, prface, p. V. |PAGE 193 un agent qui suscite et exagre les mcanismes. Telle est l'irritabilit, facult que les tissus possdent de se mouvoir par le contact d'un corps tranger... Haller n'attribuait cette proprit qu'aux muscles; mais on convient aujourd'hui qu'elle est commune tous les tissus (1). Il ne faut pas la confondre avec la sensibilit qui est la conscience des mouvements excits par les corps trangers, et ne forme qu'un phnomne surajout et secondaire par rapport l'irritabilit: l'embryon n'est pas encore sensible, l'apoplectique ne l'est plus; l'un et l'autre sont irritables. Le surcrot d'action irrita tif est provoqu par des corps ou des objets vivants ou non vivants (2), qui entrent en contact avec les tissus; ce sont donc des agents intrieurs ou extrieurs mais de toute faon trangers au fonctionnement de l'organe; la srosit d'un tissu peut devenir irritante pour un autre ou pour lui-mme si elle est trop abondante, mais aussi bien un changement de climat ou un rgime alimentaire. Un organisme n'est malade qu'en rapport avec des sollicitations du monde extrieur, ou des altrations de son fonctionnement ou de son anatomie. Aprs beaucoup de vacillations dans sa marche, la mdecine suit enfin la seule route qui puisse la conduire la vrit: l'observation des rapports de l'homme avec les modifications externes, et des organes des hommes les uns avec les autres (3).
Par cette conception de l'agent externe ou de la modification intrieure, Broussais contourne un des thmes qui avait, peu d'exceptions prs, rgn sur la mdecine depuis Sydenham: l'impossibilit de dfinir la cause des maladies. La nosologie de Sauvages Pinel avait t, de ce point de vue, comme une figure embote l'intrieur de ce renoncement l'assignation causale: la maladie se redoublait et se fondait elle-mme dans son affirmation essentielle, et les sries causales n'taient que des lments l'intrieur de ce schma o la nature du pathologique lui servait de cause efficace. Avec Broussais -chose qui n'tait pas encore acquise avec Bichat -la localisation appelle un schma causal enveloppant: le sige de la maladie n'est que le point d'accrochage de la cause irritante, point qui est dtermin la fois par l'irritabilit du tissu et la force d'irritation de l'agent. L'espace local de la maladie est en mme temps, et immdiatement, un espace causal. (1) BROUSSAIS, De l'irritation et de la folie (Paris, d. de 1839), I, p. 3. (2)Ibid., p. 1 ,n. 1. (3) Ibid., Prface de l'dition de 1828 (d. de 1839), t. I, p. LXV. |PAGE 194 Alors -et c'est l la grande dcouverte de 1816 -disparat l'tre de la maladie. Raction organique un agent irritant, le phnomne pathologique ne peut plus appartenir un monde o la maladie, dans sa structure particulire, existerait conformment un type imprieux, qui lui serait pralable, et en qui elle se recueillerait, une fois carts les variations individuelles et tous les accidents sans essence; il est pris dans une trame organique o les structures sont spatiales, les dterminations causales, les phnomnes anatomiques et physiologiques. La maladie n'est plus qu'un certain mouvement complexe des tissus en raction une cause irritante: c'est l toute l'essence du pathologique, car il n'y a plus ni maladies essentielles, ni essences des maladies. Toutes les classifications qui tendent nous faire considrer les maladies comme des tres particuliers sont dfectueuses et un esprit judicieux est sans cesse, et comme malgr lui, ramen vers la recherche des organes souffrants (1). Ainsi la fivre ne peut pas tre essentielle: elle n'est autre chose qu'une acclration du cours du sang... avec une augmentation de la calorification et une lsion des fonctions principales. Cet tat de l'conomie est toujours dpendant d'une irritation locale (2). Toutes les fivres se dissolvent dans un long processus organique, peu prs intgralement entrevu dans le texte de 1808 (3), affirm en 1816, et schmatis nouveau 8 ans plus tard dans le Catchisme de la Mdecine physiologique. A l'origine de toutes, une seule et mme
irritation gastro-intestinale: d'abord une simple rougeur, puis des taches vineuses de plus en plus nombreuses dans la rgion ilocaecale; ces taches prennent souvent l'allure de plages boursoufles qui la longue provoquent des ulcrations. Sur cette trame anatomopathologique constante, qui dfinit l'origine et la forme gnrale de la gastro-entrite, les processus se ramifient: quand l'irritation du canal digestif a plus gagn en extension qu'en profondeur, elle suscite une scrtion biliaire importante, et une douleur dans les muscles locomoteurs: c'est ce que Pinel appelait la fivre bilieuse; chez un sujet lymphatique, ou quand l'intestin est charg de mucosits, la gastro-entrite prend l'allure qui lui a valu le nom de fivre muqueuse; ce qu'on appelait la fivre adynamique n'est que la gastro-entrite arrive un tel (1) BROUSSAIS, Examen de la doctrine (Paris, 1816), prface. (2) Ibid., d. de 1821, p. 399. (3) En 1808, BROUSSAIS mettait encore part les typhus malins (fivres ataxiques) pour lesquels il n'avait pas trouv lautopsie d'inflammation viscrale (Examen des doctrines, 1821, t. II, pp. 666668). |PAGE 195 degr d'intensit que les forces diminuent, que les facults intellectuelles s'moussent, ...que la langue brunit, que la bouche se tapisse d'un enduit noirtre; quand l'irritation gagne par sympathie les enveloppes crbrales, on a les formes malignes des fivres (1). Par ces rameaux, et par d'autres, la gastro-entrite gagne peu peu l'organisme tout entier: II est bien vrai que le cours du sang est prcipit dans tous les tissus; mais cela ne prouve pas que la cause de ces phnomnes rside dans tous les points du corps (2). Il faut donc retirer la fivre son statut d'tat gnral, et, au profit des processus physio-pathologiques qui en spcifient les manifestations, la dsessentialiser (3). Cette dissolution de l'ontologie fbrile, avec les erreurs qu'elle a comportes ( une poque o la diffrence entre mningite et typhus commenait tre perue clairement), est l'lment le plus connu de l'analyse. En fait, elle n'est, dans l'conomie gnrale de son analyse, que la contrepartie ngative d'un lment positif et beaucoup plus subtil: l'ide d'une mthode mdicale (anatomique et surtout physiologique) applique la souffrance organique: il faut puiser dans la physiologie les traits caractristiques des maladies et dbrouiller par une sa vante analyse les cris souvent confus des organes souffrants (4). Cette mdecine des organes souffrants
comporte trois moments: 1 Dterminer quel est l'organe qui souffre, ce qui se fait partir des symptmes manifests mais condition de connatre tous les organes, tous les tissus qui constituent les moyens de communication par lesquels ces organes sont associs entre eux, et les changements que la modification d'un organe fait prouver aux autres ; 2 Expliquer comment un organe est devenu souffrant, partir d'un agent extrieur; en tenant compte de ce fait essentiel que l'irritation peut provoquer une hyperactivit ou au contraire une asthnie fonctionnelle, et que presque toujours ces deux modifications existent la fois dans notre conomie (sous l'action du froid, l'activit des scrtions cutanes diminue, celle du poumon augmente) ; 3 Indiquer ce qu'il faut faire pour qu'il cesse de souffrir : c'est-dire supprimer la cause (le froid dans la pneumonie), (1) BROUSSAIS, Catchisme de la Mdecine physiologiste (Paris, 1824), pp. 28-30. (2) Examen des doctrines (1821), t. II, p. 399. (3) L'expression se trouve dans la rponse de BROUSSAIS Foder (Histoire de quelques doctrines mdicales), Journal universel des Sciences mdicales, t. XXIV. (4) BROUSSAIS, Examen de la doctrine (1816), prface. |PAGE 196 mais aussi effacer les effets qui ne disparaissent pas toujours quand la cause a cess d'agir (la congestion sanguine entretient l'irritation dans les poumons des pneumoniques) (1). Dans la critique de l'ontologie mdicale, la notion desouffrance organique va plus loin sans doute et plus profondment que celle d'irritation. Celle-ci impliquait encore une conceptualisation abstraite: l'universalit qui lui permettait de tout expliquer formait pour le regard pos sur l'organisme un dernier cran d'abstraction. La notion d'une souffrance des organes ne comporte que l'ide d'un rapport de l'organe un agent ou un milieu, celle d'une raction l'attaque, celle d'un fonctionnement anormal, celle enfin de l'influence perturbatrice de l'lment attaqu sur les autres organes. Dsormais le regard mdical ne se posera plus que sur un espace rempli par les formes de composition des organes. L'espace de la maladie est, sans rsidu ni glissement, l'espace mme de l'organisme. Percevoir le morbide est une certaine manire de percevoir le corps. La mdecine des maladies a fini son temps; commence une mdecine des ractions pathologiques, structure d'exprience qui a domin le XIXe sicle et jusqu' un certain point le Xe puisque, non sans
modifications mthodologiques, la mdecine des agents pathognes viendra s'y emboter. On peut laisser de ct les infinies discussions qui opposrent les fidles de Broussais aux derniers partisans de Pinel. Les analyses anatomo-pathologiques faites par Petit et Serres sur la fivre entromsentrique (2), la distinction rtablie par Caffin entre les symptmes thermiques et les maladies prtendues fbriles (3), les travaux de Lallemand sur les affections crbrales aigus (4), enfin le Trait de Bouillaud consacr aux fivres dites essentielles (5) ont mis peu peu hors problme cela mme qui continuait nourrir les polmiques. Elles finissent par se (1) Examen des doctrines (1821), t. I, pp. 52-55. Dans le texte sur L'influence des mdecins physiologistes (1832), BROUSSAIS ajoute entre les 2e et 3e prceptes celui de dterminer l'action de l'organe souffrant sur les autres. (2) M.-A. PETIT et SERRES, Trait de la fivre entro-msentrique (Paris, 1813). (3) CAFFIN, Trait analytique des fivres essentielles (Paris, 1811). (4) LALLEMAND, Recherches anatomo-pathologiques sur l'encphale (Paris, 1820). (5) BOUILLAUD, Trait clinique et exprimental des fivres dites essentielles (Paris, 1826). |PAGE 197 taire. Chomel qui, en 1821, affirmait l'existence de fivres gnrales sans lsions, leur reconnat toutes, en 1834, une localisation organique (1) ; Andral avait consacr un volume de sa Clinique mdicale, dans la premire dition, la classe des fivres; dans la seconde, il les rpartit en phlegmasies des viscres et phlegmasies des centres nerveux (2). Et pourtant jusqu' son dernier jour, Broussais fut attaqu avec passion; et depuis sa mort, son discrdit n'a cess de crotre. Il ne pouvait pas en tre autrement. Broussais n'avait russi contourner l'ide de maladies essentielles que moyennant un prix extraordinairement lev; il lui avait fallu rarmer la vieille notion si critique (et justement par l'anatomie pathologique) de sympathie; il avait d faire retour au concept hallrien d'irritation ; il s'tait repli sur un monisme pathologique qui rappelait Brown, et il avait remis en jeu, dans la logique de son systme, les vieilles pratiques de la saigne. Tous ces retours avaient t pistmologiquement ncessaires pour qu'apparaisse dans sa puret une mdecine des organes, et pour que la perception mdicale se libre de tout prjug
nosologique. Mais par le fait mme elle risquait de se perdre la fois dans la diversit des phnomnes et dans l'homognit du processus. Entre la monotone irritation et la violence infinie des cris des organes souffrants, la perception oscillait avant de fixer l'invitable ordonnance, o toutes les singularits se fondaient: lancette et sangsue. Tout tait justifi dans les attaques forcenes que les contemporains de Broussais lanaient contre lui. Pas tout fait cependant : cette perception anatomo-clinique, enfin conquise dans sa totalit et capable de se contrler elle-mme, cette perception au nom de laquelle ils avaient raison contre lui, c'est sa mdecine physiologique qu'ils la devaient ou qu'ils en devaient du moins la forme dfinitive d'quilibre. Tout chez Broussais tait contre-courant de ce qu'on voyait son poque, mais il avait fix pour son poque le dernier lment de la manire de voir. Depuis 1816, l'oeil du mdecin peut s'adresser un organisme malade. L'a priori historique et concret du regard mdical moderne a achev sa constitution. Le dchiffrement des structures n'a que faire des rhabilitations. Mais puisqu'il y a encore de nos jours des mdecins (1) CHOMEL, Trait des fivres et des maladies pestilentielles (1821) Leons sur la fivre typhode (1834). ' (2) ANDRAL, Clinique mdicale (Paris, 1823-1827, 4 vol.). Une anecdote veut que Pinel ait eu l'intention de supprimer, dans la dernire dition de la Nosologie, la classe des fivres et qu'il en ait t empch par son diteur. |PAGE 198 et d'autres, qui croient faire de l'histoire en crivant des biographies et en distribuant des mrites, voici, pour eux, le texte d'un mdecin, qui n'tait point un ignorant: La publication de l'Examen de la doctrine mdicale est un de ces importants vnements dont les fastes de la mdecine conserveront longtemps mmoire... La rvolution mdicale dont M. Broussais jeta les fondements en 1816 est sans conteste la plus remarquable que la mdecine ait prouve dans les temps modernes (1). |PAGE 199 Conclusion Le livre qu'on vient de lire est, parmi d'autres, l'essai d'une mthode dans le domaine si confus, si peu et si mal structur, de l'histoire des ides.
Son support historique est troit puisqu'il traite, en somme, du dveloppement de l'observation mdicale et de ses mthodes pendant un demi-sicle peine. Il s'agit pourtant d'une de ces priodes qui dessinent un ineffaable seuil chronologique: le moment o le mal, la contre-nature, la mort, bref, tout le fond noir de la maladie vient au jour, c'est--dire tout la fois s'claire et se supprime comme nuit, dans l'espace profond, visible et solide, ferm mais accessible, du corps humain. Ce qui tait fondamentalement invisible s'offre soudain la clart du regard, dans un mouvement d'apparence si simple, si immdiate qu'il semble la rcompense naturelle d'une exprience mieux faite. On a l'impression que, pour la premire fois depuis des millnaires, les mdecins, libres enfin de thories et de chimres, ont consenti aborder pour lui-mme et dans la puret d'un regard non prvenu l'objet de leur exprience. Mais il faut retourner l'analyse: ce sont les formes de visibilit qui ont chang; le nouvel esprit mdical dont Bichat porte sans doute le premier tmoignage absolument cohrent n'est pas inscrire l'ordre des purifications psychologiques et pistmologiques; il n'est pas autre chose qu'une rorganisation pistmologique de la maladie o les limites du visible et de l'invisible suivent un nouveau dessin; l'abme d'en dessous le mal et qui tait le mal lui-mme vient de surgir dans la lumire du langage -cette lumire sans doute qui claire d'un mme jour les 120 Journes, Juliette et les Dsastres. Mais il ne s'agit ici que du domaine de la mdecine et de la manire dont s'est structure en quelques annes la connaissance singulire de l'individu malade. Pour que l'exprience clinique ft possible comme forme de connaissance, il a fallu |PAGE 200 toute une rorganisation du champ hospitalier, une dfinition nouvelle du statut du malade dans la socit et l'instauration d'un certain rapport entre l'assistance et l'exprience, le secours et le savoir ; on a d envelopper le malade dans un espace collectif "t homogne. Il a fallu aussi ouvrir le langage tout un domaine nouveau : celui d'une corrlation perptuelle et objectivement fonde du visible et de l'nonable. Un usage absolument nouveau du discours scientifique s'est dfini alors : usage de fidlit et d'obissance inconditionne au contenu color de l'exprience -dire ce qu'on voit; mais usage aussi de fondation et de constitution de l'exprience -donner voir en disant ce qu'on voit; il a donc fallu situer le langage mdical ce niveau apparemment trs superficiel mais vrai dire trs profondment enfoui o la formule de description est en mme temps geste de dvoilement. Et ce dvoilement
impliquait son tour comme champ d'origine et de manifestation de la vrit l'espace discursif du cadavre: l'intrieur dvoil. La constitution de l'anatomie pathologique l'poque o les cliniciens dfinissaient leur mthode n'est pas de l'ordre de la concidence : l'quilibre de l'exprience voulait que le regard pos sur l'individu et le langage de la description reposent sur le fond stable, visible et lisible, de la mort. Cette structure, o s'articulent l'espace, le langage et la mort -ce qu'on appelle en somme la mthode anatomo-clinique -constitue la condition historique d'une mdecine qui se donne et que nous recevons comme positive. Positif est prendre ici au sens lourd. La maladie se dtache de la mtaphysique du mal laquelle, depuis des sicles, elle tait apparente; et elle trouve dans la visibilit de la mort la forme pleine o son contenu apparat en termes positifs. Pense par rapport la nature, la maladie tait l'inassignable ngatif dont les causes, les formes, les manifestations ne s'offraient que de biais et sur un fond toujours recul; perue par rapport la mort, la maladie devient exhaustivement lisible, ouverte sans rsidu la dissection souveraine du langage et du regard. C'est lorsque la mort s'est intgre pistmologiquement l'exprience mdicale que la 'maladie a pu se dtacher de la contre-nature et prendre corps dans le corps vivant des individus. Il restera sans doute dcisif pour notre culture que le premier discours scientifique tenu par elle sur l'individu ait d passer par ce moment de la mort. C'est que l'homme occidental n'a pu se constituer ses propres yeux comme objet de science, il ne s'est pris l'intrieur de son langage et ne s'est donn en lui et |PAGE 201 par lui une existence discursive qu'en rfrence sa propre destruction: de l'exprience de la Draison sont nes toutes les psychologies et la possibilit mme de la psychologie; de la mise en place de la mort dans la pense mdicale est ne une mdecine qui se donne comme science de l'individu. Et d'une faon gnrale, l'exprience de l'individualit dans la culture moderne est peut-tre lie celle de la mort: des cadavres ouverts de Bichat l'homme freudien, un rapport obstin la mort prescrit l'universel son visage singulier et prte la parole de chacun le pou voir d'tre indfiniment entendue; l'individu lui doit un sens qui ne s'arrte pas avec lui. Le partage qu'elle trace et la finitude dont elle impose la marque nouent paradoxalement l'universalit du langage la forme prcaire et irremplaable de l'individu. Le sensible, inpuisable la description, et que tant de sicles ont voulu dissiper, trouve enfin dans la mort la
loi de son discours. Elle donne voir, dans un espace articul par le langage, la profusion des corps et leur ordre simple. On peut comprendre partir de l l'importance de la mdecine dans la constitution des sciences de l'homme: importance qui n'est pas seulement mthodologique dans la mesure o elle concerne l'tre de l'homme comme objet de savoir positif. La possibilit pour l'individu d'tre la fois sujet et objet de sa propre connaissance implique que soit invers dans le savoir le jeu de la finitude. Pour la pense classique, celle-ci n'avait d'autre contenu que la ngation de l'infini, alors que la pense qui se forme la fin du XVIIIe sicle lui donne les pouvoirs du positif: la structure anthropologique qui apparat alors joue la fois le rle critique de limite et le rle fondateur d'origine. C'est ce retournement qui a servi de connotation philosophique l'organisation d'une mdecine positive; inversement, celle-ci, au niveau empirique, a t une des premires mises au jour du rapport qui noue l'homme moderne une originaire finitude. De l, la place dterminante de la mdecine dans l'architecture d'ensemble des sciences humaines: plus qu'une autre, elle est proche de la disposition anthropologique qui les soutient toutes. De l aussi son prestige dans les formes concrtes de l'existence: la sant remplace le salut, disait Guardia. C'est que la mdecine offre l'homme moderne le visage obstin et rassurant de sa finitude; en elle la mort est ressasse, mais en mme |PAGE 202 temps conjure; et si elle annonce sans rpit l'homme la limite qu'il porte en soi, elle lui parle aussi de ce monde technique qui est la forme arme, positive et pleine de sa finitude. Les gestes, les paroles, les regards mdicaux ont pris, de ce moment, une densit philosophique comparable peut-tre celle qu'avait eue auparavant la pense mathmatique. L'importance de Bichat, de Jackson, de Freud dans la culture europenne ne prouve pas qu'ils taient aussi philosophes que mdecins, mais que, dans cette culture, la pense mdicale engage de plein droit le statut philosophique de l'homme. Cette exprience mdicale est par l mme apparente une exprience lyrique qui a cherch son langage de Hlderlin Rilke. Cette exprience qu'inaugure le XVIIIe sicle et laquelle nous n'avons pas encore chapp, est lie une mise au jour des formes de la finitude, dont la mort est sans doute la plus menaante, mais aussi la plus pleine. L'Empdocle de Hlderlin, parvenant, de sa marche volontaire, au bord de l'Etna, c'est la mort du dernier mdiateur entre les mortels et l'Olympe, c'est la fin de l'infini sur la
terre, la flamme revenant son feu de naissance et laissant comme seule trace qui demeure ce qui justement devait tre aboli par sa mort: la forme belle et close de l'individualit; aprs Empdocle, le monde sera plac sous le signe de la finitude, dans cet entre-deux sans conciliation o rgne la Loi, la dure loi de la limite; l'individualit aura pour destin de prendre toujours figure dans l'objectivit qui la manifeste et la cache, qui la nie et la fonde: ici encore, le subjectif et l'objectif changent leur figure. D'une manire qui peut paratre trange au premier regard, le mouvement qui soutient le lyrisme au XIXe sicle ne fait qu'un avec celui par lequel l'homme a pris une connaissance positive de lui-mme; mais faut-il s'tonner que les figures du savoir et celles du langage obissent la mme loi profonde, et que l'irruption de la finitude surplombe, de la mme faon, ce rapport de l'homme la mort qui, ici, autorise un discours scientifique sous une forme rationnelle, et l ouvre la source d'un langage qui se dploie indfiniment dans le vide laiss par l'absence des dieux? La formation de la mdecine clinique n'est qu'un des plus visibles tmoignages de ces changements dans les dispositions fondamentales du savoir; on peut voir qu'ils ont engag bien plus qu'on n'en peut dchiffrer la lecture cursive du positivisme. Mais quand on fait, de ce positivisme, l'investigation verticale, on voit apparatre, la fois cache par lui mais indispensable pour qu'il naisse, toute une srie de figures qui seront |PAGE 203 dlivres par la suite et paradoxalement utilises contre lui. En particulier, ce que la phnomnologie lui opposera avec le plus' d'obstination tait prsent dj dans le systme de ses conditions : les pouvoirs signifiants du peru et sa corrlation avec le' langage dans les formes originaires de l'exprience, l'organisation de l'objectivit partir des valeurs du signe, la structure secrtement linguistique du donn, le caractre constituant de la spatialit corporelle, l'importance de la finitude dans le rapport de l'homme la vrit et dans le fondement de ce rapport, tout cela tait dj mis en jeu dans la gense du positivisme. Mis en jeu, mais oubli son profit. Si bien que la pense contemporaine, croyant lui avoir chapp depuis la fin du XIXe sicle, n'a fait que redcouvrir peu peu ce qui l'avait rendu possible. La culture europenne, dans les dernires annes du XVIIIe sicle, a dessin une structure qui n'est pas encore dnoue; peine commence-t-on en dbrouiller quelques fils, qui nous sont encore si inconnus que nous les prenons volontiers pour merveilleusement nouveaux ou absolument archaques, alors que,
depuis deux sicles (pas moins et cependant pas beaucoup plus), ils ont constitu la trame sombre mais solide de notre exprience. |PAGE 205 bibliographie I. -NOSOLOGIE ALIBERT (J.-L.), Nosologie naturelle (Paris, 1817). BOISSIER DE SAUVAGES (Fr.), Nosologie mthodique (trad., Lyon, 1772, 10 vol.). CAPURON (J .), Nova medicinae elementa (Paris, 1804). Ch... (J.-J.), Nosographiae compendium (Paris, 1816). CHAUSSIER (Fr.), Table gnrale des mthodes nosologiques (Paris, s.d.). CULLEN (W.), Apparatus ad nosologiam methodicam (Amsterdam, 1775). -Institutions de mdecine pratique (trad., Paris, 1785). DUPONT (J .-Ch.), Y a-t-il de la diffrence dans les systmes de classification dont on se sert avec avantage dans l'tude de l' histoire naturelle et ceux qui peuvent tre profitables la connaissance des maladies? (Bordeaux, 1803). DURET (F.-J .-J .), Tableau d'une classification gnrale des maladies (Paris, 1813). FERCOQ (G.-A.), Synonymie ou concordance de la nomenclature de la Nosographie philosophique du pr Pinel avec les anciennes nosologies (Paris, 1812). FRANK (J. P.), Synopsis nosologiae methodicae (Ticini, 1790). LATOUR (F.-D.), Nosographie synoptique (Paris, 1810, 1 vol. seul paru). LINN (C.), Genera morborum (trad. apud SAUVAGES, cf. supra). PINEL (Ph.), Nosographie philosophique (Paris, an VI). SAGAR (J. B. M.), Systema morborum systematicum (Vienne, 1771). SYDENHAM (Th.), Mdecine pratique (trad., Paris, 1784). VOULONNE, Dterminer les maladies dans lesquelles la mdecine agissante est prfrable l'expectante (Avignon, 1776). |PAGE 206 II. -POLICE ET GOGRAPHIE MDICALES AUDIN-ROUVIRE (J.-M.), Essai sur la topographie physique et mdicale de Paris (Paris, an II). BACHER (A.), De la mdecine considre politiquement (Paris, an IX). BANAU et TURBEN, Mmoires sur les pidmies du Languedoc (Paris, 1766). BARBERET (D.), Mmoire sur les maladies pidmiques des bestiaux
(Paris, 1766). BIENVILLE (J.-D.-T.), Trait des erreurs populaires sur la mdecine (La Haye, 1775). CATTET (J.-J.) et GARDET (J.-B.), Essai sur la contagion (Paris, an II). CERVEAU (M.), Dissertation sur la mdecine des casernes (Paris, 1803). CLERC, De la contagion (Saint-Ptersbourg, 1771). COLOMBIER (J.), Prceptes sur la sant des gens de guerre (Paris, 1775). -Code de mdecine militaire (5 vol., Paris, 1772). DAIGNAN (G.), Ordre du service des hpitaux militaires (Paris, 1785). -Tableau des varits de la vie humaine (2 vol., Paris, 1786). -Centuries mdicales du XIXe sicle (Paris, 1807-1808). -Conservatoire de Sant (Paris, 1802). DESGENETTES (R.-N.), Histoire mdicale de l'arme d'Orient (Paris, 1802). -Opuscules (Le Caire, s.d.). FOUQUET (H.), Observations sur la constitution des six premiers mois de l'an V Montpellier (Montpellier, an VI). FRANK (J.-P.), System einer vollstndigen medizinischen Polizei (4 vol., Mannheim, 1779-1790). FRIER (F.), Guide pour la conservation de l'homme (Grenoble, 1789). GACHET (L.-E.), Problme mdico-politique pour ou contre les arcanes (Paris, 1791). GACHET (M.), Tableau historique des vnements prsents relatif leur influence sur la sant (Paris, 1790). GANNE (A.), L'homme physique et moral (Strasbourg, 1791). GUINDANT (T.), La nature opprime par la mdecine moderne (Paris, 1768). GUYTON-MORVEAU (L.-B.), Trait des moyens de dsinfecter l'air (Paris, 1801). HAUTESIERCK (F.-M.), Recueil d'observations de mdecine des hpitaux militaires (2 vol., Paris, 1766-1772). HILDENBRAND (J.-V.), Du typhus contagieux (trad., Paris, 1811). DE HORNE (D.-R.), Mmoire sur quelques objets qui intressent plus particulirement la salubrit de la ville de Paris (Paris, 1788). Instruction sur les moyens d'entretenir la salubrit et de purifier l'air des salles dans les hpitaux militaires (Paris, an II). JACQUIN (A.-P.), De la Sant (Paris, 1762). LAFON (J.-B.), Philosophie mdicale (Paris, 1796). LANTHENAS (F.), De l'influence de la libert sur la sant, la morale et le bonheur (Paris, 1798). |PAGE 207
LAUGIER (E.-M.), L'art de faire cesser la peste (Paris, 1784). LEBGUE DE PRESLE, Le conservateur de Sant (Paris, 1772). LEBRUN, Trait thorique sur les maladies pidmiques (Paris, 1776). LEPECQ DE LA CLOTURE (L.), Collection d'observations sur les maladies et constitutions pidmiques (2 vol., Rouen, 1778). LIOULT (P.-J.), Les charlatans dvoils (Paris, an VIII). MACKENZIE (J.), Histoire de la sant et de l'art de la conserver (La Haye, 1759). MARET (M.), Quelle influence les moeurs des Franais ont sur leur sant (Amiens, 1772). Mdecine militaire ou Trait des maladies tant internes qu'externes auxquelles les militaires sont exposs pendant la paix ou la guerre (6 vol., Paris, 1778). MENURET (J .-J .), Essai sur l'action de l'air dans les maladies contagieuses (Paris, 1781). -Essai sur l'histoire mdico-topographique de Paris (Paris, 1786). MURAT (J.-A.), Topographie mdicale de la ville de Montpellier (Montpellier, 1810). NICOLAS (P.-F.), Mmoires sur les maladies pidmiques qui ont rgn dans la province de Dauphin (Grenoble, 1786). PETIT (M.-A.), Sur l'influence de la Rvolution sur la sant publique (1796). -in Essai sur la mdecine du coeur (Lyon, 1806). PICHLER (J.-F.-C.), Mmoire sur les maladies contagieuses (Strasbourg, 1786). Prceptes de sant ou Introduction au Dictionnaire de Sant (Paris, 1772). QUATROUX (Fr.), Trait de la peste (Paris, 1771). RAZOUX (J.), Tables nosologiques et mtorologiques dresses l'Htel Dieu de Nmes (Ble, 1767). Rflexions sur le traitement et la nature des pidmies lues la Socit royale de Mdecine le 27 mai 1785 (Paris, 1785). ROY-DESJONCADES (A.), Les lois de la nature applicables aux lois physiques de la mdecine (2 vol., Paris, 1788). ROCHARD (C.-C.-T.), Programme de cours sur les maladies pidmiques (Strasbourg, an XIII). RUETTE (F.), Observations cliniques sur une maladie pidmique (Paris, s.d.). SALVERTE (E.), Des rapports de la mdecine avec la politique (Paris, 1806). SOUQUET, Essai sur l'histoire topographique mdico-physique du district de Boulogne (Boulogne, an II). TALLAVIGNES (J.-A.), Dissertation sur la mdecine o l'on prouve que l'homme civilis est plus sujet aux maladies graves (Carcassonne,
1821). THIERY, Voeux d'un patriote sur la mdecine en France (Paris, 1789). |PAGE 208 III. -RFORME DE LA PRATIQUE ET DE L'ENSEIGNEMENT Appel la raison ou voeu de l'humanit. BARAILLON (J.-F.), Rapport sur la partie de police qui tient la mdecine, 8 germ. an VI (Paris, an VI). -Opinion sur le projet de la commission d' Instruction publique relatif aux Ecoles de Mdecine, 7 germ. an VI (Paris, an VI). BAUMES (J.-B.-J.), Discours sur la ncessit des sciences dans une nation libre (Montpellier, an III). CABANIS (P .-J .-G.), Oeuvres (2 vol., Paris, 1956). CALS (J .-M.), Projet sur les Ecoles de sant, 12 prairial an V (Paris, an V). -Opinion sur les Ecoles de Mdecine, 17 germinal an VI (Paris, an VI). CANTIN (D.-M.-J .), Projet de rforme adress l'Assemble Nationale (Paris, 1 790). CARON (J.-F.-C.), Rflexions sur l'exercice de la mdecine (Paris, 1804). -Projet de rglement sur l'art de gurir (Paris, 1801). CHAMBEAU DE MONTAUX, Moyens de rendre les hpitaux utiles et de perfectionner la mdecine (Paris, 1787). COLON DE DIVOL, Rclamations des malades de Bictre (Paris, 1790). COQUEAU (C.-P .), Essai sur l'tablissement des hpitaux dans les grandes villes (Paris, 1 787). DAUNOU (P.-C.), Rapports sur les Ecoles spciales (Paris, an V). DEMANGEON (J .-B.), Tableau d'un triple tablissement runi en un seul hospice Copenhague (Paris, an VII). -Des moyens de perfectionner la mdecine (Paris, 1804). DESMONCEAUX (A.), De la bienfaisance nationale (Paris, 1 787). DUCHANOY, Projet d'organisation mdicale (s.l.n.d.). DU LAURENS (J.), Moyens de rendre les hpitaux utiles et de perfectionner les mdecins (Paris, 1787). DUPONT DE NEMOURS (P.), Ides sur les secours donner aux pauvres malades dans une grande ville (Paris, 1 786). EHRMANN (J.-F.), Opinion sur le projet de Vitet, 14 germinal an VI (Paris, an VI). Essai sur la rformation de la socit dite de mdecine (Paris, an VI). Etat actuel de l'Ecole de Sant (Paris, an VI). FOURCROY (A.-F .), Rapport sur l'enseignement libre des sciences et des arts (Paris, an II).
-Expos des motifs du projet de loi relatif l'exercice de la mdecine (Paris, s.d.). -Rapport sur les Ecoles de Mdecine, frimaire an III (Paris, an III). -Discours sur le projet de loi relatif l'exercice de la mdecine, 19 ventse an XI (Paris, an XI). FOUROT, Essai sur les concours en mdecine (Paris, 1786). GALLOT (J .-G.), Vues gnrales sur la restauration de l'art de gurir (Paris, 1 790). GRAUD (M.), Projet de dcret sur l'organisation civile des mdecins (Paris, 1791). |PAGE 209 GUILLAUME (J .), Procs-verbaux du Comit d'Instruction publique (Paris, 1899). GUILLEMARDET (F.-P.), Opinion sur les Ecoles spciales de Sant, 14 germinal an VI (Paris, an VI). IMBERT (J.), Le droit hospitalier de la Rvolution et de l'Empire (Paris, 1954). Instituta facultatis medicae Vidobonensis, curante Ant. Storck (Vienne, 1775). JADELOT (N.), Adresse Nos Seigneurs de l'Assemble Nationale sur la ncessit et les moyens de perfectionner l'enseignement de la mdecine (Nancy, 1790). LEFVRE (J.), Opinion sur le projet de Vitet, 16 germinal an VI (Paris, an VI). LESPAGNOL (N.-L.), Projet d'tablir trois mdecins par district pour le soulagement des gens de la campagne (Charleville, 1790). MARQUAIS (J.-Th.), Rapport au Roi sur l'tat actuel de la mdecine en France (Paris, 1814). MENURET (J.-J.), Essai sur les moyens de former de bons mdecins (Paris, 1791). Motif de la rclamation de la Facult de Mdecine de Paris contre l'tablissement de la Socit royale de Mdecine (s.l.n.d.; l'auteur est VACHER DE LA FEUTRIE). Observations sur les moyens de perfectionner l'enseignement de la mdecine en France (Montpellier, an V). PASTORET (C.-E.), Rapport sur un mode provisoire d'examen pour les officiers de Sant (19 thermidor an V) (Paris, an V). PETIT (A.), Projet de rforme sur l'exercice de la mdecine en France (Paris, 1791). -Sur la meilleure manire de construire un hpital (Paris, 1?74). Plan de travail prsent la Socit de Mdecine de Paris (Paris, an V).
Plan gnral d'enseignement dans l'Ecole de Sant de Paris (Paris, an III). PORCHER (G.-C.), Opinion sur la rsolution du 19 fructidor an V, 16 vendmiaire an VI (Paris, an VI). Prcis historique de l'tablissement de la Socit royale de Mdecine (s.l.n.d.). PRIEUR DE LA CTE-D'OR (C.-A.), Motion relative aux Ecoles de Sant (Paris, an VI). Programme de la Socit royale de Mdecine sur les cliniques (Paris, 1792). Programme des cours d'enseignement dans l'Ecole de Sant de Montpellier (Paris, an III). PRUNELLE (Cl.-V.), Des Ecoles de Mdecine, de leurs connexions et de leur mthodologie (Paris, 1816). Recueil de discours prononcs la Facult de Montpellier (Montpellier, 1820). RGNAULT (J.-B.), Considrations sur l'tat de la mdecine en France depuis la Rvolution jusqu' nos jours (Paris, 1819). |PAGE 210 RETZ (N.), Expos succinct l'Assemble Nationale sur les Facults et Socits de Mdecine (Paris, 1790). ROYER (P.-F.), Bienfaisance mdicale et projet financier (Provins, an IX). -Bienfaisance mdicale rurale (Troyes, 1814). SABAROT DE L'AVERNIRE, Vue de lgislation mdicale adresse aux Etats gnraux (s. l., 1789). TISSOT (S.-A.-D.), Essai sur les moyens de perfectionner les tudes de mdecine (Lausanne, 1785). VICQ D'AZYR (F.), Oeuvres (6 vol., Paris, 1805). VITET (L.), Rapport sur les Ecoles de Sant, 17 ventse an VI (Paris, an VI). WRTZ, Mmoire sur l'tablissement des Ecoles de Mdecine pratique (Paris 1784). IV. -LES MTHODES AMAND (L.-V.-F.), Association intellectuelle (2 vol., Paris, 1821). AMOREUX (P.-J.), Essai sur la mdecine des Arabes (Montpellier, 1805). AUDIBERT-CAILLE (J .-M.), Mmoire sur l'utilit de l'analogie en mdecine (Montpellier, 1814). AUENBRUGGER, Nouvelle mthode pour reconnatre les maladies internes (trad. in ROZIRE DE LA CHASSAIGNE, Manuel des pulmoniques, Paris, 1763). BEULLAC (J .-P .), Nouveau guide de l'tudiant en mdecine (Paris,
1824). BORDEU (Th.), Recherches sur le pouls (4 vol., Paris, 1779-1786). BOUILLAUD (J.), Dissertation sur les gnralits de la clinique (Paris, 1831). BROUSSONNET (J.-L.-V.), Tableau lmentaire de smiotique (Montpellier, an VI). BRULLEY (C.-A.), Essai sur l'art de conjecturer en mdecine (Paris, an X). BRUT (S.-G.-G.), Essai sur l'histoire et les avantages des institutions cliniques (Paris, 1803). CHOMEL (J .-B.-L.), Essai historique sur la mdecine en France (Paris, 1762). CLOS DE SORZE (J.-A.), De l'analyse en mdecine (Montpellier, an V). CORVISART (J.-N.), Essai sur les maladies et lsions du Coeur et des gros vaisseaux (Paris, 1806). DARDONVILLE (H.), Rflexions pratiques sur les dangers des systmes en mdecine (Paris, 1818). DEMORCY-DELETTRE (J.-B.-E.), Essai sur l'analyse applique au perfectionnement de la mdecine (Paris, 1818). DOUBLE (F.-J.), Smiologie gnrale ou Trait des signes et de leur valeur dans les maladies (3 vol., Paris, 1811-1822). DUVIVIER (P .-H.), De la mdecine considre comme science et comme art (Paris, 1826). |PAGE 211 ESSYG, Trait du diagnostic mdical (trad., Paris, an XII). FABRE, Recherche des vrais principes de l'art de gurir (Paris, 1790). FORDYCE (G.), Essai d'un nouveau plan d'observations mdicales (trad., Paris, 1811). FOUQUET (H.), Discours sur la clinique (Montpellier, an XI). FRANK (J .-P.), Ratio instituti clinici Vicinensis (Vienne, 1797). GILBERT (N.-P.), Les thories mdicales modernes compares entre elles (Paris, an VII). GIRBAL (A.), Essai sur l'esprit de la clinique mdicale de Montpellier (Montpellier, 1857). GOULIN (J .), Mmoires sur l'histoire de la mdecine (Paris, 1779). HLIAN (M.), Dictionnaire de diagnostic ou l'art de connatre les maladies (Paris, 1771). HILDENBRAND (J.), Mdecine pratique (trad., Paris, 1824, 2 vol.). LAND R-BEAUVAIS (A.-J.), Smiotique ou trait des signes des maladies (Paris, 1810). LEROUX (J.-J.), Cours sur les gnralits de la mdecine (Paris, 1818). -Ecole de Mdecine. Clinique interne (Paris, 1809).
LORDAT (J.), Conseils sur la manire d'tudier la physiologie de l'homme (Montpellier, 1813). -Perptuit de la mdecine (Montpellier, 1837). MAHON (P.-A.-O.), Histoire de la mdecine clinique (Paris, an XII). MARTINET (L.), Manuel de clinique (Paris, 1825). MAYGRIER (J .-P.), Guide de l'tudiant en mdecine (Paris, 1807). MENURET (J.-J.), Trait du pouls (Paris, 1798). MOSCATI (P.), De l'emploi des systmes dans la mdecine pratique (Strasbourg, an III). PETIT (M.-A.), Collection d'observations cliniques (Lyon, 1815). PINEL (Ph.), Mdecine clinique (Paris, 1802). PIORRY (P. A.), Tableau indiquant la manire d'examiner et d'interroger le malade (Paris, 1832). ROSTAN (L.), Trait lmentaire de diagnostic, de pronostic, d'indications thrapeutiques (6 vol., Paris, 1826). ROUCHER-DERATTE (CI.), Leons sur l'art d'observer (Paris, 1807). SELLE (Ch.-G.), Mdecine clinique (Montpellier, 1787, trad.). -Introduction l'tude de la nature et de la mdecine (trad., Montpellier, an III). SNEBIER (J .), Essai sur l'art d'observer et de faire des expriences (3 vol., 1802). THIERY (F .), La mdecine exprimentale (Paris, 1755). VAIDY (J.-V.-F.), Plan d'tudes mdicales l'usage des aspirants (Paris, 1816). ZIMMERMANN (G.), Trait de l'exprience en mdecine (trad., Paris, 1774, 3 vol.). |PAGE 212 V. -ANATOMIE PATHOLOGIQUE BAILLIE (M.), Anatomie pathologique des organes les plus importants du corps humain (trad., Paris, 1815). BAYLE (G.-L.), Recherches sur la phtisie pulmonaire (Paris, 1810). BICHAT (X.), Anatomie gnrale applique la physiologie et la mdecine (Paris, 1801, 3 vol.). -Anatomie pathologique (Paris, 1825). -Recherches physiologiques sur la vie et la mort (Paris, an VIII). -Trait des membranes (Paris, 1807). BONET (Th.), Sepulchretum (3 vol., Lyon, 1700). BRESCHET (G.), Rpertoire gnral d'anatomie et de physiologie pathologiques (6 vol., Paris, 1826-1828). CAILLIOT (L.), Elments de pathologie et de physiologie pathologique (2 vol., Paris, 1819). CHOMEL (A.-F.), Elments de pathologie gnrale (Paris, 1817).
CRUVEILHIER (J.), Essai sur l'anatomie pathologique en gnral (2 vol, Paris, 1816). DEZEIMERIS (J .-E.), Aperu rapide des dcouvertes en anatomie pathologique (Paris, 1830). GUILLAUME (A.), De l'influence de l'anatomie pathologique sur les progrs de la mdecine (Dle, 1834). LANNEC (R.), Trait de l'auscultation mdiate (2 vol., Paris, 1819). -Trait indit de l'anatomie pathologique (Paris, 1884). LALLEMAND (F.), Recherches anatomo-pathologiques sur l'encphale et ses dpendances (2 vol., Paris, 1820). MORGAGNI (J.-B.), De sedibus et causis morborum (Venise, 1761). PORTAL (A.), Cours d'anatomie mdicale (5 vol., Paris, an XII). PROST (P.-A.), La mdecine claire par l'observation et l'ouverture des corps (2 vol., Paris, an XII). RAYER (P.), Sommaire d'une histoire abrge de l'anatomie pathologique (Paris, 1818). RIBES (Fr.), De l'anatomie pathologique considre dans ses vrais rapports avec la science des maladies (2 vol., Paris, 1828-1834). RICHERAND (B.-A.), Histoire des progrs rcents de la chirurgie (Paris, 1825). SAUCEROTTE (C.), De l'influence de l'anatomie pathologique sur les progrs de la mdecine (Paris, 1834). TACHERON (C.-F.), Recherches anatomo-pathologiques sur la mdecine pratique (3 vol., Paris, 1823). VI. -LES FIVRES BARBIER (J .-B.-G.), Rflexions sur les fivres (Paris, 1822). BOISSEAU (F.-G.), Pyrtologie physiologique (Paris, 1823). BOMPART (A.), Description de la fivre adynamique (Paris, 1815). |PAGE 213 BOUILLAUD (J.), Trait clinique ou exprimental des fivres dites essentielles (Paris, 1830). BROUSSAIS (F.-J.- V.), Catchisme de mdecine physiologique (Paris, 1824). -Examen des doctrines mdicales (Paris, 1821). -Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques (Paris, 1808, 2 vol.). -Leons sur la phlegmasie gastrique (Paris, 1819). -Mmoire sur l'influence que les travaux des mdecins physiologistes ont exerce sur l'tat de la mdecine (Paris, 1832). -Trait de physiologie applique la pathologie (2 vol., 1822-1823). CAFFIN (J.-F.), Quelques mots de rponse un ouvrage de M. Broussais (Paris, 1818). CASTEL (L.), Rfutation de la nouvelle doctrine mdicale de M. le Dr
Broussais (Paris, 1824). CHAMBON DE MONTAUX, Trait de la fivre maligne simple et des fivres compliques de malignit (4 vol., Paris, 1787). CHAUFFARD (H.), Trait sur les fivres prtendues essentielles (Paris, 1825). CHOMEL (A. F.), De l'existence des fivres (Paris, 1820). -Des fivres et des maladies pestilentielles (Paris, 1821). COLLINEAU (J .-C.), Peut-on mettre en doute l'existence des fivres essentielles (Paris, 1823). DAGOUMER (Th.), Prcis historique de la fivre (Paris, 1831). DARDONVILLE (H.), Mmoire sur les fivres (Paris, 1821). DUCAMP (Th.), Rflexions critiques sur les crits de M. Chomel (Paris, 1821). FODRA (M.), Histoire de quelques doctrines mdicales compares celles de M. Broussais (Paris, 1818). FOURNIER (M.), Observations sur les fivres putrides et malignes (Dijon, 1775). GRARD (M.), Peut-on mettre en doute l'existence des fivres essentielles? (Paris, 1823). GIANNINI, De la nature des fivres (trad., Paris, 1808). GIRAUDY (Ch.), De la fivre (Paris, 1821). GRIMAUD (M. de), Cours complet ou Trait des fivres (3 vol., Montpellier, 1791). HERNANDEZ (J.-F.), Essai sur le typhus (Paris, 1816). HOFFMANN (F.), Trait des fivres (trad., Paris, 1746). HUFELAND (C.-W.), Observations sur les fivres nerveuses (trad., Berlin, 1807). HUXHAM (J.), Essai sur les diffrentes espces de fivres (trad., Paris, 1746). LARROQUE (J .-B. de), Observations cliniques opposes l'examen de la nouvelle doctrine (Paris, 1818). LEROUX (F.-M.), Opposition aux erreurs de la science mdicale (Paris, 1817). LESAGE (L.-A.), Danger et absurdit de la doctrine physiologique (Paris, 1823). MONFALCON (J .-B.), Essai pour servir l'histoire des fivres adynamiques (Lyon, 1823). |PAGE 214 MONGELLAZ (P.-J.), Essai sur les irritations intermittentes (2 vol., Paris, 1821). PASCAL (Ph.), Tableau synoptique du diagnostic des fivres essentielles (Paris, 1818). PETIT (M.-A.), Trait de la fivre entro-msentrique (Paris, 1813). PETIT-RADEL (Ph.), Pyrtologie mdicale (Paris, 1812).
QUITARD-PIORRY (H.-H.), Trait sur la non-existence des fivres essentielles (Paris, 1830). ROCHE (L.-Ch.), Rfutation des objections faites la nouvelle doctrine des fivres (Paris, 1821). ROEDERER et WAGLER, Tractatus de morbo mucoso (Gttingen, 1783). ROUX (G.), Trait des fivres adynamiques (Paris, 1812). SELLE (Ch.-G.), Elments de pyrtologie mthodique (trad., Lyon, an IX). STOLL (M.), Aphorismes sur la connaissance et la curation des fivres (trad., Paris, an V). TISSOT (S.-A.-D.), Dissertation sur les fivres bilieuses (trad., Paris, an VIII).
También podría gustarte
- Chap4-Le Courant Électrique Et Ses DangersDocumento4 páginasChap4-Le Courant Électrique Et Ses DangersJacques JeanAún no hay calificaciones
- 1 - FrontalDocumento32 páginas1 - FrontalAmos Fils-Aimé LindorAún no hay calificaciones
- Les Modèles Expliquant La SatisfactionDocumento3 páginasLes Modèles Expliquant La SatisfactionN'DRI BérengerAún no hay calificaciones
- Aid PDFDocumento184 páginasAid PDFMariam ZouhairAún no hay calificaciones
- TP1 Biologie Animale BIOL-J101-StudentsDocumento25 páginasTP1 Biologie Animale BIOL-J101-StudentsbruxellesdeleerAún no hay calificaciones
- Assainissement PfeDocumento64 páginasAssainissement PfeHind ABDANEAún no hay calificaciones
- Gestionnaire RHDocumento2 páginasGestionnaire RHMARIAM OUATTARA100% (1)
- Cours L1 Elts de Bio Mol Étud (Cours 20-21)Documento119 páginasCours L1 Elts de Bio Mol Étud (Cours 20-21)YVESAún no hay calificaciones
- Analyse Financière PDFDocumento85 páginasAnalyse Financière PDFTapha Diaby100% (1)
- DU - Preparation A Une ReconversionDocumento4 páginasDU - Preparation A Une Reconversionhoussem1209Aún no hay calificaciones
- Cours Santé PubliqueDocumento46 páginasCours Santé PubliqueJulie TEXIER0% (1)
- Brochure de TP Chimie de Surface 3eme Chimie FondamentaleDocumento15 páginasBrochure de TP Chimie de Surface 3eme Chimie FondamentaleAbde TamAún no hay calificaciones
- 03-Système Parasympathique 2Documento46 páginas03-Système Parasympathique 2Ez-zamanidi YassineAún no hay calificaciones
- Kombucha 1Documento12 páginasKombucha 1Biofilo KaravanaAún no hay calificaciones
- Gestion Des Stocks Et Des ApprovisionnementsDocumento57 páginasGestion Des Stocks Et Des ApprovisionnementssébastienAún no hay calificaciones
- La MitoseDocumento4 páginasLa MitoseFDGAún no hay calificaciones
- Eat Move SleepDocumento1 páginaEat Move SleepBoussad Nait MessaoudAún no hay calificaciones
- Exam QCU PL 30juin2020 CorrigéDocumento7 páginasExam QCU PL 30juin2020 CorrigéArij BoudhinaAún no hay calificaciones
- Droit Du Travail 2013-2014Documento27 páginasDroit Du Travail 2013-2014kanga100% (3)
- FROFR35LSI VeDocumento25 páginasFROFR35LSI VeBouh LvayAún no hay calificaciones
- Durabilité Des Ouvrages Bois - Classes D'emplois - FIBCDocumento32 páginasDurabilité Des Ouvrages Bois - Classes D'emplois - FIBCmodjibeAún no hay calificaciones
- Lecon Esf 2018Documento8 páginasLecon Esf 2018Francis NKONTCHOUAún no hay calificaciones
- Le Coin de L'apiculteur DébutantDocumento8 páginasLe Coin de L'apiculteur DébutantGrosBedAún no hay calificaciones
- La Prequelle Alien: Edition999.info Présente Ce Manuscrit GratuitementDocumento105 páginasLa Prequelle Alien: Edition999.info Présente Ce Manuscrit GratuitementSabrina IkoloAún no hay calificaciones
- Rapport de Stage AminDocumento20 páginasRapport de Stage AminMjadri Bassem100% (1)
- Biotech Master I - Ufhb - Biosciences Chap 4 FFDocumento79 páginasBiotech Master I - Ufhb - Biosciences Chap 4 FFjeanlouiskouakouAún no hay calificaciones
- Décret 05.11Documento4 páginasDécret 05.11Norr MalAún no hay calificaciones
- OTITESDocumento13 páginasOTITESWalid ould AliAún no hay calificaciones